La tartine
De la fragilité
de nos sociétés
Propos recueillis par Sandra Evrard · Rédactrice en chef
Mise en ligne le 15 juin 2022
Les crises se répètent et se ressemblent souvent à travers l’histoire de l’humanité. Dès lors, pourquoi n’arrivons-nous pas à les anticiper ? L’économiste Philippe Defeyt pointe du doigt la fragilité de nos sociétés, mais surtout leur complexité qui rend difficile l’adoption de réponses efficaces.
Illustrations : Julien Kremer
Les crises ont une fâcheuse propension à se répéter. Selon vous, est-ce le simple cours des choses auquel nous sommes confrontés génération après génération ou peut-on l’interpréter autrement ?
J’aurais tendance à dire qu’il y a un peu des deux. L’histoire économique, sociale et politique est jalonnée de crises depuis toujours. Quand on relit les titres de journaux de l’entre-deux-guerres ou de la fin des années 1900 ou 1800, on se rend bien compte que des crises, il y en a eu en permanence. Rappelons simplement qu’il y a eu les guerres mondiales, mais aussi à la sortie de la première, la grippe espagnole. Il n’y a pas grand-chose de neuf aujourd’hui, à ceci près qu’avec développement de notre richesse collective, on a désormais plus de moyens pour les régler. On aurait pu anticiper ou du moins créer un autre fonctionnement collectif et individuel qui permette d’atténuer l’impact de la crise énergétique. De ce point de vue-là, elle est évidemment l’archétype. On n’aurait peut-être pas pu éviter une guerre, et les difficultés d’approvisionnement et les problèmes techniques qui en découlent, mais on aurait pu vivre tout autrement les conséquences de cette crise. Il y a la piste sanitaire, bien sûr, le grand débat de savoir si notre mode de production agricole favorise ou pas l’émergence de certains stratagèmes. La grippe espagnole est apparue il y a plus d’un siècle, à une période où il y avait encore plein de forêts, pas de pesticides, moins de contacts qu’aujourd’hui entre l’Homme et l’animal – ou en tout cas entre la nature sauvage et l’animal domestiqué – et ça n’a pas empêché la naissance de cette maladie.
Pensez-vous que les crises sont nécessaires pour évoluer vers un autre monde, pour dépasser les blocages ?
L’Europe avait toutes les cartes en main pour préparer les défis de demain sur le plan géopolitique en matière d’énergie et de sécurité. Mais il aura fallu être au pied du mur, et donc une guerre, pour essayer de se mettre d’accord, pour faire avancer les choses sur ces points-là.
Les crises sont circonstancielles à notre condition humaine. Et effectivement, elles sont à la fois l’occasion d’avancer et de transcender les erreurs ou les comportements passés.
La Seconde Guerre mondiale et, juste avant, la Grande Dépression ont créé des conditions nécessaires pour mettre sur pied la sécurité sociale de l’après-guerre. Oui, chaque crise permet d’évoluer, et en même temps, il est fort probable qu’elle prépare déjà la crise suivante. Je pense que c’est inévitable : c’est comme ça que l’humanité fonctionne. On peut le regretter, on peut se demander si l’on manque de sagesse, voire de capacité à tirer une expérience de nos erreurs passées. Mais en attendant, c’est un état de fait. Et ce n’est pas parce qu’on a fait des erreurs dans nos vies que l’on ne doit pas les reproduire ou que l’on ne doit pas en faire d’autres.
Les crises ne naissent-elles pas d’une forme de déni ou d’immobilisme, ou même d’un frein au changement ?
Tout à fait, et cela vaut tant dans les comportements individuels que dans les collectivités. Il peut s’agir d’immobilisme dans une entreprise, dans une corporation, dans un système politique, dans une entité territoriale, comme la Wallonie ou la Belgique. On sait qu’il y a de très fortes résistances au changement, et c’est d’ailleurs ce qui explique qu’il faut des « coups de pied au cul » pour que les choses bougent. En gros, il y a deux moteurs au changement dans une société : un choc externe, dont les conditions de survenance sont imprévues, et la rencontre de contradictions internes.
Ces contradictions internes ne représentent-elles pas la caractéristique des crises que nous vivons dans le monde contemporain ? Les chocs externes ont toujours existé, c’est clair. En revanche, peut-être que nous sommes arrivés à un point qui cristallise toutes nos contradictions ?
Je pense que nous sommes arrivés à un point de blocage. Il n’est par exemple pas possible dans les conditions actuelles de notre société de faire évoluer notre droit social. Peu importe l’orientation que les uns ou les autres souhaitent ou souhaiteraient, il est dorénavant totalement impossible de faire progresser un système que tout le monde reconnaît pourtant comme étant devenu illisible, incohérent, contre-productif avec plein d’effets pervers. De même, la plupart d’entre nous ne maîtrisent pas, même de manière approximative, le fonctionnement de notre système fiscal, et malgré tout cela, il y a un blocage.
De nombreux experts nous expliquent depuis longtemps qu’il est nécessaire d’entamer une transition énergétique pour éviter les catastrophes futures d’un point de vue climatique. Et on a l’impression que ça bouge peu, voire pas du tout, dans certains secteurs.
Rien ou presque n’a bougé depuis le dernier gros choc énergétique en matière de prix. Dans la première moitié des années 1980, on était en pleine crise énergétique. La situation était compliquée sur le plan social également, avec le prix du carburant qui augmentait. Puis le prix est redescendu et on a fermé le dossier. Chacun s’est contenté de revenir à la normale. C’est ma plus grande crainte au sujet de la crise énergétique actuelle. On espère, avec la fin du conflit ukrainien, une remise en ordre d’un certain nombre de productions énergétiques, accompagnée d’une baisse des prix. Tout le monde serait content et on refermera, là aussi, le dossier. Le problème, c’est qu’on ne retournera pas à la normale. La normalité d’hier ne sera pas celle de demain, c’est une évidence.
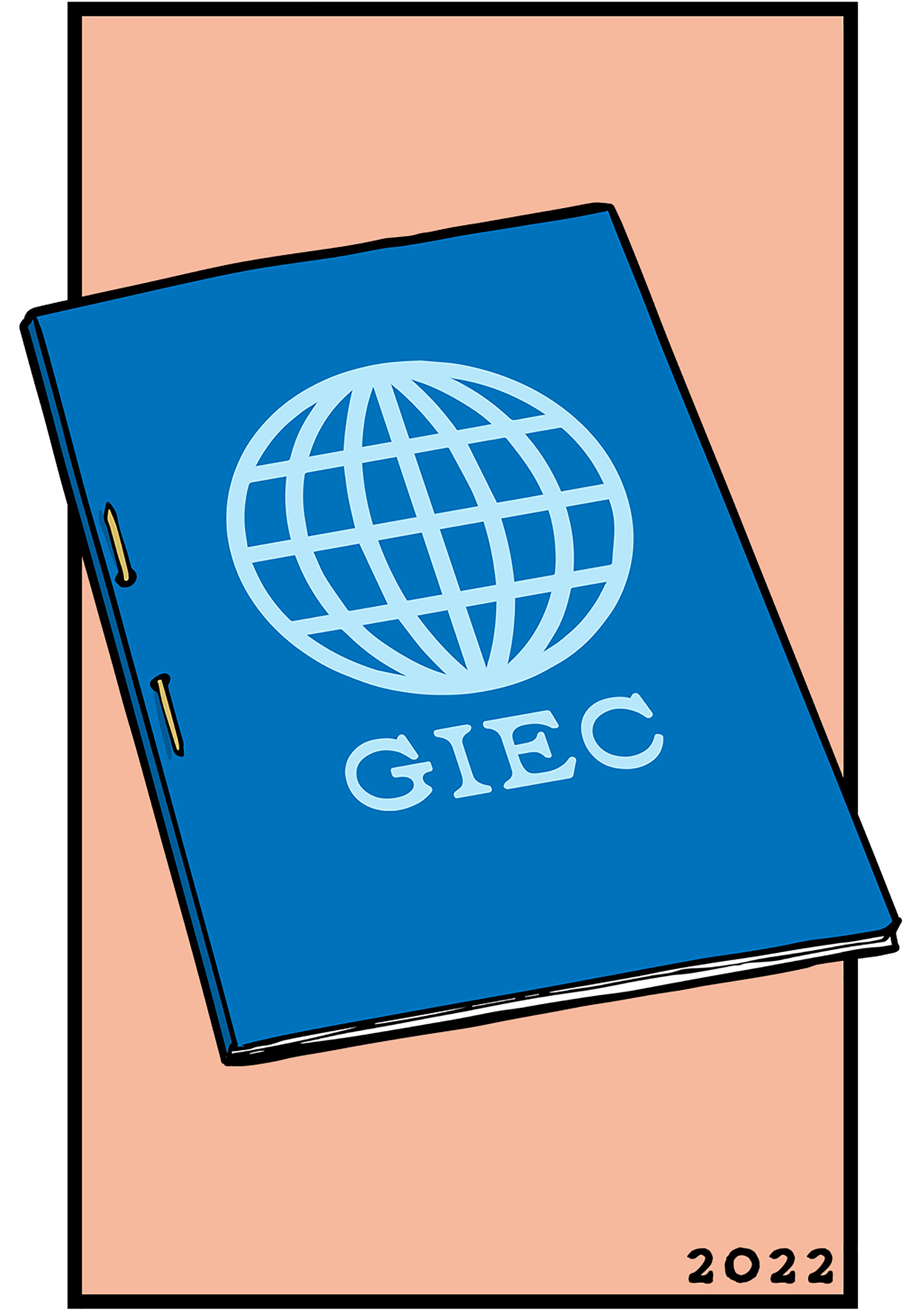
On entend souvent, du moins ces deux dernières années, que la culture d’anticipation des crises n’est pas très développée en Belgique.
Avant de pouvoir se projeter, se construire, il faut savoir qu’on n’a, en Belgique, et en Wallonie en particulier, aucune culture de l’évaluation. Ça commence déjà mal… Je ne vois aujourd’hui aucun mouvement vers l’évaluation des mesures qui ont été prises, que ce soit relatif au Covid-19 ou à l’énergie. Personne n’a envie de se pencher là-dessus.
Que pensez-vous du terme « résilience » ?
D’une certaine manière, on peut dire que nos sociétés ont été relativement résilientes, mais qu’elles restent extraordinairement fragiles. On l’a bien vu avec la crise énergétique, enfin plutôt avec le déclenchement de la guerre en Ukraine : au moindre mouvement de panique dans notre société, c’est la désorganisation totale, notamment des magasins et des commerces alimentaires en particulier.
Vous ne trouvez pas aussi qu’il y a une sorte d’injonction à la résilience à l’échelle individuelle ?
Oui, et en même temps, c’est inévitable. On n’a pas le choix. Mais nos sociétés sont extraordinairement fragiles. Dans la dimension de complexité que j’évoquais, il y a évidemment la dimension de l’interdépendance.
Certains estiment qu’aujourd’hui, nous ne vivons pas une ou des crises, mais plutôt un effondrement. Vous partagez aussi ce constat ?
Non, mais on peut très vite y arriver. Admettons que se superposent à la crise sanitaire – qui n’est toujours pas terminée et qui peut d’ailleurs rebondir avec l’apparition d’un nouveau variant – et à la crise énergétique, deux années de sécheresse dans plusieurs zones agricoles du monde. On pourrait très rapidement retrouver des mécanismes de rationnement ! Alors bien sûr, ce sont les pays riches qui partent systématiquement avec une longueur d’avance, mais la richesse ne peut pas acheter un produit agricole qui n’a pas été produit !
Par rapport au réchauffement climatique, c’est très difficile d’être optimiste quand on voit tous les problèmes, tous les freins présents dans chaque catégorie de changement nécessaire.
C’est extrêmement compliqué. Les gens ne sont ni sourds ni aveugles, on sent bien qu’il y a quelque chose qui se Avec passe. la guerre en Ukraine, les choses sont plus claires : elle entraîne une augmentation du prix de l’essence et des problèmes financiers, donc il faut qu’on trouve une solution. Avec la question climatique, c’est malheureusement beaucoup plus diffus et plus lent.
Si on veut être tout à fait rationnel et honnête, il est difficile de voir une perspective positive.
La seule chose qu’on peut dire, c’est que s’il y a une volonté politique, on peut créer les conditions nécessaires mais pas suffisantes à une transition heureuse. Et cela passe par protéger les plus faibles et rassurer sur l’avenir. On ne peut pas le faire d’une manière totale ; personne ne peut rassurer personne sur ce que sera le monde demain ou dans dix ans. Je vais donner un exemple très concret : comment est-ce encore possible aujourd’hui que des gens soient obligés de se chauffer à l’électricité dans des logements pourris ? Ce sont eux qui souffrent le plus de la crise énergétique, et parce qu’on ne veut pas les affecter davantage, on s’empêche de mettre en place d’autres réformes. Il faudrait passer à une tarification progressive de l’électricité, mais on ne peut pas le faire en sachant qu’il y a des personnes qui consomment 7 000 ou 8 000 kWh pour se chauffer. C’est d’abord un problème social avant d’être un problème écologique. Le fait qu’on ne se soit pas attaqués à un souci structurel bloque une série de réformes. Le politique devrait se demander : quels sont les sujets non résolus qui rendent plus compliquée une transition heureuse ? On ne peut pas dire que si l’on s’attaque à ces problèmes, on ne va pas rencontrer des obstacles, mais en tout cas on aura créé les conditions nécessaires. Après il faudra mettre un peu plus d’huile dans les rouages pour qu’elles soient suffisantes.
Est-ce à dire que finalement, l’être humain n’est pas formaté pour anticiper les crises ?
Je pense que c’est une contradiction interne de notre système, basé sur le fait que tout progrès en général s’accompagne d’une forme de complexité. Si on n’avait pas de système de soins de santé, par exemple, il n’y aurait pas de complexité : celui qui peut payer le docteur le paie, celui qui ne peut pas, n’y va pas. Il n’y a pas de complexité, il n’y a pas de mécanisme intermédiaire, il n’y a pas de règles à établir. Et à un moment donné, la complexité a des effets paralysants, c’est une sorte de myopie qui est générée par le système lui-même, qui produit des spécialistes, mais des spécialistes qui travaillent en silo, et il n’y a plus grand-monde qui ait une vue d’ensemble. La seule chose qu’on puisse dire, c’est que s’il y a une volonté politique, on peut créer les conditions nécessaires d’adaptation…mais pas suffisantes à une condition heureuse.
Sommaire
Partager cette page sur :
