La tartine
L’université,
un contre-pouvoir
à anéantir
Vinciane Colson · Journaliste « Libres, ensemble »
Mis en ligne le 17 octobre 2025
En s’attaquant au savoir scientifique, aux recherches jugées trop « woke » et aux universités dès les premiers jours de son mandat, Donald Trump a voulu faire passer un message clair : l’université sera mise au pas… ou ne sera plus. Alors que le président des États-Unis est le champion de la désinformation, il parvient, à l’image d’autres dirigeants d’extrême droite, à retourner l’argument et à se présenter en défenseur du savoir et de la vérité face à des scientifiques jugés manipulateurs. Mais la résistance s’organise.
Illustrations : Julien Kremer
« Un indescriptible chaos », « un sabotage en règle », « une censure inacceptable ». C’est peu dire que l’offensive de Donald Trump contre la recherche scientifique et les universités, dès les premiers jours de son mandat, a marqué les esprits et a suscité l’indignation. L’administration Trump ne s’est pas contentée de supprimer des dizaines de milliers d’emplois dans les agences scientifiques fédérales, elle a également détruit des bases de données entières, obligeant les chercheurs et les ONG à se lancer dans une véritable course contre la montre pour tenter d’archiver un maximum de données scientifiques, en matière de santé et de climat notamment, avant leur disparition définitive.
Une véritable déferlante
En l’espace de quelques semaines, c’est tout l’écosystème de la recherche américaine qui s’est retrouvé dans l’incertitude et le chaos. Selon Marius Gilbert, professeur en épidémiologie à l’ULB et vice-recteur à la Recherche, les attaques étaient attendues… mais pas avec une telle rapidité et intensité. « La première vague a été d’interdire aux chercheurs des agences fédérales d’utiliser une liste de mots dans leurs publications, en lien avec les thématiques de diversité et d’inclusion. Des mots comme “femme” ou “LGBTQIA+”. Dans un contexte américain qui valorise très fort la liberté d’expression, le fait que le pouvoir dise “il y a des mots qu’on ne peut plus utiliser dans l’exercice de ses fonctions en tant que scientifique” était extrêmement choquant. Mais ça, c’était la face émergée de l’iceberg, parce qu’au-delà de la capacité à communiquer, on voit bien dans la suite des mesures qui ont été prises qu’on est allé toucher directement à l’emploi. Il s’agit de se débarrasser de toute une série de personnes et de l’expertise qui va avec. Et la troisième vague, ce sont les mesures qui affectent immédiatement les universités et les subventions fédérales. »
Harvard fait partie des universités particulièrement touchées. Le gouvernement américain a privé la prestigieuse université américaine, située près de Boston, d’un peu plus de 2,6 milliards de dollars de subventions fédérales et lui a retiré le droit d’accueillir des étudiants étrangers – qui représentaient 27 % de sa communauté. Nouvelle attaque en règle au cœur de l’été : le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de juger si Harvard « se conforme à toutes les réglementations, et notamment en menant des programmes d’une manière qui ne porte pas atteinte aux objectifs de la politique étrangère ou ne compromet pas les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis ». Le bras de fer se poursuit et il se réglera en partie dans l’arène judiciaire, puisque Harvard a attaqué l’administration Trump devant un tribunal fédéral.
Le savoir, un dangereux pouvoir
« Les universités et les professeurs sont nos ennemis. » Ces mots, ce sont ceux de J. D. Vance lors d’un discours à la National Conservatism Conference en 2021. Quatre ans avant de devenir le vice-président de Trump, ses intentions étaient déjà très claires : il accusait les universités de propager des tromperies et des mensonges, voire d’opérer « un lavage de cerveau des étudiants ». Dans son discours, il invitait non pas à réformer l’université, mais à en sortir, « au nom de la science, de la vérité et de la justice ». On pourrait rire de l’absurdité de ses propos, si ses désirs n’étaient pas aussi près de se réaliser.
Les États-Unis ne sont d’ailleurs pas les seuls à s’attaquer à la recherche et aux universités. En Argentine, gouvernée par le libertarien d’extrême droite Javier Milei depuis 2023, le budget de la recherche financée par l’État a été réduit de 30 % en 2024 selon un article publié récemment dans la revue Nature, et de nombreux chercheurs se retrouvent dans une situation financière précaire, avec des salaires souvent inférieurs au seuil de pauvreté. Et il ne faut pas aller bien loin pour obtenir une nouvelle confirmation de la haine de l’extrême droite pour les sciences : la coalition au pouvoir aux Pays-Bas avait annoncé il y a un an des coupes drastiques dans les budgets consacrés à la science et à l’innovation, ainsi qu’une diminution de la part autorisée d’étudiants étrangers dans les universités.
Les sciences dans le viseur
Mais pourquoi s’attaquer aux sciences ? « C’est clairement le contre-pouvoir représenté par les universités et par les savoirs qui est visé ici, explique Marius Gilbert. En ciblant spécifiquement un certain nombre de domaines liés à la diversité, à l’équité, à l’inclusion, au climat, l’administration Trump veut faire taire un contre-pouvoir important qui pourrait se dresser face à la politique qu’elle entend mener. »

Selon le vice-recteur à la Recherche de l’ULB, Trump est entré dans un nouveau rapport de force avec les universités, en tentant de les mettre au pas comme il l’a déjà fait avec la justice et les médias. « Trump avait déjà réussi lors de son premier mandat à asseoir une certaine emprise politique au niveau de la Cour suprême, même si le pouvoir judiciaire est un peu le dernier garde-fou, pour le moment, qui protège un certain nombre de dispositifs. Le deuxième contre-pouvoir, ce sont les médias, mais on voit bien qu’ils sont mis extrêmement sous pression, parce qu’ils sont détenus par un certain nombre d’oligarques maintenant ralliés à la cause de Trump. Et donc ici, il y a un vrai rapport de force dans lequel la nouvelle administration est entrée avec les universités et le monde de la recherche, pour essayer d’affaiblir ce contre-pouvoir-là et obtenir une espèce de pouvoir absolu. »
À la merci des charlatans
Carl Sagan lui-même ne disait pas autre chose il y a trente ans. Docteur en astrophysique, ce scientifique américain est considéré comme le plus grand vulgarisateur du XXe siècle. Décédé en 1996, il est régulièrement cité par les résistants à la politique de Trump, tant ses propos étaient prémonitoires. Dans sa dernière interview à la télé américaine, il déclarait : « La science est plus qu’un ensemble de savoirs. C’est une manière de penser, une façon d’interroger le monde avec scepticisme, en comprenant bien que l’humain demeure faillible. Si nous ne sommes pas capables de soulever des incertitudes avec méthode, de questionner ceux qui prétendent détenir la vérité, d’être sceptiques vis-à-vis de l’autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique ou religieux qui viendra s’imposer à nous. Thomas Jefferson avait très bien identifié cela. Il disait qu’il ne suffit pas de consacrer des droits dans une convention ou une Constitution, les gens doivent être éduqués et exercer leur scepticisme et leur éducation. Sinon, nous ne dirigeons pas le gouvernement, c’est le gouvernement qui nous dirige. »
Ne pas se laisser berner
Éduquer les gens, voilà une manière de résister. Et c’est la mission que s’est donnée Océane Sorel, docteure en médecine vétérinaire et docteure en virologie, diplômée de l’Université de Liège. Française installée depuis neuf ans aux États-Unis, elle a quitté le monde de la recherche pour se consacrer à la vulgarisation scientifique sur son compte Instagram et sa newsletter « The French Virologist ». Depuis l’arrivée de Trump au pouvoir, elle continue d’informer sans relâche et de « débunker » les fake news. « Il faut savoir que, maintenant, les fake news viennent directement de la Maison-Blanche. Il n’y a plus de limites. On n’est plus face à une vidéo délirante de temps en temps sur les réseaux sociaux, là, c’est complètement fondu dans le paysage. » Dans l’œil de son viseur notamment : Robert F. Kennedy Junior, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis… et antivax notoire. « Il a par exemple commandité une étude pour essayer de prouver un lien entre l’autisme et les vaccins. Lien qui a été réfuté depuis des années par des dizaines d’études sur des millions d’enfants. Mais là, il l’a commanditée auprès d’une personne antivax. Ils ont déjà les conclusions avant même de la faire. Ils vont tenter de trafiquer les données. Ils vont réécrire l’Histoire, et comme ça vient du ministère de la Santé américain, dans la tête des gens, forcément, ça va être vrai. »
L’impact direct des fake news sur la santé publique
L’impact sur la santé est d’ailleurs visible et concret. À la suite de la baisse de la vaccination, les États-Unis ont enregistré depuis début 2025 leur pire épidémie de rougeole en plus de trente ans. L’épidémie a touché plus de 1 200 personnes et a fait trois morts, dont deux jeunes enfants – bilan qui serait largement sous-estimé selon l’Université Johns Hopkins. Robert F. Kennedy Jr est accusé d’avoir aggravé cette crise sanitaire en alimentant les craintes à l’égard du vaccin contre la rougeole et en encourageant des traitements non conventionnels. « Il promeut des choses comme la vitamine A. Donc on se retrouve avec des enfants hospitalisés parce qu’ils ont pris trop de vitamine A et qu’elle devient toxique à une certaine dose. C’est totalement hallucinant et dramatique car des enfants perdent la vie à cause de ça », se désole Océane Sorel.
À l’image de milliers d’autres scientifiques, elle participe à la résistance. Elle essaie avec ses collègues de sauver des données, sur les vaccins notamment, de publier des tribunes dans les médias et de communiquer un maximum. Des manifestations organisées par Stand Up for Science ont eu lieu aux États-Unis, mais aussi en Europe. Mais la communauté scientifique aux États-Unis vit dans un climat de peur.
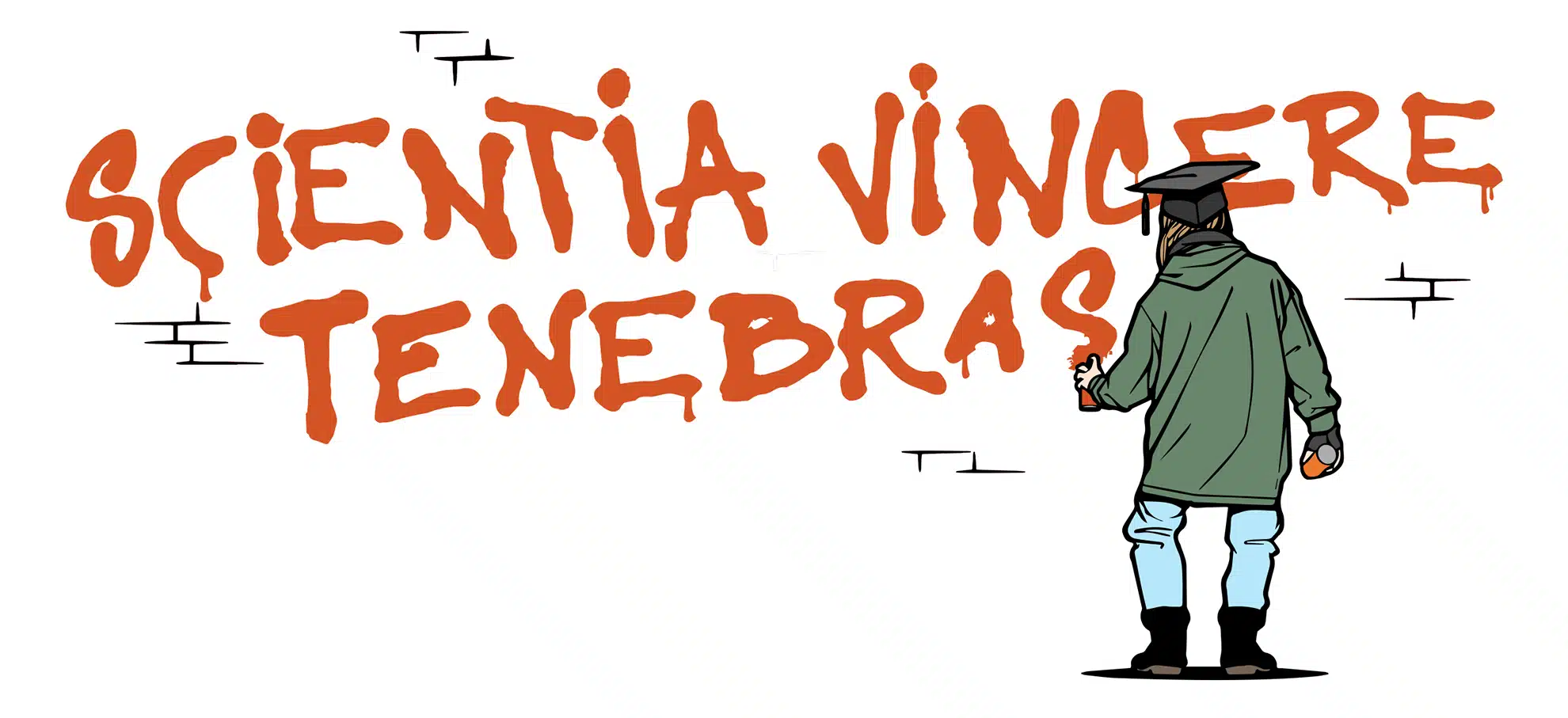
Des menaces mises à exécution
« Moi, je suis indépendante, je peux parler, mais c’est vrai qu’il y a des institutions, des chercheurs et des professeurs qui ont peur, parce que quand ils commencent à critiquer l’administration Trump, ils coupent les financements. Si je n’avais pas la double nationalité (franco-américaine), je risquerais carrément de me faire déporter. Ils ont déjà révoqué quelques cartes vertes de personnes qui avaient un discours qui n’allait pas dans leur sens. » Les menaces sont dès lors bien réelles. Trois chercheurs de l’Université de Yale (Timothy Snyder, Marci Shore et Jason Stanley), réputés pour leurs recherches sur le fascisme, ont ainsi quitté les États-Unis pour le Canada. Dans une interview publiée le 26 mars 2025 dans Toronto Today, Marci Shore déclare : « Je suis juive et historienne des années 1930 – donc le catastrophisme névrotique est peut-être surdéterminé : ma principale leçon de 1933, c’est qu’il vaut mieux partir plus tôt que trop tard. »
On peine à concevoir la situation, tant les États-Unis restent dans l’imaginaire collectif le pays de la liberté d’expression. Mais selon Marius Gilbert, c’est évident : les scientifiques européens vont vraiment hésiter à se rendre à un colloque scientifique aux États-Unis par crainte qu’on fouille dans leurs téléphones ou d’être refoulés à la frontière. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à un chercheur français en mission pour le CNRS qui s’est vu interdire l’accès au territoire des États-Unis en mars dernier.
Toutes les personnes que nous avons rencontrées pour écrire cet article le précisent : c’est un marathon, pas un sprint. Il va falloir tenir quatre ans, s’organiser, résister sans s’épuiser. « C’est un cercle vicieux, déplore Océane Sorel, car pendant que les scientifiques essaient de récupérer des financements, ils ont moins de temps pour “débunker” les fake news. Le fait d’affaiblir les institutions et les universités, ça permet à l’administration Trump de gagner du pouvoir. »
Certaines universités européennes se disent prêtes à accueillir des chercheurs américains. L’ULB et la VUB ont ouvert des mandats postdoctoraux pour des chercheurs d’autres pays, et les scientifiques américains seront particulièrement les bienvenus… mais il n’est pas simple d’envisager un soutien massif. Car en Belgique aussi, les universités doivent faire face à des restrictions budgétaires, et les postes de recherche sont chers. Mais d’après Marius Gilbert, la solidarité est incontournable à partir du moment où les recherches ont pris une dimension internationale et depuis que les collaborations sont devenues la norme. « Si Trump veut simplement casser son thermomètre, c’est son problème, on a envie de dire. Mais c’est le thermomètre du monde. La plupart des gros enjeux contemporains, qu’on parle de climat, de pandémies ou de biodiversité, sont globaux. Dès lors qu’un acteur aussi important que les États-Unis se retire du jeu, ça a un impact sur notre capacité à mesurer les phénomènes et donc à agir sur eux. Il faut trouver des moyens de compenser pour que les savoirs ne soient pas interrompus et voir comment on peut aider les scientifiques américains à passer ce mauvais cap, en espérant qu’il ne dure que pendant le mandat de Trump. »
Bras de fer et drapeau blanc
Mais la solidarité ne devrait-elle pas aussi se mettre en place entre les universités ? Alors que Harvard maintient le bras de fer avec Trump et ne cède pas aux pressions pour le moment, d’autres capitulent. Columbia a ainsi accepté de débourser plus de 200 millions de dollars pour mettre un terme aux enquêtes pour discrimination et au gel des subventions fédérales. L’administration Trump lui reprochait de ne pas avoir protégé assez ses étudiants juifs et d’avoir toléré des mobilisations contre la guerre à Gaza. Une accusation jugée fallacieuse. Mais c’était le prix à payer pour récupérer ses financements fédéraux.
La question se posera également pour les universités belges, flamandes en l’occurrence, qui ont reçu un courrier de l’ambassade américaine les questionnant sur leur politique de diversité. « Nos universités sont un phare de libre-pensée », a répondu Zuhal Demir, la ministre flamande de l’Enseignement (N-VA) interrogée au Parlement flamand. Mais pourront-elles rester ce phare si les lumières des collaborations internationales (et des financements qui les accompagnent) s’éteignent subitement ?
Pour que la liberté scientifique et académique ne soit pas qu’une utopie, il tient également de la responsabilité des chercheurs et des universités de se tourner vers les citoyens et la société, de communiquer, de s’ouvrir et de quitter la tour d’ivoire où certains se réfugient parfois. « Dynamiser les relations entre universités et sociétés, ça passe par la recherche participative et par toute une série de dispositifs que les universités peuvent mettre en place pour montrer que ce sont des lieux ouverts sur la société et qui, en fait, servent celle-ci », conclut Marius Gilbert.
Partager cette page sur :
