La tartine
Étudier, militer, survivre
Adam Assaoui · Président de la Fédération des étudiant.e.s francophones
Mis en ligne le 17 octobre 2025
Chaque rentrée académique, la Fédération des étudiant·es francophones (FEF) rassemble ses troupes, des délégué·es de classe aux président·es de Conseils étudiants, pour un week-end de formation. Au programme : des ateliers sur la prise de parole et sur les réglementations, des débats avec des représentant·es des forces politiques et syndicales et, bien sûr, quelques soirées jusqu’au petit matin. Les organisateur·rices introduisent chaque édition par la même phrase : « Les professeur·es et les directions sont là depuis vingt ans et resteront encore vingt ans. Nous ne sommes là encore que pour deux ou trois ans, alors on a intérêt à rapidement prendre notre place. »
Illustrations : Julien Kremer
Cette mise en garde, répétée de génération en génération, souligne le quotidien des représentant.e.s censés porter la voix de leurs camarades auprès de leur direction. Malgré les victoires obtenues au lendemain de Mai 68 qui ont consacré leur participation dans les instances des établissements, les étudiant·es sont souvent traité·es comme des usager·ères temporaires de l’université. Ils et elles ne sont jamais traité·es comme ses co-constructeur·rices. Les revendications des étudiant·es ne sont pourtant pas si radicales que cela. Mais elles sont parfois si dénigrées qu’on est en droit de se demander pourquoi certain·es ont si peur d’un enseignement supérieur public gratuit, de qualité, accessible, critique et citoyen ?
Un dialogue manqué
La crise du décret « paysage » de mai 2024 en est un exemple criant. Alors que plus de 45 000 étudiant·es signaient une pétition pour demander des aménagements du texte, le discours public dominant restait de dire que celles et ceux-ci manifestaient pour ne pas devoir étudier. Georges-Louis Bouchez dénonçait au journal télévisé, au pic de la crise politique, une lutte des étudiant·es pour « une université pêche aux canards ». À aucun moment on ne s’est interrogé sur l’impact de ces nouvelles règles sur le parcours des étudiant·es. Qu’en est-il des publics de plus en plus précarisés ? De l’engagement étudiant, pourtant essentiel pour apprendre à faire société ? Ou encore des générations ayant obtenu leur certificat d’enseignement secondaire supérieur pendant la pandémie de Covid-19 ? Les étudiant·es et la FEF qui portait leur voix avaient-ils raison ou non ? Nous le saurons dans quelques années. Ce qui est sûr, c’est que nous n’avons pas eu le droit à un débat public apaisé qui aurait pu permettre de co-construire une solution à cette problématique.
Plus récemment, Élisabeth Degryse, ministre de l’Enseignement supérieur, a annoncé vouloir proposer un nouveau décret « parcours étudiant » à la rentrée 2026. Même si on est en droit d’attendre que ce nouveau décret soit co-construit, on se résigne aujourd’hui à espérer que les conséquences ne seront pas trop désastreuses pour les étudiant.e.s. Les élections de 2024 ont entraîné un changement de paradigme dans le chef des acteur·rices de l’enseignement qui essaient d’éviter la casse plutôt que d’aller chercher de nouveaux droits. Le refinancement de l’enseignement supérieur semble actuellement irréaliste alors que les auditoires sont bondés. L’étudiant·e est un chiffre, un coût, une variable d’ajustement budgétaire. On ne l’écoute pas, on la·le gère. La question se pose alors de savoir comment faire pour créer cette université qui forme les citoyen·nes de demain.
Mobilisation et espoirs partagés
Ces derniers mois, la cause palestinienne a été un moteur de mobilisation dans toute la société et en premier lieu dans les universités. Les étudiant·es ont choisi d’occuper différents bâtiments sur le campus. Ce sont elles·eux qui ont été les premier·ères à dénoncer le génocide en Palestine comme le font aujourd’hui toutes les instances internationales, et même notre ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot. Les autorités universitaires ont décidé de donner une réponse policière à cette mobilisation alors qu’elles auraient pu écouter et se remettre en question vis-à-vis des liens qu’elles entretenaient (et entretiennent toujours) avec l’État israélien. Les défis sont pourtant immenses, du changement climatique aux inégalités en passant par la montée de l’extrême droite. Si nos universités ne forment pas les étudiant·es à avoir un esprit critique, à la citoyenneté et à la solidarité, alors qui le fera ?
La précarité étudiante en hausse
Or le désinvestissement dans la qualité et la citoyenneté ne peut être évoqué sans parler de la précarité étudiante grandissante. De septembre à novembre 2023, la FEF a interrogé 4 927 étudiant·es issu·es des différentes universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts en FWB. L’enquête révèle que 58 % des personnes sondées déclarent rencontrer des difficultés à se payer à manger. Le métier de l’étudiant·e n’en est plus un puisqu’il doit s’exercer en plus de celui de caissier·ère ou de barman·maid. Le monde politique, lassé de la situation, a préféré faciliter l’accès au travail étudiant alors que celui-ci a un impact indéniable sur la réussite scolaire.
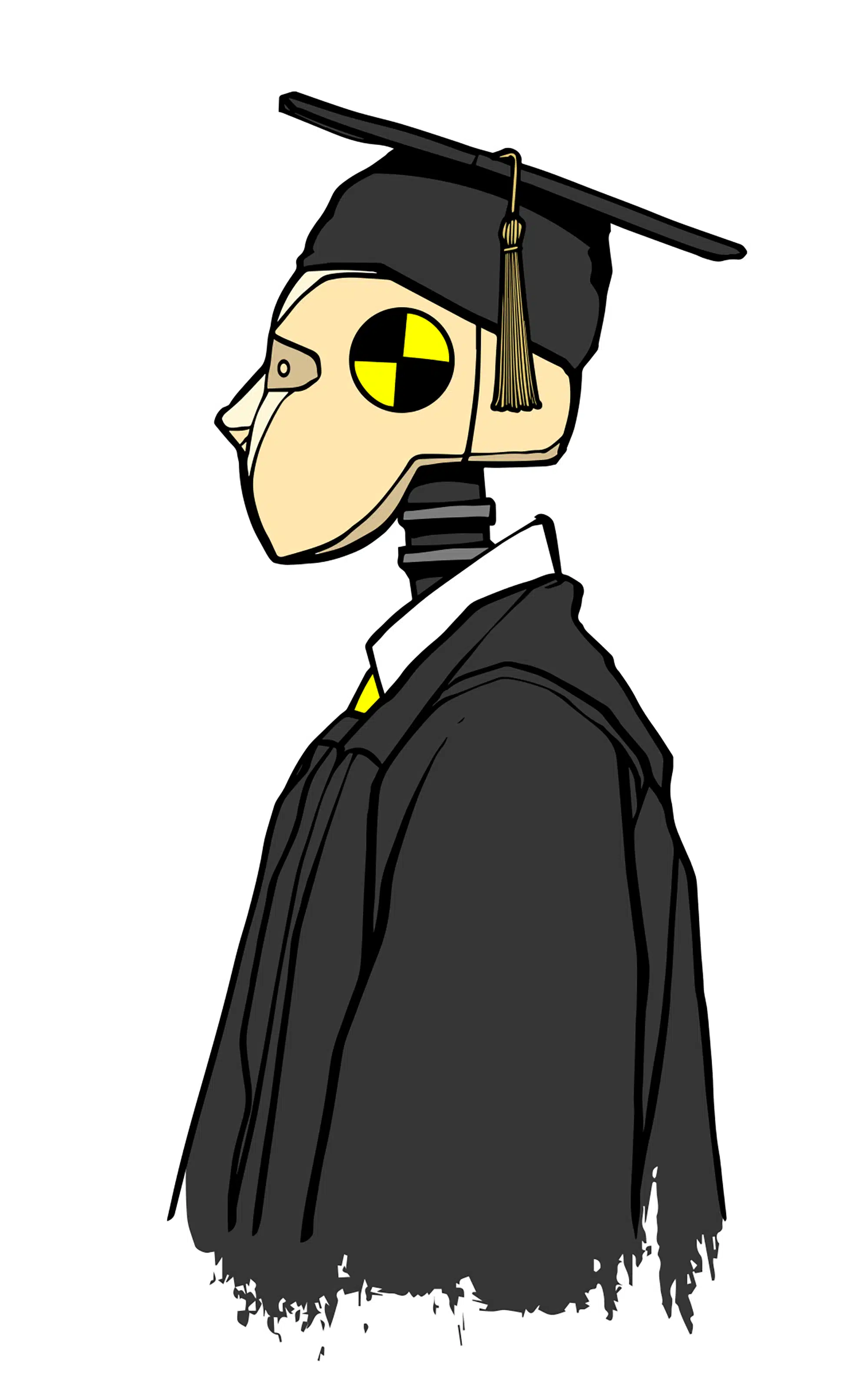
Une étude de l’UCLouvain Saint-Louis de 2024 montre que dans une classe de première année de bachelier, seuls 13,8 % des étudiant.e.s qui jobent pour financer leurs études arrivent à réussir leurs 60 crédits, contre 42 % pour celles et ceux qui ne jobent pas. Cette proportion interroge quand on sait que le décret « paysage » de Jean-Claude Marcourt a été accusé à lui seul de causer un allongement des études.
Il est temps de reconnaître que cet allongement trouve aussi sa source dans l’incapacité des gouvernements successifs à répondre à la précarité étudiante.
Vers un front commun
Les étudiant·es ne sont pas en crise, c’est leur monde qui l’est. Et face aux attaques que subit l’enseignement supérieur, il est urgent que ses acteur·rices – en ce compris les étudiant·es – fassent front pour exiger des différents gouvernements les moyens de faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain. En 2020, les professeur·es et travailleur·euses, épuisé·es par la surpopulation étudiante, ont soutenu la réforme du décret « paysage » portée par Valérie Glatigny. Ce fut sans doute une occasion manquée de créer ce front commun pour réclamer le financement nécessaire au maintien des activités d’enseignement et de recherche.
Ces derniers mois, un nouveau mouvement, « Université en colère », a été lancé à la suite des attaques du gouvernement contre les pensions. Sa force a été d’intégrer en son sein des étudiant·es et d’élargir les revendications salariales des travailleur·euses à la précarité étudiante et au décret « paysage ». On a donc vu des professeur·es, travailleur·euses et étudiant·es ensemble, un mégaphone à la main, pour demander de la considération pour ce lieu commun qu’est l’université.
Partager cette page sur :
