La tartine
Les biais de la rationalité
vus par les neurosciences
Propos recueillis par Catherine Haxhe · Journaliste
Avec la rédaction
Mise en ligne le 12 décembre 2024
Dans un monde qui valorise de plus en plus la rationalité comme pilier de nos décisions, peut-on vraiment se fier à notre cerveau pour toujours nous guider vers des choix raisonnés ? Albert Moukheiber, docteur en neurosciences et auteur de Neuromania : le vrai du faux sur votre cerveau, nous éclaire sur les biais qui faussent notre rationalité. À travers l’analyse des mécanismes cognitifs, il démontre que notre raisonnement, souvent considéré comme fiable, est en réalité influencé par des automatismes inconscients.
Fond © Rana369/Shutterstock · Illustrations : Cäät
Avec d’autres neuroscientifiques, vous avez fondé l’association Chiasma pour promouvoir la pensée critique. Elle organise des conférences et des ateliers visant à expliquer les mécanismes cérébraux qui sous-tendent nos raisonnements et notre perception du monde. Était-il nécessaire de déconstruire certaines idées reçues ?
Absolument. Au fil des années, un certain nombre de théories sur le fonctionnement du cerveau ont été popularisées, souvent sous un vernis neuroscientifique pour gagner en crédibilité. Or nos connaissances actuelles sur le cerveau ne permettent pas d’affirmer ce que certaines de ces théories prétendent. Il existe des croyances profondément erronées qui continuent de circuler, et il était important pour moi de les corriger. Certaines d’entre elles, bien que séduisantes par leur simplicité, finissent par caricaturer ou appauvrir notre compréhension du cerveau. Au lieu de mettre en lumière toute la complexité et la richesse de cet organe, ces idées rudimentaires réduisent sa portée et nous éloignent de la réalité. Un cerveau, c’est bien plus qu’une machine à penser divisée en deux hémisphères ou limitée à certaines fonctions isolées.
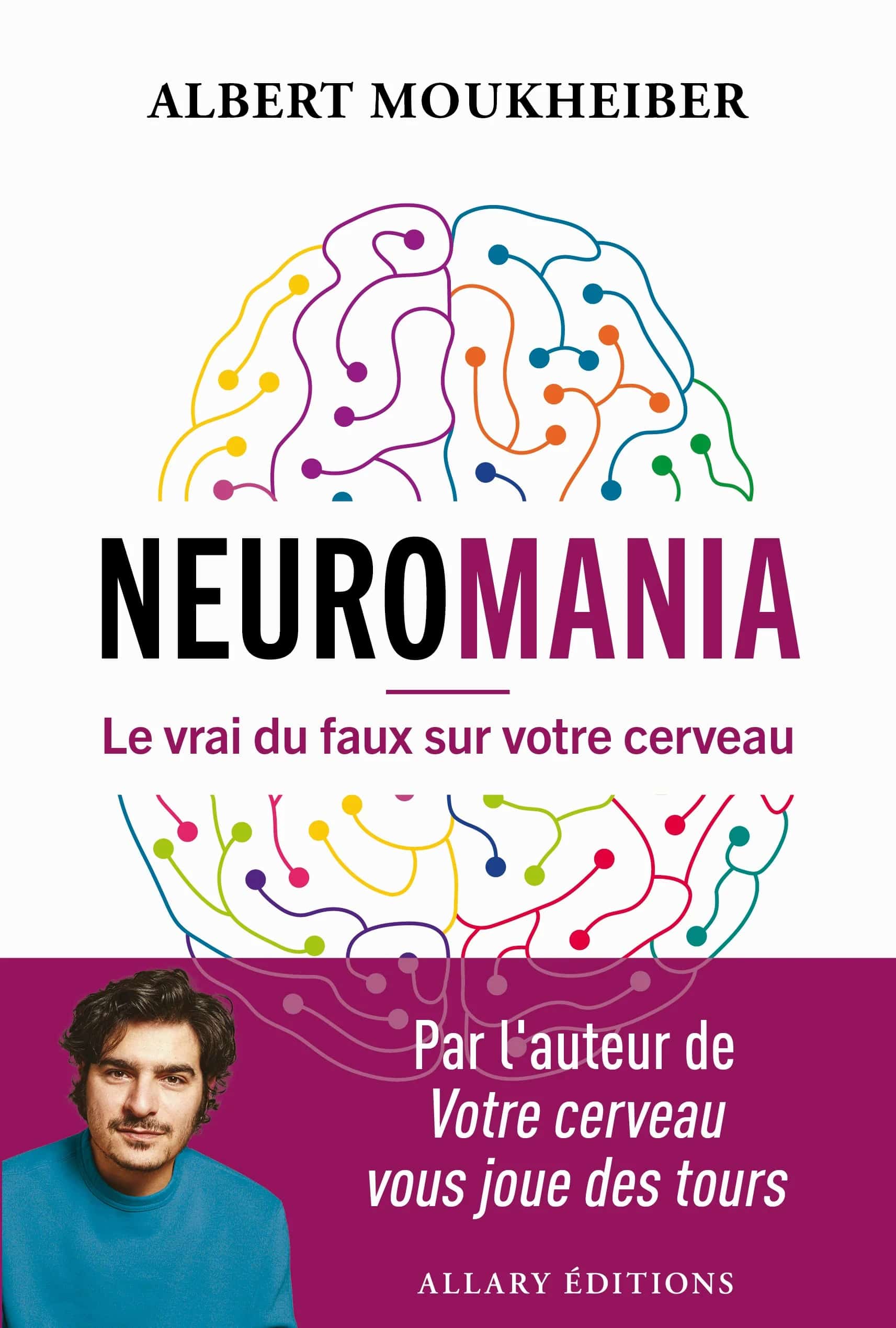
Albert Moukheiber, Neuromania : le vrai du faux sur votre cerveau, Paris, Allary, 2024, 288 pages
Faut-il alors abandonner l’idée des hémisphères droit et gauche, cette approche localisée du cerveau, héritée de la phrénologie de Joseph Gall au XIXe siècle ? Pourquoi ces théories persistent-elles ?
Plusieurs raisons l’expliquent. La première est la confusion entre fonctionnement biologique et ressenti personnel. Par exemple, si je ressens une émotion en opposition à une pensée, j’imagine un conflit entre mon cerveau émotionnel et mon cerveau rationnel. Pourtant, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Ces théories de cerveaux droit/gauche ou émotionnel/rationnel séduisent parce qu’elles sont intuitives. L’idée selon laquelle nous n’utiliserions que 10 % de notre cerveau est également très attractive, car elle alimente l’illusion d’un potentiel inexploité. Néanmoins, c’est totalement faux : nous utilisons bien plus que 10 % de cet organe à tout moment. Son développement passe par l’apprentissage, un processus souvent jugé trop scolaire, mais qui est en réalité l’un des meilleurs moyens de le renforcer. Certains préfèrent parler de « neuroplasticité », mais c’est simplement un autre terme pour désigner ce que l’on appelle traditionnellement « apprentissage ».
Donc la fameuse « bosse des maths » n’existe pas non plus ? Pourtant, certaines parties du cerveau semblent bien dévolues à des fonctions spécifiques, comme la marche ?
Effectivement, l’idée de la « bosse des maths » ou de zones strictement réservées à des compétences particulières n’a pas de fondement scientifique. Ce que nous apprenons désormais, c’est que le cerveau fonctionne de manière beaucoup plus interconnectée que nous ne le pensions. Des réseaux neuronaux complexes englobent plusieurs régions du cerveau pour accomplir une tâche donnée, et ces régions peuvent être impliquées dans une multitude de fonctions différentes. Il n’existe donc pas de zone unique et isolée pour chaque capacité ou compétence. Prenons un exemple fascinant : celui d’un patient qui, à la suite d’une douleur à la jambe, a passé une IRM cérébrale. Les médecins ont découvert qu’il vivait depuis toujours avec seulement 20 à 30 % d’un cerveau normal. Et pourtant, cet homme menait une vie ordinaire. Il avait des enfants, un travail, des amis. Cela illustre la formidable plasticité du cerveau humain, sa capacité à s’adapter et à redistribuer ses fonctions à d’autres zones. Cette histoire met en lumière l’importance de voir le cerveau comme un organe dynamique et flexible, en mesure de se réorganiser suivant les besoins. Nous sommes loin de l’idée d’un cerveau fonctionnant telle une machine avec des modules distincts pour chaque fonction.
Vous critiquez également des théories popularisées dans le domaine du développement personnel, un secteur qui génère des milliards de dollars chaque année. Pourquoi les neurosciences y jouent-elles un rôle aussi important ?
Le lien entre développement personnel et neurosciences s’explique en grande partie par le caractère mercantile du secteur. Dès qu’une nouvelle science émerge, elle est souvent récupérée à des fins lucratives. Il en a été ainsi avec de nombreuses découvertes scientifiques, et les neurosciences n’échappent pas à cette règle. Au début du XXe siècle, on vendait même des poudres radioactives, croyant que cela améliorerait la santé. C’est bien la preuve qu’à chaque époque, la science peut être mal comprise et détournée. Aujourd’hui, les neurosciences sont à la mode dans le monde du développement personnel, où elles sont souvent utilisées de manière excessive ou incorrecte pour justifier des méthodes ou des théories peu fondées.
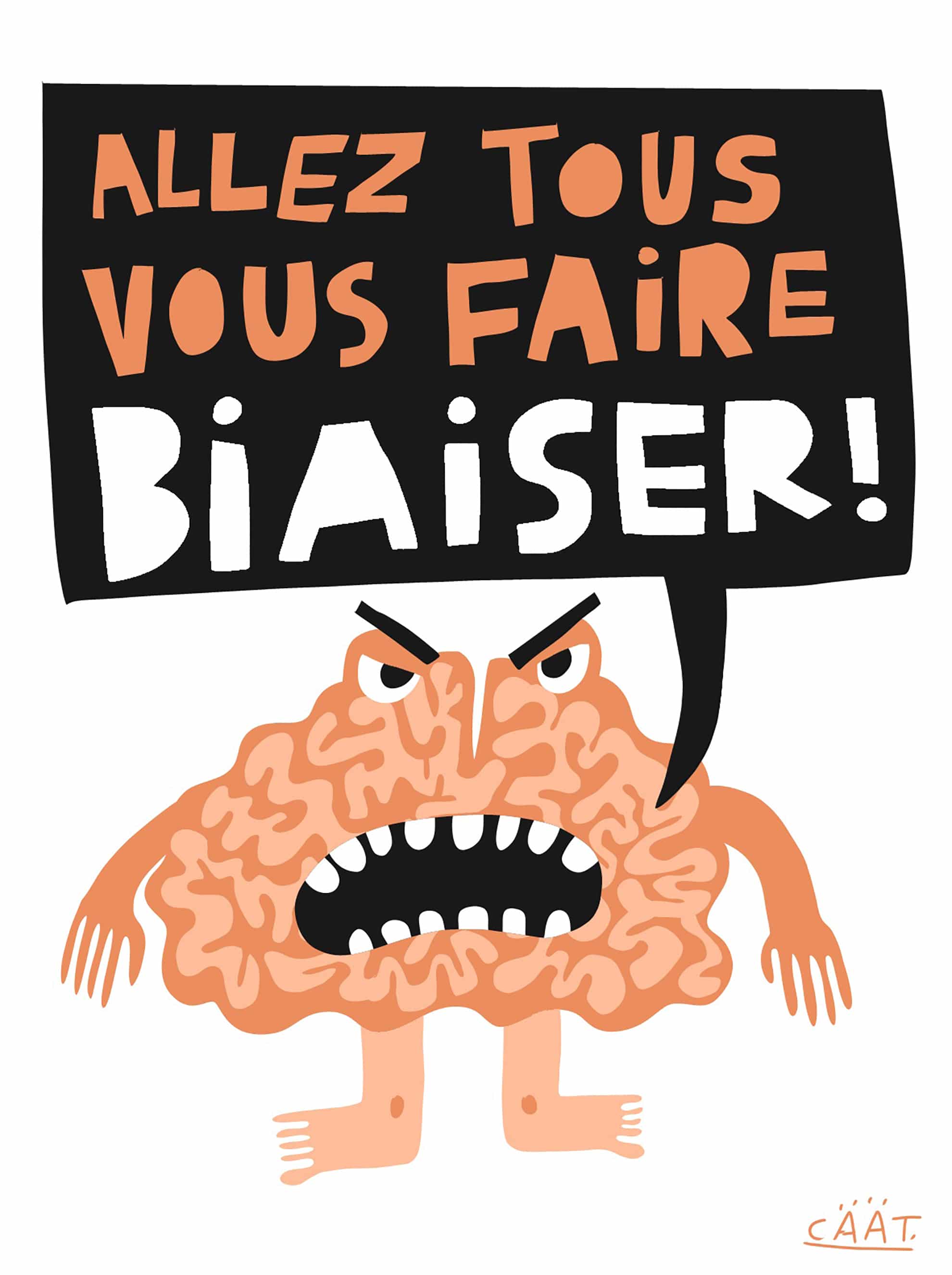
Le souci, c’est que cela dévalorise le « bon » coaching, celui qui s’adresse à des individus dans un cadre professionnel ou qui a pour but d’aider à résoudre des problématiques spécifiques. Le développement personnel, quant à lui, tend à sur-responsabiliser l’individu pour des difficultés qui sont généralement d’ordre structurel ou sociétal. Par exemple, quelqu’un souffrant d’anxiété liée à des conditions de travail précaires ne pourra pas résoudre ce problème par la simple méditation ni en s’alignant avec ses valeurs personnelles. Les causes de son malaise sont extérieures à lui-même et ne peuvent être ignorées. Ce glissement vers une responsabilité individuelle pour des problèmes systémiques est une dérive inquiétante.
Vous critiquez également une approche trop réductionniste de l’être humain. Que vouliez-vous montrer à travers votre livre sur cette question ?
Je voulais insister sur le fait que nous ne sommes pas uniquement un cerveau. Nous sommes aussi un corps, et nous évoluons dans un environnement. Il faut constamment prendre en compte cette triade pour comprendre pleinement un individu. Parfois, la source d’une dépression, par exemple, ne se situe ni dans le cerveau ni dans le corps, mais bien dans le contexte extérieur. Cette approche, appelée « cognition incarnée », dépasse la vision réductionniste qui voudrait que l’on puisse expliquer un individu en ne regardant que son cerveau.
Nous héritons d’une image dualiste du corps et de l’esprit, souvent influencée par des conceptions religieuses. Pourquoi est-il dangereux de remplacer cette vision par une nouvelle conception du cerveau comme seule explication de l’humain ?
Effectivement, il est problématique de remplacer un dualisme esprit-corps par un « totem » inédit où le cerveau devient le centre absolu de l’individu. Il s’agit certes d’un organe particulier, mais il fait partie d’un ensemble plus vaste. Il ne dirige pas l’organisme comme un chef d’orchestre isolé, il interagit constamment avec le corps et l’environnement. Des idées telles que celles d’Elon Musk, qui envisage un futur où nous pourrions télécharger notre conscience ou stocker nos souvenirs dans un cloud, relèvent d’une vision extrêmement réductrice et simpliste du cerveau. Ces conceptions ne prennent pas en compte la complexité de notre existence humaine ni les interactions permanentes entre le cerveau, le corps et le monde qui nous entoure.

Les neurosciences sont également utilisées à des fins politiques. Quels en sont les enjeux selon vous ?
Il existe deux grands volets dans la récupération des neurosciences : le volet commercial, dont nous avons déjà parlé, et un volet idéologique. Aux États-Unis, par exemple, certaines instances judiciaires commencent à se servir de l’imagerie cérébrale pour tenter de déterminer si un accusé est empathique ou psychopathe. C’est extrêmement dangereux, car nos connaissances dans ce domaine sont encore trop limitées pour tirer des conclusions aussi définitives. De plus, cela nous ramène à une approche que l’on croyait révolue, comme l’utilisation des détecteurs de mensonge ou la phrénologie du XIXe siècle.
On observe également une tendance à recourir aux neurosciences pour expliquer des phénomènes complexes, tels que la résistance face à la lutte contre le réchauffement climatique ou la surexposition aux écrans. Plutôt que de remettre en question les causes profondes de ces comportements – la structure même des sociétés de consommation –, on se contente d’expliquer ces phénomènes par des mécanismes neuronaux ou par une prétendue « addiction » aux écrans. Cela déresponsabilise les créateurs des technologies numériques, qui manipulent nos comportements par des mécanismes bien connus de ce qu’on appelle l’« architecture du choix ».
Quelle est la clé pour mieux comprendre notre cerveau et améliorer notre bien-être ?
Nous vivons à une époque où tout va extrêmement vite, où nous sommes constamment sollicités par des informations, des notifications, des écrans. Nous avons perdu le contact avec la lenteur, avec le temps long. Pourtant, pour bien fonctionner, notre cerveau a besoin de ce temps de pause, de réflexion, de décélération. Il est essentiel de réhabiliter l’ennui, la contemplation, la flemme. Ces moments où l’on ne fait « rien » sont en réalité des temps précieux où notre cerveau se régénère, où il traite les informations en profondeur. Prendre du recul, ralentir, ne pas chercher à tout comprendre ni à tout résoudre immédiatement, c’est aussi un moyen de rétablir une relation plus saine avec soi-même et avec son environnement. Nous devons réapprendre à laisser du temps à notre cerveau pour qu’il puisse « digérer » le monde dans lequel nous vivons, et ce temps est inestimable, car il nous permet de reprendre le contrôle de notre esprit.
À voir
Libres, ensemble · 5 octobre 2024
Partager cette page sur :
