La tartine
Les distorsions
de la rationalisation
Anaïs Pire · Déléguée « Étude & Stratégie » au CAL/COM
Mise en ligne le 14 décembre 2024
Selon une formule largement commentée à sa sortie, la gestion d’un pays devrait être affaire d’ingénieurs et non de poètes. Derrière cette ambition, il serait question de mettre fin aux aspirations fantaisistes qui auraient caractérisé une certaine idée de la gouvernance, et fonder les politiques publiques sur la rigueur, la précision et l’efficacité. L’objectif, en soi, ne semblerait pas tout à fait contestable : après tout, les réponses aux défis de notre temps ne se trouveraient-elles pas dans une approche technique des problèmes observés ?
Illustrations : Cäät
Fi du romantisme et des grands principes qui prennent sens dans notre sensibilité humaine, place aux données et à la technicité ! Dans une logique qu’on pourrait qualifier de « scientifique », il serait donc question de mettre en place des mesures, des processus ou des systèmes à l’image de ce qui est réalisé dans les installations techniques ou les assemblages industriels. Toutefois, si l’approche peut sembler séduisante à qui aspire à un monde réglé par des indicateurs aux allures objectives, elle n’est pas sans heurts.
Des ingénieurs comme des poètes se sont insurgés contre la conception réductrice, voire caricaturale, qui était faite de leurs disciplines respectives, mais par-dessus tout, au mirage que constituerait une telle politique. En effet, les uns et les autres soulignent la richesse de l’union de la rationalité et de l’imaginaire ; l’opposition grossière qui est faite entre la prétendue dureté des sciences et la légèreté de la littérature passe sous silence à la fois le pouvoir de l’inspiration, qui anime tant les vers que les formules mathématiques, et les impasses technocentriques que nous découvrons aujourd’hui (raréfaction des ressources, dérèglements climatiques, atteintes à la santé publique, etc.).
Plus encore, cette approche toute tournée vers les chiffres, les statistiques et les indicateurs comporte elle-même des biais lorsqu’elle s’attache à régler la chose publique. Parmi ceux-ci, la loi de Goodhart devrait alerter nos décideurs sur les conséquences d’une politique soumise aux seuls impératifs de la poursuite de tels objectifs désincarnés.
L’« effet cobra »
Une anecdote permet de saisir aisément le principe fondamental à l’œuvre dans la loi de Goodhart. Inquiet de l’importante présence de cobras à New Delhi, le régime colonial britannique offre une prime aux habitants pour chaque serpent mort. Si dans un premier temps cette mesure mène à une diminution du nombre de cobras, le système est rapidement exploité par quelques entrepreneurs qui se lancent dans l’élevage clandestin de ces reptiles afin de tirer récompense de ceux-ci. Alertées quant à ces élevages, les autorités mettent fin au programme, ce qui pousse les éleveurs à relâcher leurs cobras, puisqu’ils ne peuvent plus en tirer une quelconque rémunération, aggravant par là le problème initial. Désigné comme l’« effet cobra », ce phénomène illustre les effets pervers qui peuvent se produire à l’occasion des tentatives de résolution d’un problème, lesquelles causent en réalité une aggravation de la situation.
La loi de Goodhart procède de la même idée de mise en évidence des effets pervers attachés à certaines décisions politiques. Formulée par l’économiste britannique Charles Goodhart à partir de ses constats quant aux politiques monétaires menées par le gouvernement de Margaret Thatcher, elle s’énonce traditionnellement sous l’adage suivant : « Quand une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure. » Certains signalent que cette observation ne serait pas l’apanage de Goodhart, dans la mesure où une loi similaire avait été exprimée par le psychologue et spécialiste des sciences sociales Donald T. Campbell dans le cadre de ses recherches consacrées à l’évaluation des politiques publiques.
Quand les chiffres distraient de l’intérêt général
Opérant à l’origine dans des champs différents, les lois établies par Goodhart et Campbell convergent dans leur principe. Elles mettent toutes deux en garde contre l’utilisation d’indicateurs ou de mesures chiffrées à des fins politiques, car ceux-ci deviennent alors sujets à des manipulations directes ou indirectes. Ces manipulations causent des distorsions qui faussent les processus qu’ils étaient supposés contrôler. Dès lors, les indicateurs cessent d’être pertinents, car les agents gèrent la mesure plutôt que d’utiliser celle-ci comme une manière d’envisager le problème qu’il convient de résoudre. Pour en revenir aux cobras, dans ces hypothèses, les interventions gouvernementales ont mené à une multiplication artificielle du nombre de spécimens (une manipulation, donc), à rebours de l’objectif qui était poursuivi par ces politiques. Les éleveurs ont modifié leur comportement à leur avantage, au détriment de l’intérêt général qui fondait les initiatives des autorités.
Retours de manivelle
Les exemples d’apparition d’effets pervers ou de distorsions de cet ordre ne sont pas rares. Rien d’étonnant puisque ce principe peut trouver des applications dans toutes les sphères de la vie publique, ou, à tout le moins, dès que des lois et des réglementations poursuivent des résultats formulés à partir d’objectifs chiffrés ou d’indicateurs spécifiques. À ce titre, Donald T. Campbell en avait lui-même identifié deux dans des domaines bien différents. Le premier intervenait en matière de justice, où la pression exercée pour améliorer le taux d’élucidation (le nombre d’affaires criminelles résolues) a eu pour conséquence un non-enregistrement des plaintes ou un report de cet enregistrement jusqu’à l’élucidation de l’affaire par les services de police. Le second concernait l’éducation, où lorsque le budget des écoles dépendait des résultats obtenus par les élèves à certains tests standardisés, les professeurs n’enseignaient pas de manière généraliste la matière afin que celle-ci soit bien acquise, mais préparaient avant tout leurs élèves à la réussite de ces tests. Dans ces deux exemples, les tentatives d’optimisation à partir d’éléments métriques (taux d’élucidation, taux de réussite aux tests) ont rendu ces mesures inutilisables, puisque sujettes à manipulation et donc hors de corrélation avec l’objectif poursuivi.
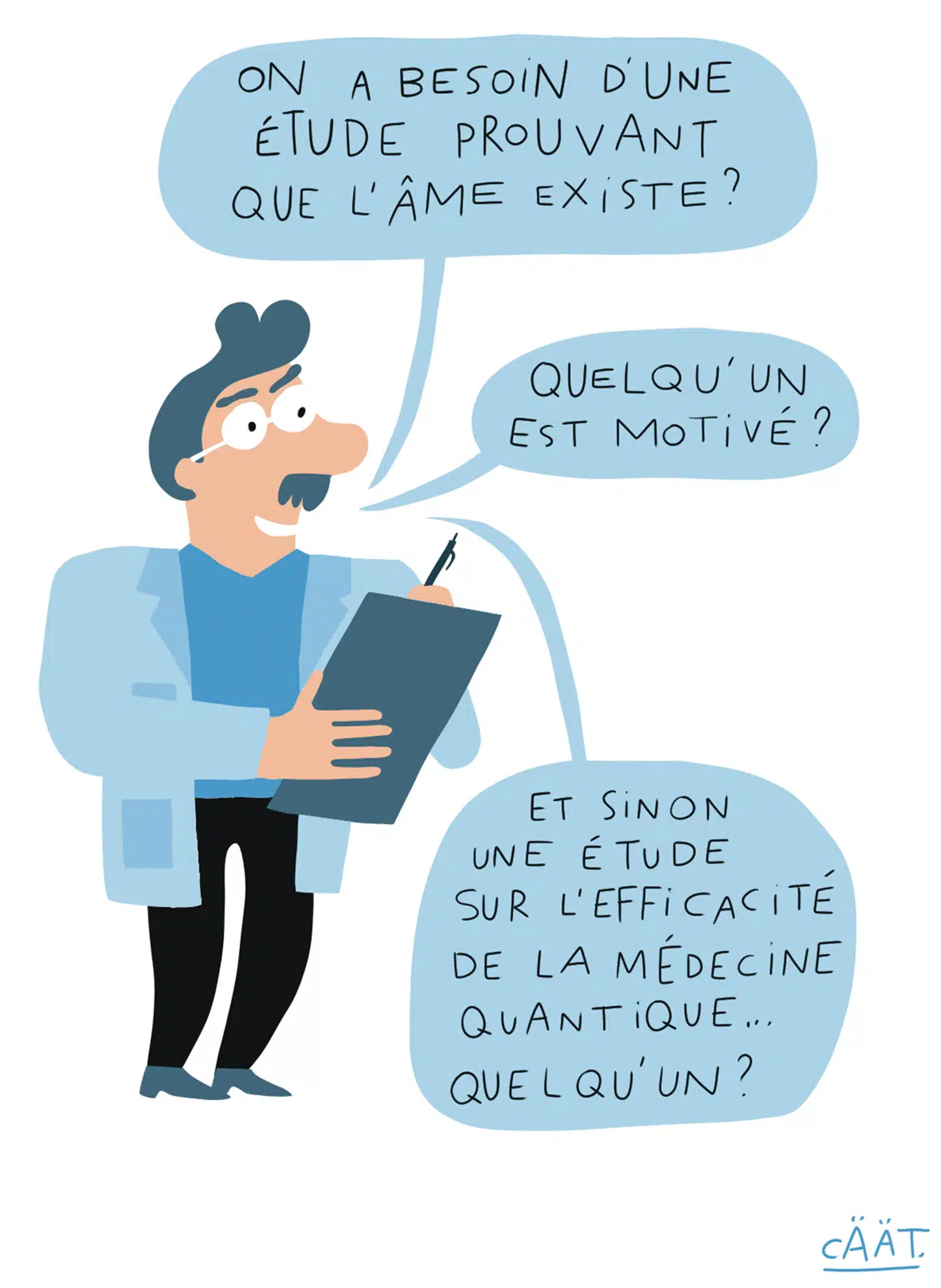
L’esprit d’abord
La loi de Goodhart peut toutefois être mitigée dans ses effets. Pour ce faire, il convient de multiplier les mesures de succès des politiques, en usant de facteurs tant quantitatifs que qualitatifs, et d’identifier des méthodes qui permettent de débusquer les distorsions, la corruption ou la mauvaise utilisation des données. L’esprit de la loi doit l’emporter sur sa lettre, ce qui nécessite de s’interroger sur les effets qui sont poursuivis par celle-ci au-delà du simple objectif chiffré. À titre d’exemple, « diminuer le taux de chômage » ne peut pas être à la fois l’objectif visé et le critère de réussite des réformes. Dans cette hypothèse, il ne sera pas tenu compte des manipulations possibles (exclusion, renvoi vers d’autres allocations, mise en place de formations inutiles pour faire sortir les bénéficiaires des statistiques, etc.), qui jouent à rebours de ce que devraient être les principes des politiques d’emploi.
Il ne s’agit pas ici de plaider pour la disparition d’objectifs formulés sur la base de statistiques ou d’indicateurs dans les politiques publiques ni de remettre en question la nécessité de pouvoir évaluer celles-ci à partir de tels éléments. Une prise en compte précise et rigoureuse des situations que doivent régler les institutions est fondamentale, ce que permettent ces statistiques et ces indicateurs. Ils sont donc essentiels pour mettre en œuvre des décisions politiques efficaces et transparentes.
Néanmoins, il est au moins aussi crucial de concevoir que les chiffres ne sont pas une fin en soi dans le champ politique, comme ils pourraient l’être dans l’élaboration d’un pont. Gérer un pays sous le seul mode quantitatif qui caractériserait les ingénieurs offre un grand champ aux détournements et aux manipulations qu’observe la loi de Goodhart. Une prise en compte qualitative, à l’image des inspirations et aspirations de la poésie, permet d’en atténuer les effets et ainsi d’œuvrer de la meilleure manière à la réalisation de l’intérêt général.
Sommaire
Partager cette page sur :
