La tartine
L’irrationalité
nous mène-t-elle
à la médiocratie ?
Propos recueillis par Sandra Evrard · Rédactrice en chef
Mise en ligne le 15 décembre 2024
Pourquoi n’arrivons-nous pas à combattre le réchauffement climatique de manière efficace et rationnelle ? Selon le philosophe québécois Alain Deneault, nous ne serions pas outillés psychiquement pour faire face à une évolution aussi rapide. L’auteur de La médiocratie et de Faire que! épingle également le fait que le mensonge officiel s’applique de façon coercitive, avec peu de place pour un véritable débat et les nobles échanges d’idées. Pour sortir de ce qu’il qualifie d’« ère de l’inouï », il nous invite à changer d’échelle.
Fond © Improviser/Shutterstock · Illustrations : Cäät
Le titre de votre dernier ouvrage évoque « l’ère de l’inouï ». Que recouvre cette expression ?
Traiter d’écologie politique aujourd’hui nous place dans la position de Cassandre. Parler de ce que le siècle nous réserve se révèle très difficile. Est inouïe, ou inaudible, toute discursivité s’essayant à traiter ce qui dépasse l’entendement, à savoir un monde géophysique en mutation, un climat se transformant d’une façon jamais vue, des espèces disparaissant sous nos yeux par centaines de milliers… Il s’ensuit un système Terre se détraquant de lui-même dans des mouvements exponentiels. Cela ne s’est pas vu – les scientifiques le répètent à l’envi – sur « des millions d’années ». Or, comment penser ce qui est radicalement sans précédent depuis une aussi longue période, si l’on considère ce que « penser » veut dire ? Depuis les Grecs, penser se produit par analogie, par comparaison. Car oui, contrairement à l’adage populaire, comparaison est raison. Paul Veyne disait du travail d’historien qu’il ne s’effectue qu’à la condition de faire preuve d’un important bagage de références ; on ne s’intéresse convenablement à une situation que si on la compare avec (et non à) d’autres, c’est-à-dire en en dégageant les ressemblances et les distinctions. Mais comment penser ce qui ne trouve dans le passé aucun pendant ? Rachel Carson traitait dans les années 1960 de ces insectes et de ces oiseaux qui devaient subitement s’adapter à l’épandage de 500 nouveaux produits chimiques par an ! Le temps long dans lequel ils s’inscrivent ne le permet pas, d’où leur dramatique anéantissement. Maintenant, par analogie, là aussi, il en va de même pour nous psychiquement. Nous ne sommes pas outillés intellectuellement et psychologiquement comme collectivités pour faire face aux mutations auxquelles nous nous voyons confrontés. D’où le fait que nous sombrions dans l’angoisse, une angoisse profonde et collective, une éco-angoisse (qui se distingue de l’assez mal nommée « éco-anxiété »). Et l’angoisse constitue une prédisposition à la recherche d’objets substitutifs (les boucs émissaires de l’extrême droite ou l’exacerbation des causes identitaires des mouvements sociétaux…). Revenir à la question politique classique « Que faire ? » n’est pas aussi simple que jadis, car l’adversité est désormais monumentale. Mais il ne s’agit pas d’une question strictement rhétorique à laquelle on pourrait se satisfaire de répondre « rien ». L’écologie politique travaille, ces décennies-ci, dans un sentiment d’urgence, à se donner des objets qui permettent de structurer l’action et la pensée autour de perspectives qui allient la lucidité et le courage.
Vous interrogez l’engagement politique aujourd’hui. En quoi est-il différent d’auparavant ? Les périodes de turbulence ont toujours marqué nos sociétés, qu’est-ce qui a changé ?
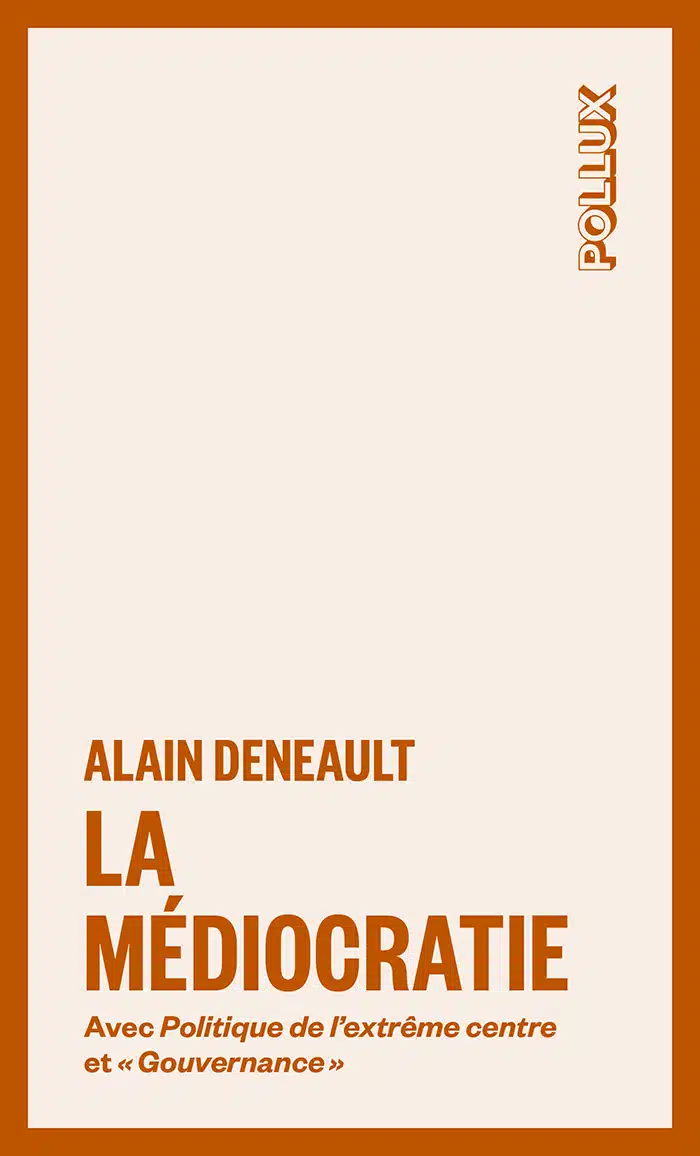
Alain Deneault, La médiocratie, Montréal, Lux Éditeur, 2024 (1re édition: 2015), 336 pages.
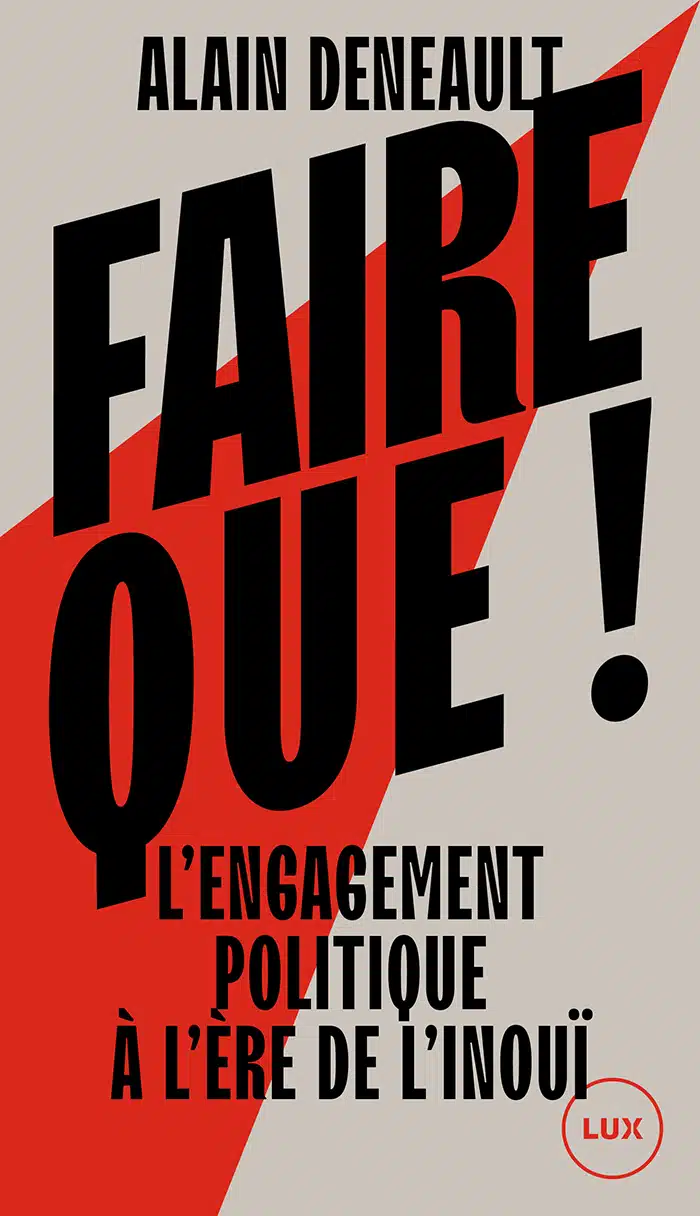
Alain Deneault, Faire que ! L’engagement politique à l’ère de l’inouï, Montréal, Lux Éditeur, 2024, 216 pages.

Les périodes de turbulence s’accompagnaient d’objets intellectuels et politiques capables de faire le poids, même dans les situations les plus douloureuses. Un objet, c’est ce sur quoi la pensée porte, en tant qu’il structure la réflexion et l’action. Au Moyen Âge, la chrétienté était un objet politique, comme la science s’en est révélée également un au XVIIIe siècle, ou encore le pacifisme dans les années 1920. Mais face à la catastrophe écologique annoncée, tétanisée et bousculée, la pensée politique est incapable de générer ce type d’objet. Le peuple infortuné est confronté à droite à des productions idéologiques de pacotille qui ne font pas le poids devant l’urgence d’agir comme le pitoyable « développement durable », l’opportuniste « capitalisme vert », la mensongère « transition énergétique » ou la fantasque « géo-ingénierie ». L’outrecuidance de ces propositions choque l’intelligence. Du reste, à gauche, la plupart des désignations pour se définir sont dotées de préfixes privatifs : on est anticapitaliste, anarchiste, insoumis, ou décroissantiste… Toutes consistent à laisser l’adversaire définir une proposition à laquelle on s’oppose dans un second temps. Ces prises de position négatives alimentent à coup sûr le flou et la culture du ressentiment. Certes, il s’entend que la situation actuelle nous plonge collectivement dans un désarroi. Cet état n’est pas problématique en soi (il serait surtout inquiétant de ne pas y passer), pourvu qu’on ne s’y stationne pas, qu’on se montre capable d’en sortir.
Dans un monde où la rationalité n’est plus forcément la norme recherchée, on peut légitimement s’interroger sur la probabilité d’une déchéance de nos sociétés et d’un risque de nivellement par le bas. Vous avez écrit un livre sur la médiocratie, que recouvre ce concept ? Et pensez-vous que cette médiocratie est aujourd’hui effective ?
Sur un plan intellectuel et éthique, la réalité, même si elle nous brûle les yeux, est devenue très difficile à traiter parce que le pouvoir oligarchique fait valoir désormais de manière coercitive le mensonge officiel. Nous sortons progressivement de cette conception dite arbitrairement « moyenne » des choses : celle qui s’imposait artificiellement encore récemment comme grammaire idéologique de la gouvernance amenant les acteurs sociaux à se percevoir en tant que « parties prenantes » du vaste marché de contractualisation. L’illusion d’une médiocratie s’administrant de façon horizontale cède tendanciellement le pas à un extrême centre. Ce dernier, comme tous les extrémismes, se montre intolérant à tout ce qui n’est pas lui, transforme les plateaux de télévision en tribunaux inquisitoriaux, brutalise les écologistes en les confondant avec des terroristes et vocifère ses vérités à la manière de dogmes intouchables. Plus le pouvoir entre dans un désarroi, plus on sent poindre la panique chez ceux qu’il emportera dans sa chute annoncée, plus rigide et violente se révèle la façon de pointer des boucs émissaires, de censurer les messagers de mauvais augure ou d’intimider ceux qui doutent. Les étiquettes fusent à une cadence inédite ; la moindre résistance à l’oligarchie nous vaut rapidement des noms d’oiseaux que des médias industriels infligent à la manière de vérités au vu du commun.
Si toute parole, même mensongère et absurde, peut être professée à tous les niveaux de pouvoir et avoir un impact direct sur la population, comment maintenir une conscience citoyenne éclairée et basée sur des connaissances tangibles ?
Se donner des objets dignes de la période historique dans laquelle nous nous immergeons. Le faire en restant lucide, sans déprimer, joyeux dans la lucidité. Agir ainsi, c’est rompre avec l’adage « ceteris paribus sic stantibus » (« toutes choses étant égales par ailleurs »), qui donne l’illusion que l’on peut se mesurer aux réalités du présent en isolant seulement quelques variables sur lesquelles on travaille. Non ! Tout bouge ; rien n’est égal par ailleurs. Tous les paramètres, même ceux que l’on jugeait les plus stables, se transforment de manière préoccupante. Le « gai savoir » porte désormais sur un tel savoir. Le philosophe Baptiste Morizot arrive à produire des objets adéquats, comme celui de « chimère » – un nom adapté aux mondes qui se profilent dans des croisements jadis invraisemblables. Mais c’est aussi le nom de structures politiques qu’il faudra apprendre à inventer, de nouveaux desseins nous permettant d’être en phase avec la nouvelle conjoncture, à l’ère de l’inouï. La « biorégion » est une notion qui répond bien à ce qui nous attend.

Je la définis dans Faire que ! comme étant impérative, c’est-à-dire que la géopolitique en ce siècle se contractera par la force des choses, en passant de la mondialisation industrielle et commerciale à l’autonomie régionale. Cela a déjà commencé : les conséquences dramatiques des bouleversements climatiques et de la perte de biodiversité (inondations, ouragans, incendies de forêt, canicules meurtrières, perturbation dans le règne animal, migration de réfugiés environnementaux, épidémies…) ainsi que les bris d’approvisionnement occasionnés par l’insécurité énergétique et la pénurie inévitable de minerais entraîneront un isolement structurel des communautés, lesquelles devront réapprendre à vivre de manière relativement autonome, avec elles-mêmes. Dans ce cadre, la « biorégion » consiste en une approche géopolitique selon laquelle le préfixe « géo- » est aussi important que le radical « politique » : la politique ne s’y conçoit plus contre et sur le territoire, mais en lui, prise dans ses synergies, en fonction des espèces qui l’habitent et de l’économie de la nature qui s’y organise. Cette échelle supposera de la créativité politique et celle-ci s’observera d’autant plus qu’elle se révélera nécessaire.
À écouter
Libres, ensemble · 9 novembre 2024
Partager cette page sur :
