Libres, ensemble
IVG en Belgique :
un droit toujours
sous pression
Lucie Barridez · Déléguée « Étude & Stratégie » au CAL/COM
Mise en ligne le 3 avril 2025
Depuis trente-cinq ans, l’avortement est légal en Belgique, mais sous conditions strictes. Malgré quelques avancées, la loi reste empreinte de restrictions et de sanctions pénales. Pire encore, le contexte international montre que ce droit fondamental est sans cesse menacé. Face aux offensives réactionnaires, la Belgique ne peut plus se contenter du statu quo : une dépénalisation complète s’impose pour garantir aux femmes une réelle autonomie sur leur corps.
Illustration © Keisi Melcer/Shutterstock
Ce 3 avril 2025 marque une date importante : l’anniversaire de la loi Lallemand-Michielsen dépénalisant partiellement l’avortement. « Partiellement » ? C’est là où le bât blesse. Car bien que cette avancée fût historique, le cœur n’est pas vraiment à la fête. Les femmes et les prestataires de soins doivent toujours se plier à des conditions strictes sous peine de sanctions pénales. De fait, le droit à l’avortement n’est pas encore pleinement acquis. L’urgence de consolider la législation est par conséquent bien réelle. Le délai légal de douze semaines, bien trop court, oblige chaque jour une femme à se rendre aux Pays-Bas pour un avortement sécurisé. À cela s’ajoute la montée de l’extrême droite et de l’idéologie traditionaliste, toujours hostile à l’autonomie des femmes. Alors qu’on souffle les trente-cinq bougies de la loi, veillons surtout à ce que ce droit fondamental ne s’éteigne pas.
Un compromis qui a renforcé le tabou
Depuis son inscription dans le Code pénal en 1867, l’avortement a été considéré comme un crime contre l’ordre de la famille et les mœurs publiques. Dès lors, la lutte a commencé pour que les femmes puissent accéder à l’avortement sans être jugées comme des criminelles. Dans les années 1970, plus de dix propositions de loi ont été déposées en ce sens, mais ce n’est qu’en 1990 qu’une loi est adoptée, fruit d’un compromis tel que les Belges savent le faire.
Un compromis d’abord sur les conditions de dépénalisation. La religion catholique, encore très influente et soutenue par des partis majoritaires, tels que les sociaux-chrétiens (PSC et CVP), imposait une perception moralisatrice de l’avortement : au pire comme un meurtre, au mieux comme un moindre mal1. Pour que la loi soit adoptée par un large consensus au Parlement, il a fallu transposer cette conception dans l’esprit du texte. Ainsi, les femmes devaient manifester un état de détresse pour pouvoir avorter – une condition supprimée en 2018. Aussi, on oblige les médecins à les informer des prétendues alternatives à l’avortement, notamment l’adoption. Elles sont également tenues de respecter un délai de réflexion de six jours entre la première consultation et l’intervention, comme si elles étaient incapables de prendre des décisions ou qu’on devait les protéger de leurs propres choix. Enfin, le recours à l’interruption volontaire de grossesse est limité à douze semaines.
En outre, cette loi constituait un compromis institutionnel et politique sans précédent. Par désir d’avancer, le gouvernement Martens VIII a laissé le Parlement trancher librement la question. Grâce à une majorité alternative et au respect de la liberté de vote, la proposition de loi Lallemand-Michielsen dépénalisant sous conditions l’IVG a finalement été votée. Cependant, l’autonomie de vote restait théorique, notamment chez les démocrates-chrétiens (PSC et CVP), dont les députés furent encouragés à suivre la ligne officielle de leur parti en votant contre ou en s’abstenant. La procédure a également été périlleuse : une crise institutionnelle due à l’opposition totale du roi Baudouin a été évitée de justesse. Celui-ci abdiqua temporairement pour ne pas apposer sa signature.
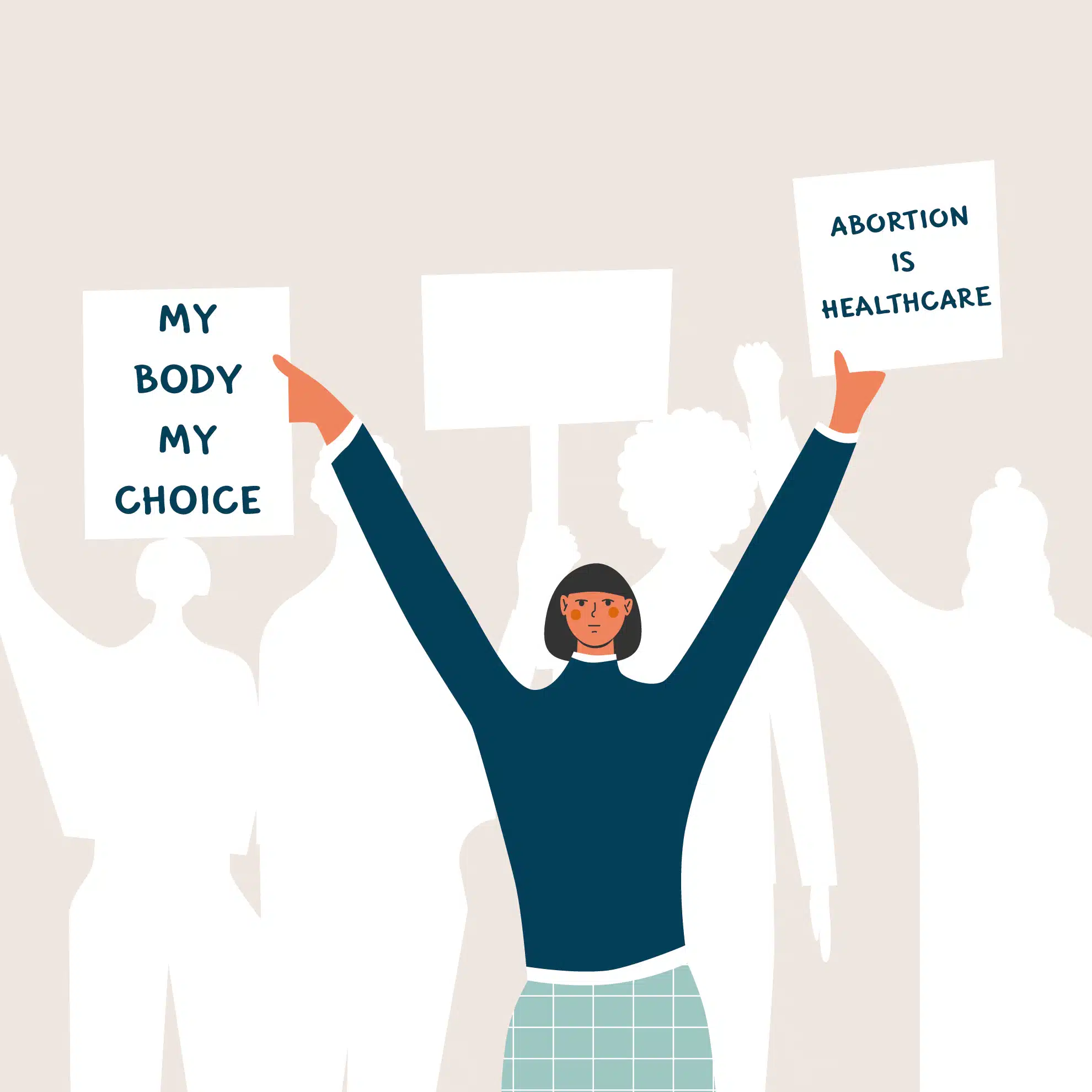
Certes, la loi de 1990 est une victoire majeure pour le droit des femmes à décider pour elles-mêmes. Mais l’histoire et le contexte de son adoption ont renforcé le tabou de l’IVG. Du côté des femmes, la culpabilité est amplifiée par le cadre de la loi, inscrite à l’époque dans le Code pénal. Sans parler des conditions comme l’état de détresse et l’obligation de respecter six jours de réflexion, qui stigmatisent les femmes du sceau de l’irresponsabilité. Concernant le corps médical, seule une minorité s’engagera réellement2. Beaucoup considèrent que l’IVG ne relève pas de leur rôle, une position confortée par l’existence d’une clause de conscience leur permettant de refuser de la pratiquer. D’autres sont freinés par la crainte de sanctions pénales.
Une réforme timide et une opposition qui ne faiblit pas
Il a fallu attendre vingt-huit ans pour que la loi soit améliorée, alors que les partis catholiques, nationalistes et d’extrême droite manœuvrent sans arrêt pour stopper toute avancée. En 2018, sous la pression des associations, l’IVG est symboliquement retirée du Code pénal, mais reste soumise à des poursuites pénales pour les femmes et les soignants. L’état de détresse est supprimé, et un délit d’entrave est créé pour sanctionner ceux qui empêchent physiquement l’accès à l’IVG. Cependant, cette réforme résulte encore d’un compromis avec le CD&V, qui a obtenu des mesures renforçant la reconnaissance des embryons. En 2019-2020, une proposition de loi visant à améliorer l’accès à l’IVG a été bloquée par des renvois successifs au Conseil d’État. En 2021, le CD&V conditionne sa participation gouvernementale à la mise au frigo du dossier, enterrant le débat malgré un rapport scientifique publié en 2023, recommandant l’allongement du délai à dix-huit semaines, la suppression du temps de réflexion et des sanctions pénales, ainsi que la reconnaissance de l’IVG comme un soin de santé. En 2024, l’histoire politique se répète : les négociations pour le nouveau gouvernement servent d’excuse pour repousser une fois de plus l’examen des textes, prouvant que l’IVG reste un enjeu de marchandage politique plutôt qu’un droit fondamental. En 2025, l’accord fédéral prévoit la « poursuite du débat sociétal et la modification de la loi après un consensus au sein de la majorité ». Une bonne vieille entourloupe pour décider de ne rien décider.
La Belgique ne peut rester passive. Tant que la loi maintient une vision punitive de l’IVG et que l’accès demeure contraignant, les risques de régression existent. La seule réponse est une dépénalisation totale et la reconnaissance de l’IVG comme un soin de santé, ainsi que le recommande l’OMS. Cette réforme garantirait aux femmes la liberté et la sécurité nécessaires pour exercer leur droit à disposer de leur corps. Mais cette avancée dépendra de la volonté politique. Faudra-t-il attendre trente-cinq ans de plus pour qu’une décision soit prise ? Surtout, peut-on encore se permettre de tergiverser ?
L’urgence d’agir face aux menaces grandissantes
Certains pourraient penser qu’il faut se satisfaire de la loi actuelle, puisque l’avortement reste autorisé en Belgique. Mais le nombre de menaces contre le droit à l’avortement dans nos pays voisins nous prouve que la résignation n’est pas permise.
En France, une enquête publique publiée en septembre 2024 révèle que 82 % des femmes ayant eu recours à l’IVG ont rencontré des obstacles majeurs, tels que des délais d’attente trop longs ou des disparités d’accès entre zones rurales et urbaines. Au Royaume-Uni, on constate une hausse inquiétante des poursuites pénales contre les femmes ayant avorté hors du cadre légal. En Italie, le gouvernement Meloni soutient des campagnes anti-choix et autorise ces mouvements à intervenir dans les centres de planning familial. Dans certaines régions, 90 % des médecins sont objecteurs de conscience. En Hongrie, une loi de 2022 oblige les femmes à écouter les battements du cœur du fœtus avant d’avorter. En Pologne, la quasi-interdiction de l’IVG en vigueur depuis 2020 a déjà coûté la vie à plusieurs femmes. En Croatie, une alliance entre extrême droite, Église catholique et groupes masculinistes orchestre des pressions constantes contre le droit à l’avortement, organisant prières de rue et manifestations devant les centres de planning.
De l’autre côté de l’Atlantique, la révocation de l’arrêt Roe v. Wade en 2022 a conduit à l’interdiction de l’IVG dans douze États américains. Depuis sa réélection en 2024, Donald Trump a abrogé des décrets protégeant l’accès aux soins reproductifs, et son chef de la diplomatie a supprimé les subventions américaines destinées à soutenir l’avortement à l’étranger.
- Pierre de Locht, prêtre catholique et théologien dans une interview sur les 15 ans de la loi partielle de l’avortement : Pierre de Locht et Roger Lallemand, « IVG : Histoire de la loi de 1990 et d’une époque », dans Politique, no 41, mai 2011.
- Ibid.
Partager cette page sur :
