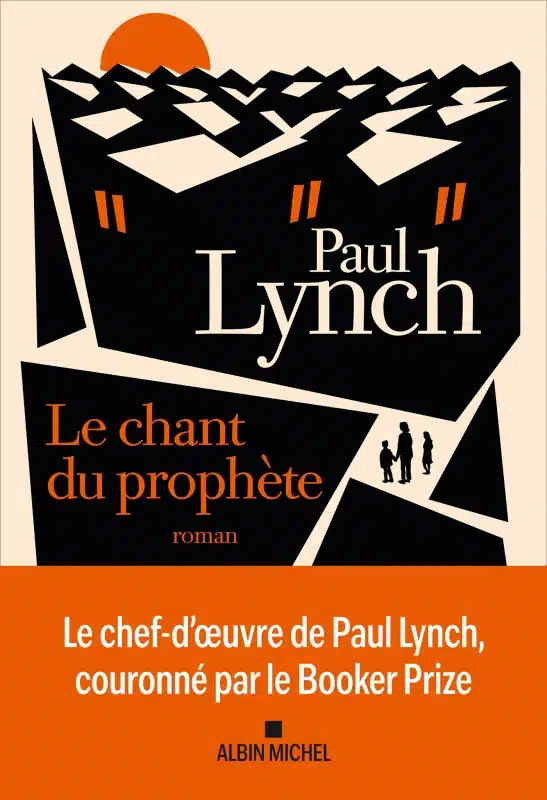Accueil - Exclus Web - À table -

Comme un cri qui alerte
Catherine Haxhe · Journaliste
Mise en ligne le 31 mars 2025
Le claquement de ses talons se répercute dans l’escalier et la voilà dehors, elle appelle Larry, mais il ne répond pas, et quand elle essaie à nouveau son téléphone s’est éteint. Alors elle lève les yeux et le ciel lui paraît soudain étranger, le monde semble se désintégrer et la pluie lente ruisselle sur son visage. »
Avec son nouvel opus, l’écrivain irlandais de quarante-sept ans Paul Lynch nous offre l’un des romans les plus forts de ce début d’année 2025. Enfin traduit en français, il a remporté le prestigieux Booker Prize en 2023. Certains diront que cette lecture est dystopique, mais l’accélération de la montée des idées fascistes dans le monde, nous ferait presque ranger Le chant du prophète dans le rayon roman réaliste. Pourvu que l’avenir ne nous donne pas raison.
Pourquoi un roman réaliste ? Jugez plutôt : l’intrigue se déroule dans une Irlande contemporaine qui sombre progressivement dans le totalitarisme. La vie de la famille Stack, comme celle de beaucoup d’autres familles, va profondément changer en cette soirée sombre et pluvieuse typique d’un hiver à Dublin, lorsque la maman Eilish ouvre la porte aux hommes du Garda National Services Bureau (GNSB), la nouvelle police secrète irlandaise. Des agents venus questionner son mari, Larry Stack, adjoint de la secrétaire générale du puissant syndicat des enseignants d’Irlande. Larry n’est pas à la maison ce soir-là, mais, très impliqué dans l’organisation de manifestations contre le régime en place, il disparaît quelques jours plus tard dans des circonstances troublantes. Eilish, microbiologiste, se retrouve seule pour protéger et subvenir aux besoins de leurs quatre enfants : Mark, Molly, Bailey et Ben. Alors que le gouvernement d’extrême droite élu deux années au paravent impose des mesures de plus en plus autoritaires, fait basculer l’Irlande dans l’état d’urgence, suspend la Constitution et accorde des pouvoirs étendus aux forces de l’ordre, la société irlandaise se désagrège. Tout ira très vite, les jeunes hommes de dix-sept ans sont appelés au service militaire, les manifestations et les syndicats sont interdits, les écoles ferment, les soldats sont postés devant les banques et un couvre-feu instauré. Eilish, confrontée à des choix déchirants pour assurer la sécurité de sa famille, devra naviguer dans un environnement où les libertés personnelles sont érodées et où la violence devient monnaie courante.
Aujourd’hui l’Irlande, demain la Belgique ou la France ?
Si Paul Lynch a choisi l’Irlande pour planter le décor de son histoire c’est évidemment parce que c’est là qu’il est né et a toujours vécu. Mais aussi parce que, comme ses concitoyens, il ne peut envisager de voir son pays vivre de tels évènements. Cette impossibilité, cette incongruité, rend le récit d’autant plus fort et coriace que dans l’imaginaire de Lynch comme du lecteur, ces choses ne se passent que loin de nous, au-delà des frontières, dans de lointains pays. Le lauréat du Booker Prize rend parfaitement compte de la complexité qu’une vie ordinaire peut revêtir lorsque la liberté s’enfuit, quand nous ne sommes plus maîtres de nos gestes quotidiens, anodins. Et Lynch de rappeler que si nos sociétés ne sont pas encore totalitaires, elles peuvent rapidement le devenir. S’appuyant sur une nouvelle ère de tribalisation, le totalitarisme peut s’instaurer par la voie électorale. Dans Le chant du prophète, le NAP, National Alliance Party, a été élu démocratiquement quelques mois plus tôt. « Quand la police secrète frappe à la porte de cette famille de Dublin, c’est déjà trop tard », confie Paul Lynch, « parce que ce gouvernement d’extrême droite a été élu deux ans précédemment, les gens ont voté, il met donc en place insidieusement, mais sûrement sa politique totalitaire et prend le contrôle. Nous pensons toujours que notre monde va durer tel que nous le connaissons donc nous sommes complaisants avec ces partis totalitaires. »1 Le chant du prophète offre une réflexion poignante sur la fragilité des démocraties modernes et sur la manière dont des sociétés stables peuvent basculer vers la tyrannie. Il semble nous dire : voilà ce qui arrive quand on vote mal !
Syndicats et enseignement, des baromètres de la santé démocratique
Ce n’est pas innocemment que l’auteur place la famille de son roman dans les milieux du syndicalisme et de l’enseignant, très puissants en Irlande. Deux refuges démocratiques de première ligne : faire grève, protester, manifester et marcher constituent autant d’actions emblématiques de la liberté. « Quand au début de l’histoire Larry doit rejoindre la manif, il hésite », poursuit Paul Lynch, « mais son épouse Eilish le pousse à montrer l’exemple de la lutte contre ce gouvernement totalitaire, elle semble dire, si ton puissant syndicat des enseignants n’y vas pas, personne n’ira. »
Autre figure emblématique du roman : la femme. Avec le portrait d’Eilish, Lynch témoigne de la difficulté d’être femme aujourd’hui : mère de quatre enfants, épouse soutenante, femme moderne faisant carrière, avec des parents qui vieillissent. L’auteur nous montre combien la vie moderne est compliquée et ne permet pas toujours d’appréhender le monde, de le comprendre, de le disséquer, lorsque les tâches quotidiennes sont nombreuses et que nous avons la tête dans le guidon. Eilish avance à tâtons dans cette démocratie qui glisse vers le totalitarisme. À travers son parcours, le roman met en lumière la force de l’esprit humain face à l’adversité et les sacrifices que l’on est prêt à faire pour protéger ceux que l’on aime.
La famille comme microsociété
De ce fait, Lynch explore aussi la résilience familiale face à l’oppression, où la lutte pour la survie dans un État autoritaire et la perte progressive des droits civiques amènent un groupe d’humains, une tribu, à prendre la route. Ainsi Eilish se désagrège peu à peu, se dépersonnalise, son identité disparaît, couche par couche, jusqu’au cœur de l’oignon. Et puisque quitter sa maison est une des choses les plus difficiles à faire, ce n’est qu’une fois déshumanisée par le totalitarisme qu’Eilish décidera de monter sur le bateau et de fuir. Ainsi, de manière inéluctable, l’auteur aborde la migration non plus sous le prisme de notre regard d’Européens, non migrants, comme le font nos gouvernements, mais de l’intérieur. Ici femmes, hommes, enfants sur le bateau, c’est nous.
Ce livre aux 293 pages denses et immersives est à rapprocher des œuvres d’un Cormac McCarthy. Avec peu d’espace entre les mots, des phrases longues, sans paragraphes, sans pauses et des dialogues sans guillemets, son style narratif unique immerge le lecteur dans l’urgence et la confusion ressentie par les personnages. Nous sommes véritablement coincés entre les lignes, mais la lecture reste étonnamment fluide et haletante. Lynch témoigne : « Chaque décision dans l’écriture d’un roman est un procédé pour dire la vérité d’être un humain. J’ai intégré quelques paragraphes quand j’ai commencé à écrire, mais le livre a dit non arrête, il voulait attraper et coincer le lecteur, comme dans une claustrophobie où il est impossible d’échapper à ce qui se passe. Je voulais que le lecteur trouve une certaine difficulté à s’échapper de la phrase. »
Pour Paul Lynch, la fiction permet de donner tant d’humanisme qu’elle nous offre un niveau plus élevé de réalité. Qu’est-ce finalement que d’être un humain sinon vivre de symboles et de récits ? « Voilà pourquoi je continue de lire les classiques, » conclut Paul Lynch « véritables réservoir de sagesse et de vérité humaine. Je ne dis pas que je détiens une vérité universelle, mais je peux donner ma version de la vérité dans chacun de mes livres. »
- « L’invité d’Entrez sans frapper. Paul Lynch et “Le Chant du prophète”, Booker Prize 2023 : Une dystopie sur le basculement de l’Irlande vers l’autoritarisme », mis en ligne sur auvio.rtbf.be, 17 février 2025.
Partager cette page sur :