La tartine
L’enjeu écologique
des clics
Propos recueillis par Sandra Evrard · Rédactrice en chef
Mise en ligne le 12 avril 2021
Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels sont les enjeux écologiques de ce cheminement massif des datas et du recours croissant à l’intelligence artificielle ? Interview de Guillaume Pitron, auteur de L’enfer numérique. Voyage au bout d’un like, une enquête de deux ans sur ce sujet.
Illustration : Philippe Joisson
Dans votre livre, vous débutez entre autres par un état des lieux chiffré qui démontre que les technologies numériques ont une empreinte écologique qui est loin d’être anodine. La consommation électrique du numérique augmente de 5 à 7 % par an… On voit déjà les problèmes que cela peut engendrer.
D’abord, la pollution numérique est une pollution matérielle. Elle est produite, générée par l’extraction, le raffinage, la consommation de ressources, en particulier des ressources métalliques qui sont nécessaires à la fabrication des 34 milliards d’équipements électroniques sur Terre. Ces équipements sont notamment les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les écrans, et leur production va exploser dans les prochaines années, plus précisément depuis l’avènement de l’ère des objets communicants qui produisent, qui consomment et qui s’échangent des milliers d’informations. Aujourd’hui, l’empreinte matérielle d’Internet est à peu près trois fois équivalente à celle d’un pays comme la France. Il y a une autre pollution qui est celle qui découle de l’électricité consommée par l’ensemble du secteur numérique, autant celle qui est nécessaire pour le domaine de l’intelligence artificielle (IA) que celle consommée par les centres de stockage de données. L’Ademe, agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en France, affirme que ces derniers seront parmi les principaux postes de consommation d’électricité du XXIe siècle. Et comme cette électricité provient notamment de ressources fossiles, cela équivaut à environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre. C’est plus que l’avion. Et c’est une pollution matérielle qui induit une contribution au réchauffement climatique.
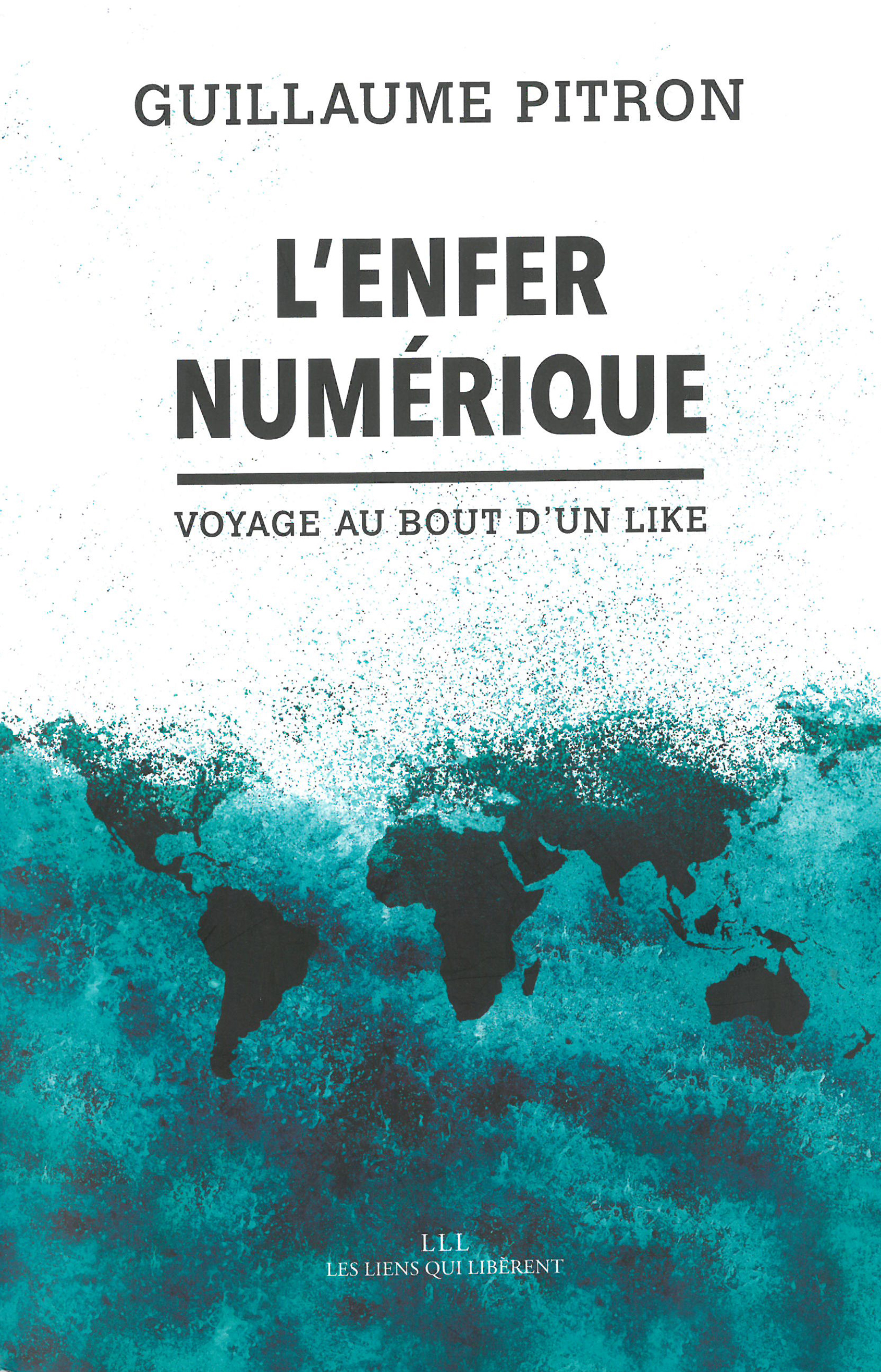
Guillaume Pitron, L’enfer numérique. Voyage au bout d’un like, Paris, Les liens qui libèrent, 2021, 352 pages.
Nos clics et nos données constituent donc un enjeu écologique ?
Il faut évidemment reconnaître au numérique d’énormes bienfaits socio-économiques. Mais pour autant, effectivement, nos vies sont toutes numérisées et nous numérisons toujours plus ce que nous faisons, ce que nous produisons dans le monde « physique ». Je suis invité au Canada pour une conférence, mais une fois sur place, tout se fera en hybride : à la fois en présence physique et via le numérique. Quand j’y étais il y a deux ans pour cette même conférence auprès de l’Université du Québec à Montréal, il n’y avait pas l’aspect hybride. En fait, on ne remplace pas forcément l’un par l’autre, on additionne l’un à l’autre. Tout cela génère des impacts qui sont importants, et comme notre vie en ligne s’étend toujours davantage, effectivement, le chiffre de progression de notre empreinte écologique est cohérent avec cette explosion.
Vous citez même une possibilité d’atteindre 20 % de l’électricité mondiale consacrée à tout ce qui tourne autour du numérique d’ici à 2025. C’est énorme.
Oui, c’est énorme. Ces chiffres datent d’avant la pandémie, et nous sommes sur une tendance en hausse, c’est absolument certain. C’est un sujet auquel s’attaquent les GAFAM et l’industrie numérique, à savoir le verdissement de leur mix électrique en faisant en sorte de recourir à moins de charbon, moins de pétrole, moins de gaz naturel, plus de technologies vertes ou nucléaires qui puissent servir, nourrir notre consommation d’électricité. Et donc force est de reconnaître que des efforts sont faits pour que le mix de l’industrie numérique soit plus vert que le mix moyen mondial. Mais il faut s’attendre à ce que ces chiffres soient toujours plus élevés à l’avenir.
Vous vulgarisez aussi le cheminement d’un like, pour ne prendre que cet exemple-là, en expliquant que si vous envoyez un like à votre voisin ou à votre voisine d’en face, ce n’est pas forcément 3 à 4 mètres qui sont parcourus, mais bien plus que ça. Si j’ai bien compris, vous avez vraiment suivi tout le cheminement géographique de nos clics ?
Comment parle-t-on de cette pollution qui est invisible, impalpable, qui échappe à nos sens, qui est si difficile à percevoir et sur laquelle les mots mêmes sont compliqués à trouver puisque en fait, nous n’y sommes pas confrontés sensoriellement parlant ? C’est beaucoup plus difficile de percevoir cette pollution que ça ne l’est de percevoir celle d’une usine d’électricité qui tourne au charbon ou d’un pot d’échappement. J’ai donc suivi le cheminement d’un like, en passant par tous les maillons de l’infrastructure que sont les routeurs, les antennes 4G, les box, mais également les centres de stockage de données, les éventuels satellites, les câbles souterrains, les câbles sous-marins, et tout à coup, ça devient beaucoup plus concret de se confronter à l’infrastructure et on peut littéralement la toucher, on peut la sentir, on peut l’écouter. C’est alors là aussi que j’ai voulu y confronter mes cinq sens. C’est un peu poétique de dire qu’Internet a un goût, une odeur, une couleur, mais au fond, c’est vrai.
Et donc ce like parcourt des milliers de kilomètres avant de parvenir à sa cible.
On va prendre l’exemple de vous et moi, puisque notre conférence se fait à distance. Je suis à Paris, à quelques centaines de kilomètres de vous. Pour le fonctionnement de Skype, il y a de fortes chances que la donnée parte de la box – je suis en WiFi –. Depuis celle-ci, elle va descendre par la fibre optique, puis sur le trottoir du 10e arrondissement de Paris où je me trouve actuellement, elle va probablement ensuite filer l’information (nos données, les images, les sons que nous échangeons) le long de certaines voies de communication françaises, fleuves, autoroutes et ces données seront sans doute conservées dans des centres de stockage en dehors du territoire français. Ces données emprunteront certainement des câbles sous-marins qui sont déployés sous l’Atlantique pour rejoindre les États-Unis, y seront stockées dans plusieurs centres pour éviter que tout le trafic soit arrêté si un centre de stockage venait à tomber en panne. Et ces données feront le chemin en sens inverse pour aller jusqu’à vous. En réalité, ce ne sont pas quelques centaines de kilomètres que vont parcourir les images que nous échangeons, mais plusieurs milliers de kilomètres. Derrière quelque chose d’aussi simple et d’aussi facile à gérer qu’une discussion sur Skype ou un like, il y a toutes ces infrastructures dont nous ignorons tout et qui sont d’une gigantesque complexité, aux antipodes de la facilité avec laquelle on utilise ces outils aujourd’hui.
Nous ignorons que nos données ont un fabuleux impact géo-écologique, finalement.
Il y a en effet une géographie de nos données, avec une infrastructure qui est hyper-tangible. Les concepteurs du réseau, les fabricants de câbles, les entreprises qui les déploient au fond des océans, mais aussi les constructeurs de data centers connaissent l’importante de cette distance et de la latence que cela implique sur la capacité de la vidéo que nous regardons à ne pas ramer, à ne pas fonctionner par paquets. Ce sont également les enjeux de souveraineté qui se jouent lors des étapes dans les pays qui acceptent ou non que les infrastructures soient installées sur leur territoire ou qui veulent que les données qui y sont produites n’en sortent pas. C’est intéressant car plus on parle d’un outil qui a l’air de se jouer des frontières, du temps et de rapprocher les hommes, plus on se rend compte que chaque État fait imposer ses droits de souveraineté.
En revanche, s’agissant des données personnelles, c’est difficile de savoir qui a réellement la mainmise dessus. Et cela risque de le devenir encore davantage à l’avenir.
Concernant nos données personnelles, il y a deux catégories d’acteurs : d’abord, les entreprises qui savent très bien dans quel esprit, avec quel objectif elles ponctionnent les données des utilisateurs. Comme nous dit l’adage, « si c’est gratuit, c’est toi le produit ». Vous échangez donc des données via votre activité numérique en échange de cette pseudo-gratuité. Ces données sont des morceaux de qui vous êtes, de vos activités, de vos centres d’intérêt, etc. Elles valent de l’or puisque après elles sont traduites en informations et vous allez être l’objet d’une publicité ciblée vantant un produit qui justement a attiré votre attention précédemment sur le Web. Et puis il y a les acteurs publics. Des États comme les États-Unis, la Chine, les pays européens dans une moindre mesure, connaissent l’intérêt des données pour leur propre usage et les enjeux politiques. Il ne faut pas oublier que l’extraterritorialité souvent revendiquée par le département de la Justice américain peut également se fonder sur le fait que des e-mails pourraient être retenus en justice contre vous, et qu’ils ont été stockés sur le territoire américain alors que vos activités ont lieu en France. Donc il y a une géopolitique de l’e-mail. Et puis il y a aussi, naturellement, derrière tout cela une infrastructure qui est déployée pour le besoin de la surveillance. Nous stockons toutes sortes de données, notamment via nos requêtes sur Google et ainsi de suite. Tout cela, effectivement, ce sont des données dont les États savent se servir et l’Europe est peut-être en retard par rapport à cela, même si elle a très bien compris la nécessité de protéger sa production de données face à la rivalité étrangère.

Vous attirez aussi notre attention, dans votre livre, sur l’accroissement des smart cities, à savoir le recours à l’intelligence artificielle pour « améliorer » l’utilisation de nos villes, mais avec l’emploi potentiellement abusif des données personnelles.
Je n’ai pas étudié le lien entre smart city et surveillance ou abus d’utilisation de nos données personnelles, mais c’est sûr que les smart cities emploient des technologies qui ne pourraient fonctionner sans ponction énorme de données. La ville intelligente, c’est une ville connectée, c’est une ville dans laquelle demain la gouvernance se fera toujours plus en ligne, notamment grâce aux capteurs connectés qui permettent de saisir en temps réel le trafic à un feu rouge ou à un carrefour et de moduler la fréquence des feux. Cela est utile pour résoudre des tas de problèmes d’embouteillages. Ce sont aussi les immeubles connectés avec un thermostat intelligent qui règle la température dans les immeubles en fonction de l’ensoleillement, ce qui permet des gains d’électricité. Donc il y a un immense impact positif, à l’échelle locale en tout cas, ce qui n’est peut-être pas le cas à l’échelle internationale. Les villes connectées offrent un cadre de vie plus agréable à la moitié de l’humanité qui vit dans les centres urbains. Mais demain, ce sera 70 % de la population mondiale qui vivra en ville, ce qui étend cette connectivité et donc les stocks d’informations, les datas centers et ainsi de suite. Attention aux discours naïfs.
Illustration : Philippe Joisson
Vous citez un autre exemple dans ce domaine-là : l’emploi des images satellitaires qui ont permis de trouver la source d’émission de gaz CFC qui continuent à être émis en Chine malgré leur interdiction. Épinglons aussi les capteurs et images satellitaires qui permettent de voir d’où sont émis les gaz à effet de serre, et donc les pays qui ne respectent pas les quotas qu’ils prétendent observer.
C’est positif. Cela permet de mieux calculer et de modéliser l’évolution du climat à l’horizon 2100, d’apprécier l’acidification de l’océan, de suivre une population de thons en Méditerranée et de savoir si elle se renouvelle ou si elle se rarifie, si la Grande Barrière de corail au large de l’Australie est en train de se régénérer ou de se dégrader. Ces technologies d’observation de la planète sont absolument sensationnelles. En fait, l’accélération de la numérisation des choses, du monde, est souvent présentée comme étant inévitable puisqu’elle va apporter ce type de bienfaits là. C’est un discours qui est bien organisé, très bien pensé sur ce que le numérique va fournir. Mais cet argument à la fois écologique et au service de la vie humaine est un double argument qui écrase tout sur son passage. On est obligé, comme un seul homme, de se tourner et d’accélérer dans cette direction sans que jamais un débat plus affiné n’ait été proposé dans lequel on se demanderait aussi ce que le numérique va nous coûter sur le plan environnemental ou sur d’autres aspects. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de débats sur les réseaux sociaux concernant l’impact que cela peut avoir sur les fakes news et sur notre démocratie, mais je crains que derrière l’idée que le numérique va sauver la planète, ce qu’on a beaucoup entendu à Glasgow à la COP26, finalement, on nous pousse à prendre d’un seul bloc une technologie qui présente aussi des aspects négatifs. Je pense que les citoyens ne sont pas assez considérés dans l’affaire et j’ai le sentiment qu’on s’adresse à des masses de consommateurs, avec le souci de satisfaire leur propre intérêt égoïste alors qu’en fait, il y a un véritable débat citoyen qui doit s’ouvrir sur l’ensemble de ces technologies, avec une approche plus collective de la question.
L’intelligence artificielle au service de la planète, nous permettant de lutter contre le réchauffement climatique, ça sonne très bien, en effet. Mais quels sont finalement les risques qui pourraient en découler ? Et qu’en est-il du choix sociétal et éthique qui se pose à nous ?
Mais absolument, et c’est là qu’on voit en fait que la technologie n’est jamais qu’à l’image de son créateur, c’est-à-dire de la nôtre. Elle n’est rien de moins qu’une technologie qui amplifiera notre legs aux générations futures et qui amplifie nos actions, les pires comme les meilleures.
Comment le réchauffement climatique pourrait-il être jugulé par l’utilisation de l’intelligence artificielle ? Quels pourraient être les effets négatifs ?
Ce qui est fascinant, c’est qu’il faudrait une intelligence artificielle forte qui ait presque conscience de son existence, afin d’agencer une politique de lutte contre le réchauffement climatique pour deux cents ans. C’est plutôt probable qu’elle n’existera pas. Néanmoins, ce qui est intéressant, c’est de voir cette idée de bien au service de la planète exploitée jusqu’au bout, en poussant cette logique d’une technologie qui se permet de tout régler, puisque le cerveau humain ne semble pas prendre la mesure de la complexité du réchauffement climatique qui est multicritère, voire il n’en a pas forcément envie parce que cela va à l’encontre de son intérêt à court terme, alors effectivement, l’IA serait plus sage pour résoudre la question. Si l’on pousse à l’extrême cette croyance en une technologie capable de régler tous les problèmes, cet argument justifie d’accélérer la production de données. Mais le risque, c’est la déresponsabilisation et c’est cela que l’on sent déjà lorsqu’on s’intéresse à la façon dont on peut se cacher dans le monde bancaire derrière certains algorithmes pour laisser tourner les stratégies d’investissement qui ne sont pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique, avec des robots qui soi-disant décident, alors qu’en fait, ce sont les mathématiciens qui décident en amont. Outre la déresponsabilisation, il y a un risque de ne plus forcément bien comprendre le monde dans lequel nous vivons, parce qu’il serait « médié » par des outils dont la logique nous échappe. Je fais mention dans le livre de ce séminaire qui s’est tenu en 2019 à Oxford où l’on a posé cette question philosophique : est-ce que dans un souci de préserver la planète, on aurait plus intérêt à détruire l’être humain ? Question tout à fait théorique, mais il faut l’avoir en tête à l’instant où l’on investit des milliards dans ces technologies.
Il y aurait également un risque de nous plonger dans un système autocratique, la seule façon de réglementer nos actions pour permettre de décarboniser la planète ?
Ce peut être le risque, mais effectivement, si la machine a toujours raison, alors pourquoi ne lui céderions-nous pas une part de notre libre arbitre puisqu’elle ferait les choses mieux que nous ? Je prends un exemple tout simple, j’ai cessé de me battre contre Google Maps, car à diverses reprises, en l’utilisant pour me diriger dans une ville, j’ai refusé de tourner à gauche parce que je voyais un embouteillage, et en réalité, il y avait plus d’embouteillages à la prochaine gauche. Et même quand je lutte intérieurement en me disant : « Mais non, le bouchon est annoncé à 10 km, il n’aura peut-être pas lieu », en fait il a toujours lieu. Donc est-ce que finalement je n’ai pas cédé une partie de mon libre arbitre à la machine qui m’emmène précisément sur cette route et pas sur telle autre, et est-ce que ce n’est pas le début d’une forme de déresponsabilisation ou de démission face à cette machine ?
Dans votre livre, vous parlez aussi des « purges électroniques », du fait que le matériel soit jeté à cause de suspicions d’espionnage via des puces qui seraient intégrées dans les ordinateurs, nos téléphones ou d’autres objets connectés par la Chine, les États-Unis. Est-ce de la paranoïa ou avons-nous vraiment des preuves de ce type de pratiques ?
Je ne suis pas un expert en cybersécurité donc je ne vais pas me risquer à faire autre chose que de constater ce que certains États disent, craignent, croient savoir. Mais d’un côté, vous avez quand même des cœurs de réseaux 5G qui ont été démontés aux États-Unis, en Angleterre parce qu’il y avait cette crainte que Huawei puisse, avec ces équipements, capter les données échangées par les consommateurs européens pour le profit de ses entreprises ; des suspicions qui sont fortes. Mais en retour, et c’est vrai dans le sens inverse, les Chinois ont de bonnes raisons de penser que les équipements américains hardware, sur lesquels se trouvent des logiciels américains software qui servent notamment pour les administrations chinoises, ou dans certaines banques, pourraient comporter des mouchards. Je ne fais que constater que ces suspicions entre États sont très fortes et les prendre au sérieux quand on voit aujourd’hui à quel point l’enjeu de la cybersécurité pour les États est devenu important. Il y a deux cas qui sont avérés, côté chinois et côté américain, de générations de matériels entiers qui sont en fait « purgés » et dont on se débarrasse alors qu’ils sont fonctionnels, voire neufs, car justement il y a cette suspicion. Ce sont des purges électroniques qui sont fondées sur la nationalité de l’équipement. Cet enjeu de sécurité va générer un gaspillage écologique absolument monstre, avec des dizaines de millions d’équipements qui disparaissent tout à coup de la circulation en l’espace de quelques mois ou années.
Vous tirez aussi la sonnette d’alarme par rapport à l’utilisation de la 5G qui permet un emploi encore plus considérable de l’intelligence artificielle, mais qui génère également autant d’émissions de CO2 que cinq voitures durant tout leur cycle de vie. Là encore, cela entraîne une empreinte écologique très importante.
Il est intéressant de constater l’effet rebond, avec des technologies qui sont toujours plus efficientes, qui objectivement permettent à consommation constante de faire baisser notre consommation d’électricité, mais comme elles sont de plus en plus puissantes, elles vont générer une surconsommation de données et de nouveaux usages. Donc l’effet rebond, c’est ce paradoxe qui a été lancé par Stanley Jevons au xixe siècle, qui avait constaté que l’amélioration du fonctionnement des locomotives qui consommaient moins de charbon n’aboutissait pas à une moindre consommation, mais au contraire à davantage de consommation de charbon car on mettait de ce fait encore plus de locomotives sur les rails du réseau ferroviaire britannique. C’est pareil avec la 5G qui ouvre la voie à une nouvelle façon de consommer des données, avec toujours plus de volumes, avec des milliards d’objets communicants et autonomes et qui vont produire et s’échanger des données. Étant donné cette situation, je ne vois rien qui rende la question de la 5G, et généralement de l’Internet qui se développe aujourd’hui, compatible avec un seul des engagements qu’on a pris à Paris. Actuellement, on peut toujours dire au détour de la COP26 que l’IA est mise au service de la planète, mais c’est du marketing qui permet de justifier une technologie. La réalité étant que le cœur de métier de la technologie, c’est l’enrichissement, et une domination éventuelle de tel ou tel pays d’un point de vue financier ou d’un point de vue géopolitique, mais en aucun cas la protection de l’environnement. L’environnement là-dedans est presque un non-sujet compte tenu des enjeux géo-économiques et géopolitiques que génèrent ces technologies.
Dans votre livre, vous évoquez aussi le recours aux robots et à des choix d’algorithmes, notamment dans le monde de la finance, qui accroissent encore la pollution avec celle générée par leur emploi. Pourriez-vous résumer quel est l’enjeu sur ce point ?
Tout est parti de l’entreprise MCADA, située au Canada, qui avait été listée parmi les entreprises les plus émettrices de CO2. Compte tenu de ce classement, elle était moins sujette à des investissements provenant de la part d’investisseurs humains soucieux du réchauffement climatique. MCADA s’est déplacée vers Denver, car la Bourse de Denver est une Bourse davantage prisée par des investisseurs passifs qui n’ont pas d’états d’âme et qui investissent dans des paquets d’actions qui suivent les fonds indiciels. Son P-DG m’a expliqué que finalement la finance passive, c’est-à-dire la finance algorithmique, est un meilleur allier pour les entreprises polluantes que la finance active dans laquelle ce sont des humains qui tiennent la barre. Ce qui est confirmé par l’ONG britannique InfluenceMap. La tentative d’explication qu’on peut donner à cela, c’est que les fonds indiciels étant automatisés, la variable humaine et émotionnelle disparaît. Mais en amont, il y a des mathématiciens qui, froidement, ont mis en place ces algorithmes et qui ensuite peuvent se cacher derrière pour ne pas avoir leur responsabilité directe mise en cause. En fait, on laisse la lutte contre le réchauffement climatique en pilotage automatique, avec des outils qui tournent, même s’ils ne prennent pas les bonnes décisions. Il y a finalement une espèce d’indifférence, une distance dans l’appréciation de la responsabilité directe humaine dans ces enjeux-là, qui sont « médiés » par des algorithmes. C’est un écran de déresponsabilisation supplémentaire.
Partager cette page sur :
