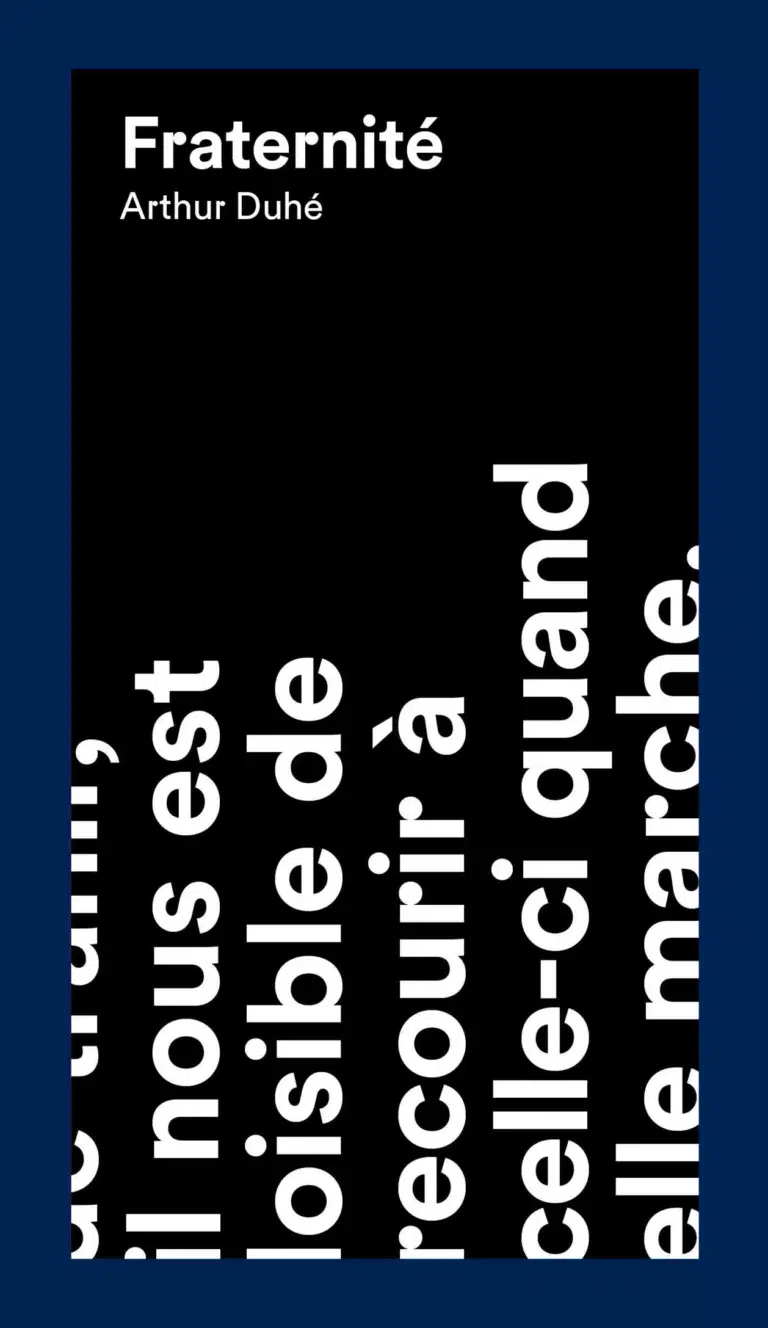Accueil - Exclus Web - À table -

Bien chers frères
Catherine Haxhe · Journaliste
Mise en ligne le 27 octobre 2025
La fraternité des nations, qui oubliait la majeure partie des populations, offre un exemple d’exclusion largement implicite. D’autres exclusions furent ouvertement débattues durant la révolution de 1848 : les femmes furent-elles des frères comme les autres ? »
Connaissez-vous Anamosa, cette maison d’édition spécialisée en essais et en sciences humaines et sociales ? « Anamosa » vient du sauk, une langue amérindienne, et signifie « Tu marches avec moi ». Dans un monde où l’on fait de moins en moins de pas ensemble, et a fortiori dans la même direction, la collection « Le mot est faible » d’Anamosa fait décidément un bien fou. Des ouvrages courts et incisifs qui s’emparent d’un mot dévoyé par la langue au pouvoir, pour l’arracher à l’idéologie. Après Universalisme1 ou Laïcité2, pour ne citer que ceux décortiqués dans nos pages, la Fraternité d’Arthur Duhé nous plonge au cœur de la devise de la République française : « Liberté, égalité, fraternité ». Wech frérot, lis-moi ça !
Quand on y pense, des trois termes, c’est le dernier qu’on interroge le moins. Pourtant, qui n’adhère pas à la fraternité ? Qui n’a pas croisé, la semaine dernière, un ado affublant d’un joyeux « frère » copains, pères, mères, et même… sœurs ? Que cache cette unanimité pour la fraternité, frérot ? Du Cercle fraternité, animé par des soutiens du FN depuis 2016, à Jean-Luc Mélenchon, qui salua la consécration de la constitutionnalité du principe de fraternité en 2018 à la suite du procès de Cédric Herrou, l’ensemble du monde politique français se réclame de la fraternité. Pour autant, si tous la louent, il est plus rare qu’elle soit clairement définie.
Cette apparente unanimité face à une fraternité aux contours flous est-elle suspecte ? L’ouvrage d’Arthur Duhé, docteur en relations internationales et chercheur postdoctoral à Paris 8, documente les variations dans les usages de la notion ainsi que les critiques à son encontre. Pour ce faire, il remonte à 1848, durant le Printemps des peuples, lorsque les révolutionnaires français comme étrangers s’approprièrent le lexique de 1789, dont la notion de fraternité. Celle-ci permettait d’imaginer tant l’unité de la communauté nationale que des relations pacifiques entre nations. Mais durant son apogée, la fraternité n’en fut pas moins fortement contestée.
En faisant la synthèse des ambiguïtés et des manques de la fraternité de 1848, le livre montre cette notion comme une illusion nationaliste, comme une exclusion des femmes hors de la communauté civique, et comme une infantilisation des anciens esclaves dans les colonies. Arthur Duhé convoque d’ailleurs la sororité, à laquelle un chapitre est consacré, en réponse aux manques de la fraternité. Si elle pose la question de l’exclusion des femmes, elle rencontre néanmoins certaines tensions communes à la fraternité. Ainsi, fraternité et sororité ne sont pas des valeurs qui guident les combats, mais des outils pour les luttes. Comme les mots de cette collection d’Anamosa, qui peuvent être des armes… à condition, comme le disait George Orwell, de ne pas capituler devant eux.
- Cf. Sandra Evrard, « Repenser l’universalisme au-delà des Lumières », mis en ligne sur edl.laicite.be, 17 juin 2022.
- Cf. Louise Canu, « Laïcité à la sauce néo-républicaine », mis en ligne sur edl.laicite.be, 13 novembre 2023.
Partager cette page sur :