Libres, ensemble
Liberté de la presse :
des médias européens
sous pression
Catherine Haxhe · Journaliste
Mise en ligne le 3 mai 2025
Que faites-vous ce 3 mai ? Et si vous pensiez à la liberté d’écrire, de s’informer, de s’exprimer ? Voilà, vous allez avec nous fêter la liberté de la presse. Car le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993.
Photo © Andrey Popov/Shutterstock
Cette journée sert à rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Et à nous, journalistes, elle invite à la réflexion sur notre éthique professionnelle. Plus globalement, cette journée est aussi l’occasion de soutenir les médias de plus en plus les cibles sous pressions politiques, victime de la désinformation et de l’érosion de leur indépendance. Voilà, vous savez de quoi sera fait votre 3 mai à l’avenir.
Pressions politiques
Le phénomène de pression sur les médias de la part du politique n’est pas neuf, pour autant, ne s’amplifie-t-il pas ? Un rapport publié par la plateforme pour la sécurité et la protection des journalistes du Conseil de l’Europe vient de sortir. Jean-Paul Marthoz, journaliste et essayiste, militant pour les droits humains, en a été le coordinateur éditorial. Ce rapport sur la liberté de la presse en Europe fêtait cette année dix années d’existence. Mais le temps n’est pas à la fête. Les choses s’aggravent à pas de géant.
« On assiste à une dégradation généralisée de la liberté de la presse en Europe, bien que différentes selon les pays, témoigne Jean-Paul Marthoz. Une dégradation de la situation des journalistes, de leur sécurité juridique et physique. Ça s’exprime de diverses manières, soit par des procès, par le harcèlement, par la critique du monde politique à l’égard des médias, par la volonté d’affaiblir un certain nombre de médias dissidents ainsi que le service public de radio-télévision. En 2024, il y a aussi eu des élections dans pas mal de pays européens qui ont confirmé la montée en puissance des mouvements d’extrême droite ou nationaux populistes. »
Selon Jean-Paul Marthoz il ne s’agit plus de cas isolés d’hommes politiques qui s’en prendraient pour des raisons personnelles aux médias, mais d’une stratégie pensée pour affaiblir la liberté de la presse et le travail des journalistes. Il s’agit d’une attaque directe au rôle que la presse est censée jouer en démocratie dans l’information aux citoyens pour que ceux-ci puissent réellement exercer leurs droits au sein d’une société démocratique.
« C’est aussi mettre en cause plus largement des contre-pouvoirs qui sont essentiels à un système démocratique. Nous sommes dans une stratégie en Europe qui ressemble à celle mise en place aux États-Unis depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, comme la constitution d’un système de plus en plus concentré sur le pouvoir exécutif et qui conteste le droit à des contre-pouvoirs qui définissent la démocratie libérale. Un pouvoir exécutif qui nie la légitimité du pouvoir parlementaire, du pouvoir judiciaire, de la presse, en invoquant essentiellement la liberté d’expression et la majorité populaire qu’ils ont reçue dans urnes. On assiste à un système de perversion du discours sur la démocratie en disant « on a gagné les élections, on a tous les droits ». Cette politique est hostile à toute information de qualité, indépendante, qui permettrait à la population de choisir ses représentants et de s’insérer dans le jeu politique. »

Le dernier rapport réalisé par la Ligue des droits humains relatait déjà une inquiétude par rapport à la liberté de la presse et évoquait des procédures judiciaires, de la censure.
Un triste anniversaire
Ricardo Gutierrez est secrétaire général d’une des associations de la Plateforme ayant contribué au rapport, la Fédération européenne des journalistes représentant 320 000 journalistes dans 43 pays. « Ce rapport-ci est important parce qu’il est le dixième », précise-t-il. « Cela nous permet d’avoir une vue transversale sur l’évolution de la liberté de la presse en Europe. Moi, ce qui m’a semblé essentiel, c’est d’avoir ouvert les yeux des vieilles démocraties libérales sur le fait qu’elles aussi étaient concernées. Elles ont enfin réalisé que les problèmes de liberté de la presse n’étaient pas l’apanage de la Turquie ou de l’Azerbaïdjan, la Russie ou la Biélorussie. Il y a eu, au cours de ces dix dernières années, en Grèce, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni, des journalistes assassinés. Ce sont des choses qui n’existaient pas auparavant. »
Un classement basé sur le nombre d’alertes d’attaques à la presse par pays a été dressé. En tête de gondole la Turquie, suivie de la Russie, puis de l’Ukraine. Mais en sixième position, on retrouve la France et en septième l’Italie. Des chiffres qui étonnent et font froid dans le dos. Sont évoquées les attaques systémiques et les législations restrictives.
« La diffamation est toujours une peine criminelle en Italie, poursuit Ricardo Gutierrez. « Affirmer quelque chose qu’on ne peut pas prouver peut mener un journaliste en prison. Donc toute enquête de fond est limitée. Cela génère un climat d’insécurité et même une autocensure. Il y a aussi les SLAPP (de l’anglais Strategic Lawsuits Against Public Participation, NDLR), les procédures judiciaires abusives lancées par les détenteurs de pouvoir de tout ordre, visant non pas à obtenir gain de cause en justice, mais à empêcher un journaliste de continuer à faire son travail en l’accablant de poursuites en justice ou devant des instances déontologiques.
Le rapport publié par la plateforme pour la sécurité et la protection des journalistes du Conseil de l’Europe est consultable par tous sur le site de la Plateforme pour la sécurité des journalistes.
© Mr Tact Hill/Shutterstock
Pour Ricardo Gutierrez et Jean-Paul Marthoz, il ne s’agit pas simplement d’empêcher un journaliste de faire son travail mais plutôt de le discréditer. Pas de fumée sans feu. Toute action via un cabinet d’avocats à l’encontre d’un journaliste, aggrave la perception négative que l’opinion publique va porter, d’un regard distrait, sur la presse. Il existe à Londres des cabinets spécialisés dans le harcèlement judiciaire des journalistes.
« Et c’est un des plus graves dangers aujourd’hui contre la liberté de la presse et le rôle de la presse en démocratie », ajoute Jean-Paul Marthoz. « La perte de popularité, de confiance, de crédibilité des journalistes au sein de l’opinion public. C’est par là que le totalitarisme s’installe aussi. Au journaliste qui demandait à Donald Trump lors de son premier mandat « pourquoi vous attaquez vous constamment aux médias? », il a répondu : « Je vous attaque tout le temps parce que lorsque vous direz des choses négatives sur moi, personne ne vous croira. » »
Une crédibilité journalistique menacée
Ricardo Gutierrez poursuit : « La grande philosophe allemande, qui était aussi une grande journaliste, Hannah Arendt avait étudié la manière dont la propagande nazie fonctionnait. Elle expliquait très bien que le but de la propagande n’était pas uniquement de diffuser des mensonges mais aussi de créer un écran de fumée, visant à instiller le doute en tout. Pousser le peuple à ne plus croire en rien, y compris en ceux qui sont légitimement en charge de chercher la vérité. » Nos spécialistes sont clairs, nous voici dans une nouvelle rhétorique. Celles des puissants de la tech et de la politique.
Lorsqu’au lendemain de l’élection de Trump, Elon Musk poste un tweet proclamant « we are the media now, you are the media now », vous, les utilisateurs de X, vous êtes les médias, il affirme bel et bien que les médias traditionnels sont morts. Place à l’alliance sans précédent entre l’homme politique le plus puissant du monde en terme militaire et financier qu’est Donald Trump et la big tech à la capacité d’influence mondiale terrible et hostile depuis toujours à la presse indépendante. Nous sommes dans l’ère de la post-vérité.
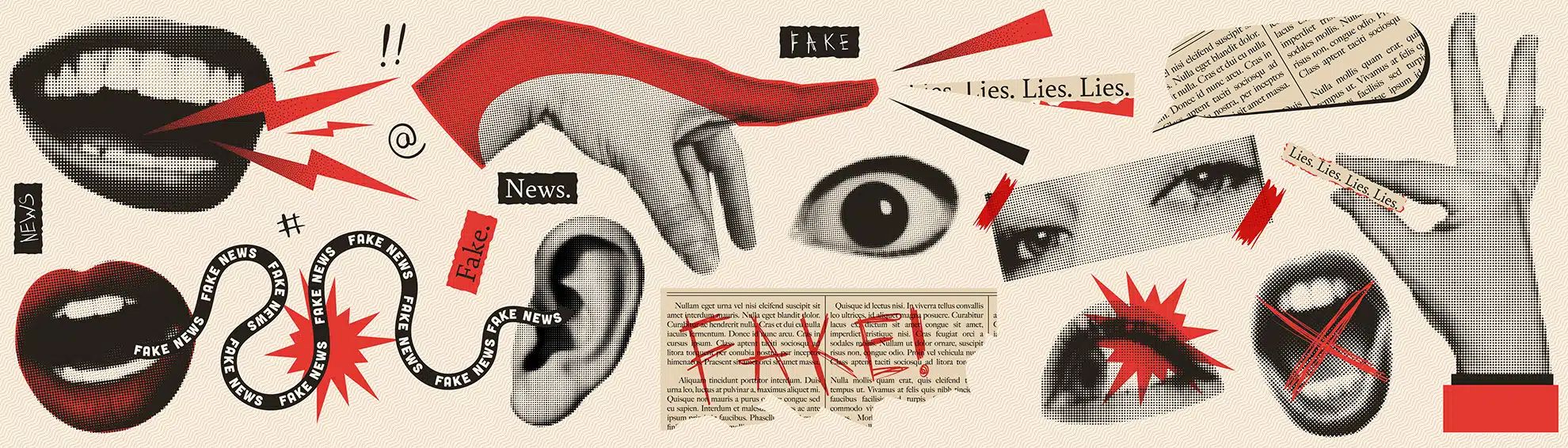
« Flood the zone with shit ! » (traduction: « Inondez la zone avec de la m…»), conseille Steve Bannon.
© Alina Kolyuka/Shutterstock
Jean-Paul Marthoz va plus loin et met en garde : « Un des grands problèmes qu’on n’a peut-être pas bien évalué, est l’évolution néfaste de la relation entre la big tech et la presse. Pendant un certain temps, les hauts dirigeants de la tech ont joué la carte de la liberté de la presse : ils ont prétendu la soutenir. Mark Zuckerberg pendant des années a soutenu le fact-checking qui était perçu par nous journalistes et par pas mal de défenseurs des démocraties comme un élément central dans la tentative de repousser cette avalanche de désinformation sur les réseaux sociaux. Et maintenant tout a changé, parce qu’il estime que ce changement aux États-Unis ce n’est pas un changement épisodique, que c’est un mouvement de fond, que c’est un basculement, il a fait volte face en le supprimant. »
« Et tant que le monde politique, qui tient encore à une démocratie de type libérale, n’aura pas cerné ce que signifie ce pouvoir technocratique, technologique, je pense qu’on est vraiment très mal parti. La presse traditionnelle va se ratatiner de plus en plus pour laisser l’espace ouvert à ce chaos de l’information qui circule sur les réseaux sociaux, et qui est un chaos organisé. Il faut défendre plus que jamais cet îlot unique de régulation démocratique des réseaux sociaux qu’a instauré l’UE à l’échelle globale ». Depuis quelques mois, l’Europe fait face à une action concertée des grandes plateformes refusant la régulation européenne. C’est très clair : ils n’en veulent plus. Dans cette configuration, que peut-elle faire ? Créer d’autres plateformes ? En voilà un travail colossal ! C’est limpide, l’Europe manque d’autonomie dans ces matières là aussi.
Les contre-pouvoirs sont essentiels au système démocratique.
© Jorm Sangsorn/Shutterstock
« Je pense que c’est un des premiers tests pour l’Union européenne », poursuit Ricardo Gutierrez. « Est-ce que nous allons tenir avec notre régulation à l’échelle globale? Notre Digital Services Act est un des rares exemples souvent cité en exemple par les démocrates, par ceux qui défendent la démocratie et la liberté de la presse. Ou vat-ton céder à la pression des plateformes alliées aujourd’hui à Donald Trump ? Accompagnant Ricardo Gutierrez et Jean-Paul Marthoz dans leur raisonnement, d’aucuns disent aujourd’hui que lorsque l’on défend la liberté de la presse et la démocratie libérale, l’accusation de censure fuse. La liberté, rappelle Jean-Paul Marthoz, c’est un mot qui permet plus souvent de défendre non pas la liberté d’expression mais la liberté de la haine et de l’incitation à la discrimination.
Une résistance citoyenne émergeante
On le remarque autour de nous, de plus en plus de citoyens abandonnent leur compte X pour passer à Blue Sky ou Mastodon, veulent éviter WhatsApp pour communiquer via Signal. Ils font le choix d’autres plateformes plus éthiques, s’abonnèrent à des journaux indépendants et engagés. Une conscience émerge, elle voudrait soutenir la presse et les journalistes. Mais les effets des attaques du politique sur la presse mainstream sont pour autant bien visibles. Beaucoup d’autres ne veulent plus accéder à l’information par les médias classiques, la confiance est rompue.
Ricardo Gutierrez précise : « Dans la dernière version du Digital News Report, le grand rapport publié par le Reuters Institute, un institut de recherche attaché à l’Université d’Oxford qui étudie les médias dans le monde et donc en Europe, un résultat est particulièrement interpellant. C’est celui de la part de la population qui évite les médias. On arrive dans certains pays d’Europe à 40 % de la population. En Allemagne, en Espagne, la population dit : « Moi, quand le JT commence, je coupe la télé ». C’est terrifiant, car c’est exactement ce que les régimes totalitaires cherchent. »
Si la presse n’est pas libre, nous ne le serons pas davantage.
© Leolintang/Shutterstock
« Or, j’ai l’impression que les journalistes, aujourd’hui, sont bien plus conscients », conclut Jean-Paul Marthoz, « des enjeux politiques et déontologiques et respectent d’ailleurs nettement mieux la déontologie qu’ils ne le faisaient auparavant. Il faut peut-être organiser le combat pour une presse libre plus largement et de concert avec d’autres institutions, d’autres secteurs qui, dans le système démocratique, jouent un rôle aussi important que le journalisme. Ouvrir le spectre et s’associer à d’autres mouvements qui défendent eux aussi, parce que c’est l’objectif réel, la démocratie libérale. »
Libres, ensemble · 22 mars 2025
Partager cette page sur :
