La tartine
Les populismes
au prisme de la
« démocratie totalitaire »
Par Bernard Bruneteau · Professeur émérite de science politique à l’Université Rennes 1
Mis en ligne le 18 mars 2024
Progressant électoralement depuis une trentaine d’années, les partis et mouvements populistes catégorisés à l’« extrême droite », et généralement associés à une menace pour la démocratie, se caractérisent paradoxalement par une référence à la « vraie » démocratie qu’ils se targuent de promouvoir. Au temps où les institutions représentatives connaissent une crise de légitimité, le retour sur le concept de « démocratie totalitaire » peut être éclairant.
Illustrations : Max Tilgenkamp
L’air du temps européen du nouveau siècle est indiscutablement marqué par la progression de ce qu’il est convenu d’appeler paresseusement « extrême droite ». Qu’il s’agisse des élections générales internes ou des élections européennes, les scores à deux chiffres s’additionnent. Tous les pays du continent sont concernés, Union européenne et hors UE (Norvège et Suisse notamment), avec une trentaine de partis et mouvements recensés. Pour ceux-ci, les élections européennes sont une occasion particulièrement rêvée pour se compter et se poser en alternative radicale face aux partis établis.
En 2009, ils ont réalisé des scores supérieurs à 10 % des voix dans sept États membres : Pays-Bas, Belgique, Danemark, Hongrie, Autriche, Bulgarie, Italie. En 2014, la vague s’est étendue avec des pointes à 24,2 % en Suède (Démocrates de Suède), 26,6 % au Danemark (Parti du peuple), 24,9 % en France (Front national), 14,7 % en Hongrie (Jobbik),27 % en Autriche (Parti de la liberté), 12,9 % en Finlande (Vrais Finlandais), 13,3 % aux Pays-Bas (Parti pour la liberté)… Et en 2019, si la progression a été contenue, des ancrages se sont consolidés, notamment en Italie (la Ligue et Frères d’Italie 40,6 % à eux deux) et en France (Rassemblement national, 23 % mais 500 000 voix de plus…), avec des partis qui se retrouvent au Parlement européen dans le groupe Identité et démocratie.
Des évolutions politiques nationales ont traduit récemment cette dynamique de fond avec la progression fulgurante des Frères d’Italie et la nomination de sa dirigeante Giorgia Meloni comme cheffe du gouvernement ou, le 22 novembre 2023, l’arrivée en tête des élections législatives néerlandaises du Parti pour la liberté de Geert Wilders avec 23,5 %, doublant son précédent score. Ces cohortes d’électeurs votent-elles en pleine conscience pour une « extrême droite » associée à l’anti-démocratie dans l’imaginaire européen ?
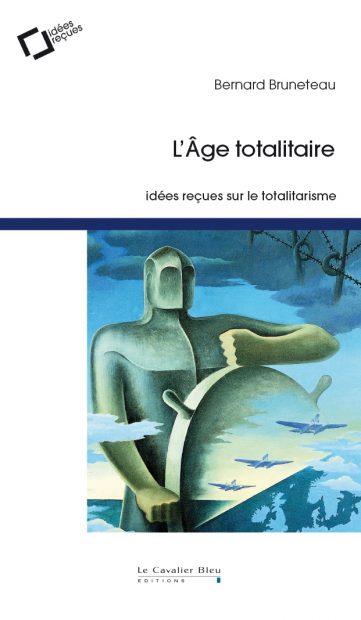
Bernard Bruneteau, L’âge totalitaire. Idées reçues sur le totalitarisme, Paris, Le Cavalier bleu, 2017 (2e édition), 184 pages.
Extrême droite ou populismes
Le qualificatif d’« extrême droite » est-il valide pour rassembler dans une même catégorie des formations évoluant dans des contextes nationaux hétéroclytes, possédant des origines diverses, cultivant des mémoires différentes ? Est-il par ailleurs légitime de relier ces partis qui se coulent tous dans des dispositifs parlementaires à une extrême droite historique qui s’assimile pour le sens commun au nationalisme antisémite, au racisme et à l’autoritarisme, voire aux anti-Lumières ? Qualificatif stigmatisant propice à l’instrumentalisation afin de disqualifier des compétiteurs, la catégorie de l’« extrême droite » a une faible valeur scientifique, posant problème aux historiens et politologues qui ont dénombré jusqu’à vingt-sept définitions pour décrire les mouvements supposés relevant de cette famille politique. D’autres dénominations sont donc nécessaires et l’on doit parler, au pluriel, de « droites radicales », de « droites nationalistes » ou de « populismes de droite » (ou « national-populismes »). Cette dernière appellation, proposée par Pierre-André Taguieff, devrait avoir nos faveurs dans la mesure où ces populismes acceptent le jeu démocratique en prétendant de surcroît parler au nom du peuple.
C’est pour cela qu’il n’est pas illégitime d’évoquer un « esprit démocratique du populisme » (Federico Tarragoni), dont les partis représentants affichent tous dans leurs sigles une référence au peuple démocratique. Si l’on doit donner sens à cette qualification, l’étude doit donc se focaliser, comme l’ont signalé Margaret Canovan et Pierre Rosanvallon1, sur un phénomène s’assimilant surtout à une pathologie du fonctionnement des démocraties depuis l’invention de la politique moderne à la fin du XIXe siècle. La démocratie du suffrage universel étant contrainte d’unifier la masse des gouvernés en une entité magique (le peuple), l’appel au peuple et le culte de celui-ci en découlent naturellement. C’est là que se repère, écrit Marco Tarchi, auteur de L’Italia populista, « une mentalité connectée à une vision de l’ordre social à la base duquel repose la croyance dans les vertus innées du peuple, dont le primat comme source de légitimation de l’action publique et du gouvernement est ouvertement revendiqué ». De fait, le manifeste du parti de Giorgia Meloni établit comme priorités la « souveraineté populaire » et la « volonté populaire ». Tout est dit !
Le double clivage peuple/élites
Cette volonté introduit un premier clivage horizontal entre le (bon) peuple détenteur de la volonté générale et les élites (l’« établissement », le « système », la « caste », « Bruxelles »…) plus ou moins soupçonnées de trahison ou d’abandon. Ce clivage, réel, imaginé ou construit est générateur de révolte contre la « fausse démocratie » (Chantal Mouffe) fonctionnant au bénéfice des « partis de gouvernement » (l’« UMPS » vomie par le Front national…). Une seconde caractérisation s’impose, dont l’origine relève de l’évolution des sociétés européennes des trente dernières années : ouverture à la mondialisation, immigration, multiculturalisme, menaces de déclassement. À cette insécurité sociale et culturelle répondrait un populisme de type nouveau se posant en défenseur d’un patrimoine culturel et d’un mode de vie menacé. Avec ce « populisme patrimonial » (Dominique Reynié), l’exaltation du peuple n’est plus seulement politique mais ethnoculturelle et xénophobe en instituant un second clivage, vertical celui-là, entre le peuple « de souche » et l’autre peuple, d’origine étrangère.
C’est à partir de ces deux clivages que les populismes prospèrent, menaçant de métamorphoser la démocratie en « peuplecratie » (Marc Lazar). Ils empruntent aux thématiques idéologiques de la droite (la nation) et de la gauche (le social) dans une logique d’affrontement peuple/élites inaugurée dès les années 1930, où l’appel au peuple souverain (demos) se combine avec le culte du peuple homogène (ethnos), le tout confluant dans une revendication à la représentation exclusive du véritable « peuple ». Et c’est ici que l’on peut rencontrer l’imaginaire totalitaire de l’entre-deux-guerres, en particulier celui qui cède aux séductions d’une « démocratie totalitaire ».
Qu’est-ce que la « démocratie totalitaire » ?
« Les libéraux restent en général ébahis lorsque les propagandistes de ces régimes [totalitaires] proclament avec la plus grande sincérité leur appartenance au camp de la “vraie” démocratie », écrivait en 1940 Franz Borkenau, alors en exil à Londres, dans The Totalitarian Enemy. Quelques années plus tard, Hannah Arendt soulignait que les totalitarismes sont indissociables de la construction historique de la démocratie dans la mesure où, à la différence des vieilles autocraties, ces régimes doivent s’accorder aux formes et aux contenus de la démocratie pour pouvoir s’imposer politiquement. De fait, les leaders totalitaires se réclamaient de certaines finalités « démocratiques » (satisfaire les ambitions historiques du Volk ou du Popolo d’Italia), conservaient le suffrage universel à travers de nombreux plébiscites et ne manquaient jamais de prétendre que leurs régimes exerçaient la « vraie » démocratie par l’intermédiaire d’un parti unique investi par d’anciens « dominés » incarnant, mieux que les représentants fourbus de l’oligarchie du « système » (le gouvernement Giolitti, Weimar), la volonté du peuple.

Dans un discours du 23 avril 1937, Hitler a pu affirmer que son Führerstaat constituait « la plus belle des démocraties ». Et Dino Grandi, ministre des Affaires étrangères de Mussolini, a défini un jour le fascisme comme une « nouvelle démocratie nationale » dont la tâche historique était de « faire adhérer les masses à l’État-nation ». Le juriste nazi Ernst Rudolf Huber, collègue de Carl Schmitt, parle alors de « totalité de masse démocratique » pour qualifier le processus politique en cours sous le Troisième Reich… Propagande ? Certes, mais pour une part seulement car les ressorts du phénomène sont plus complexes et ils touchent à l’insertion dans l’espace démocratique de mouvements qui y trouvent une légitimité et une marge d’initiative inégalées. Pour aborder la question dérangeante du rapport de contiguïté du totalitarisme avec la démocratie, il est nécessaire de mobiliser l’œuvre de Jacob Talmon explorant, en 1952, Les origines de la démocratie totalitaire. Si l’historien israélien s’intéressait à la version de gauche du totalitarisme, on peut appliquer cette notion à sa version de droite du fascisme/nazisme, comme le faisaient déjà, avec des appellations similaires, des juristes français de l’entre-deux-guerres qui parlaient volontiers de « démocratie absolue », de « démocratie massive » voire de « démocratie de substance et de fond ». L’essentiel de la dynamique consistait, au nom de l’incarnation supposée fidèle du peuple par le parti, le leader, les cérémonies de masse, la symbolique ou les lois issues des plébiscites, à « submerger la légalité par l’unanimité », ainsi que l’écrit Marcel Gauchet2. Deux éléments qui ont trait à la singularité de la société démocratique permettent d’éclairer l’aspiration à une « démocratie totalitaire ».
Peuple-un et incarnation
La démocratie représentative consacre dès les origines un clivage entre le politique et le social, étant une société sans « corps », échappant à toute définition organique et à tout idéal de communion dans une « totalité ». Cette division et cette indétermination (le lieu du pouvoir est « vide ») ont été à la source de la tentation totalitaire, notamment lorsque l’idéologie démocratique avoue ses limites en période de crise des valeurs (l’après-Première Guerre mondiale, la crise de 1929). Comme le souligne le philosophe Claude Lefort, cette tentation se nourrit du fantasme du « peuple-un », de la quête d’une identité substantielle, d’un pouvoir politique incarnateur, bref d’un État sans division. C’est dans ce cadre que les deux grandes voûtes de l’entreprise totalitaire – la communitas du parti-État et la figure idéologique du peuple – se conçoivent comme un renversement de la logique démocratique. Et c’est ici que l’aspiration totalitaire peut puiser à une source démocratique : l’idée de l’incarnation nécessairement fidèle du peuple souverain. Ce principe justificateur de la démocratie a offert des potentialités infinies à des mouvements dont les chefs étaient issus des masses et dont le recrutement était largement plébéien. Certaines aspirations internes de la démocratie se seraient-elles reconnues dans l’ambition totalitaire ? L’histoire des populismes totalitaires peut-elle nous mettre en garde contre les possibles dérives despotiques de la composante « populaire » de la démocratie ? À l’heure d’une « crise d’hégémonie » du libéralisme, comparable par bien des aspects à la « crise de l’État » des années 1930, ces questions méritent d’être posées.
- Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Paris, Seuil, 2020, 288 p.
- Marcel Gauchet, L’avènement de la démocratie, III. À l’épreuve des totalitarismes, 1914-1974, Paris, Gallimard, 2010, 663 p.
Partager cette page sur :
