Libres, ensemble
Raviver la flamme
de la solidarité
Propos recueillis par Catherine Haxhe · Journaliste
Mise en ligne le 6 août 2025
Pourquoi la gauche ne parvient-elle plus à parler à une partie des classes populaires ? Pourquoi ses discours, autrefois mobilisateurs, sont-ils rejetés par une partie de celles et ceux qu’elle prétend défendre ? Face à la montée des populismes identitaires, les analyses se sont souvent concentrées sur les stratégies gagnantes de ces courants antidémocratiques et sur les raisons qui poussent les classes populaires à voter pour eux. Le court essai Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ? pose peut-être la question « qui tue » : et si la gauche avait perdu sa capacité à parler au cœur des gens ?
Photo © Master1305/Shutterstock
Jérôme Van Ruychevelt Ebstein est militant et communicant politique investi dans les mouvements sociaux en Belgique, formé en sciences politiques et en marketing. Il est également conseiller politique à la fondation Ceci n’est pas une crise. Il tente de comprendre les échecs de la gauche afin de reconstruire des récits et de gagner la bataille culturelle.
Vous avez exploré les failles narratives de la gauche en Belgique francophone lors de l’année électorale 2024. Nombre des discours diffusés pendant cette période vous ont fortement interpellé. Pour quelle raison ?
J’avais l’impression que tout le monde se tirait dans les pattes. C’était toujours la faute des autres, personne ne balayait vraiment devant sa porte. Pour tenter de comprendre pourquoi la gauche parlait si peu au cœur des gens ces dernières années, j’ai fait beaucoup de recherches et de liens entre les maillages associatif, ouvriériste, mutualiste, post-Seconde Guerre mondiale. Ce qui était construit depuis le XIXe siècle l’était sur une vie sociale où chacune et chacun étaient intégrés dans des projets et dans des mécanismes de solidarité chaude et concrète. C’est-à-dire que les gens étaient placés dans un climat émotionnel où on réglait ensemble les difficultés. C’était issu d’un processus dit de « conscience de classe ».
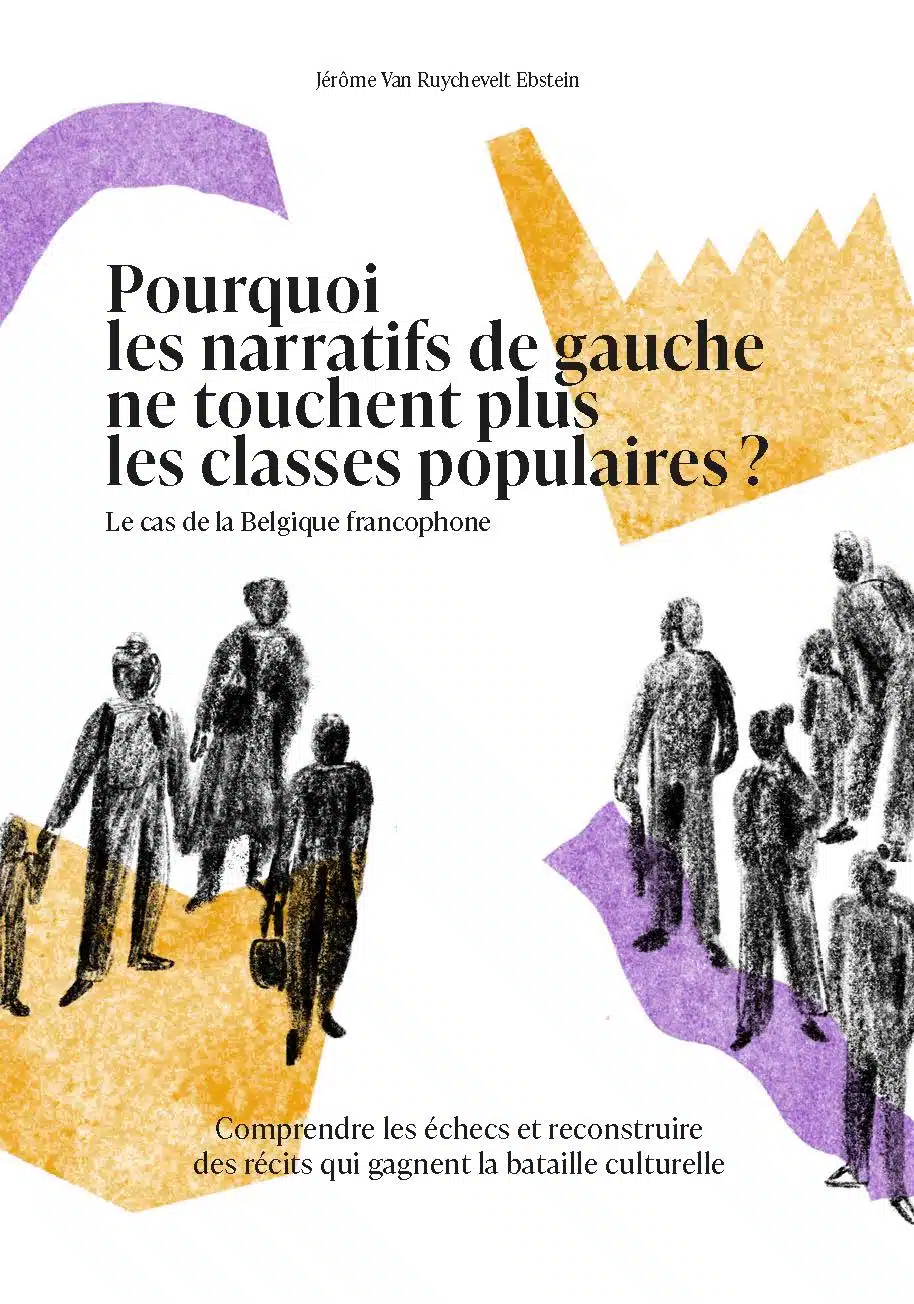
Jérôme Van Ruychevelt Ebstein, Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ?, Bruxelles, Ceci n’est pas une crise, 2025, 48 pages.
En quoi consistait précisément cette conscience de classe ?
Quand on quittait le lieu de travail en ayant eu un problème avec le patron, on trouvait facilement des espaces de socialisation et d’entraide avec d’autres personnes ayant connu le même problème avec lui ou avec ceux d’autres entreprises. On n’était pas seul. On sortait d’une logique de causalité directe pour aller vers le systémique. On n’avait pas d’autres solutions que de faire une coalition avec ceux qui vivaient la même réalité.
C’est sur ce terreau que se sont structurés les syndicats au XIXe siècle ?
Oui et jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Cela offrait aux gens, ne fût-ce qu’émotionnellement, une conscience de classe qui leur permettait de comprendre une logique de système. Alors qu’à cette époque-là encore, il y avait une bonne partie des ouvriers qui étaient analphabètes. Donc ce n’était pas nécessairement une question d’éducation, d’information. Ce maillage ouvriériste et associatif s’est dissous progressivement tout au long du XXe siècle. Cela donne une élite culturelle progressiste traditionnelle, produisant aujourd’hui des narratifs, des campagnes et des mobilisations, complètement déconnectée des publics populaires. Cela se marque dans les résultats électoraux de juin 2024. Les zones où la droite populiste de Georges-Louis Bouchez a gagné sont d’anciens territoires ouvriéristes désertés par les syndicats et les industries, où les gens sont seuls face à leurs difficultés.
Vous mentionnez également dans votre essai l’erreur de la gauche cherchant à convaincre par des arguments trop rationnels et des principes éthiques froids, alors que tout se passe dans l’émotionnel.
Tout à fait, et c’est ça aussi qui ne mobilise plus. Les émotions ne sont plus partagées. Les cadres mentaux ne sont plus adaptés à l’époque actuelle. Le télétravail post-Covid n’a pas non plus aidé. Lorsque les travailleuses et les travailleurs sont séparés de leur lieu de travail, ils ne partagent plus d’expériences de vie. À cela s’ajoutent la peur du monde qui nous entoure et du déclassement social, un sentiment de mépris de la part des élites et celui de ne pas être écouté.
Les choix émotionnels en politique, dites-vous, se font à travers les cadres moraux. Quels sont-ils ?
Entre deux mesures sur le chômage, par exemple, si les partis ont le même objectif, la population ne sachant pas pour qui voter va choisir en fonction de la morale sous-jacente à la mesure : celle qui fera le plus écho à la morale que nous adoptons dans notre quotidien, à la manière dont nous envisageons la vie bonne ou la vie juste. Si dans notre vie, on considère que la responsabilité individuelle et le mérite, le respect des règles, sont des choses très importantes – ce qui est le cas pour une majorité de la population aujourd’hui dans une société individualiste –, on va davantage opter pour une mesure qui fait écho à la morale de la carotte et du bâton.
Jérôme Van Ruychevelt Ebstein, c’est la déconnexion du narratif de gauche avec les publics populaires qui explique le basculement d’une partie de l’électorat vers la droite populiste.
© Solidaris
Cela signifie que moins nous vivons d’expériences concrètes de solidarité chaude avec les gens, moins nous aurons tendance à nous tourner vers des mesures qui font écho à une morale progressiste populaire ?
Cela ne veut pas dire pour autant que les gens ne vivent pas ce qu’on appelle de la « morale progressiste populaire ». Bien sûr, il y a de l’entraide entre voisines et voisins, en famille ou entre amis, mais pas trop au-delà de ces cercles. On le voit bien, pour que les narratifs complexes, rationnels, techniques et technocratiques puissent faire écho à cette morale populaire que les gens vivent tous les jours, il faut pouvoir utiliser des métaphores qui rapprochent ces éléments complexes, comme la sécurité sociale, le plus possible de ce que chacun connaît dans son quotidien.
Les narratifs de droite, eux, touchent davantage cette part sentimentale de l’ordre du vécu ?
Une partie des publics populaires historiquement plutôt de gauche a basculé à droite. L’idée était d’analyser quels types de profils ont pu faire ce pas. Mon but est d’ouvrir des pistes concrètes pour reconstruire une parole politique qui rassemble, qui touche et qui gagne durablement.
Vous évoquez également la « retribalisation ». Qu’est-ce que c’est ?
C’est un terme utilisé par le sociologue Benoît Scheuer qui l’a étudié à partir de plusieurs paramètres. Celui de la gouvernance autoritaire, celui d’un retour au passé, celui de la volonté d’une société homogène ou de l’adhésion à une rhétorique brutale. Ces paramètres sont testés à travers toute une série de questions socio-émotionnelles. Les sociologues en déduisent ensuite un index de repli ou plutôt d’ouverture. La « retribalisation » est un index de repli, très émotionnel, très primitif, sur sa communauté, sa tribu, sa famille. Il est basé sur les peurs, sur un sentiment que les élites politiques ne gèrent absolument pas le monde actuel. C’est ce sentiment d’angoisse qui conduit les gens vers des leaders populistes autoritaires promettant de régler à eux seuls les problèmes, sans intermédiaires, avec des solutions aisément compréhensibles par tous.
Si l’on pousse votre raisonnement jusqu’à l’ère de post-vérité d’un Donald Trump, on sait que le discours est extrêmement vif et mensonger. Est-ce possible de rivaliser avec des narratifs « fake news » sans pour autant entrer dans le même jeu ?
Mon hypothèse, c’est que c’est insuffisant de ne rester que sur le plan de la communication et des narratifs. Même s’il faut continuer, tant que faire se peut, de tenir une ligne la plus éthique possible dans la communication, on doit aussi agir.
Cela suffira-t-il ?
Dans le contexte que nous connaissons, ce ne sera pas facile. Les algorithmes des réseaux sociaux ou le rachat progressif des médias privés par des gens qui ont un vrai agenda politique à droite, voire à l’extrême droite, favorisent l’individualisme, l’angoisse, l’incitation à se faire la guerre les uns contre les autres. Tout cela permet l’émergence des projets politiques problématiques. Notre seule force sera d’être présents sur le terrain. On ne peut pas, à gauche, travailler la communication politique sans être profondément ancré dans les réalités locales, dans les foyers en de nombreux lieux, auprès de publics différents, et à partir d’expériences de vie différentes, mais toujours en reliant tout cela à une morale populaire et progressiste.
D’où l’importance d’être en permanence en contact direct avec la population ?
En effet, si l’on n’est pas en contact avec les gens, non seulement on ne perçoit pas la manière dont ils envisagent leur morale populaire, mais en plus on peine à les convaincre de quoi que ce soit. On doit avant tout recréer un lien social et affectif avec eux. Par exemple en matière de solidarité, si vous vous basez uniquement sur la solidarité froide, des narratifs et des principes, ça ne marche pas. Il faut réinstaurer de la solidarité chaude, concrète, de quartier. Il est très probable, et on l’espère quand même, qu’une grande partie de la population, que ce soit aux États-Unis ou ici, va être déçue à un moment donné de ces narratifs populistes et d’extrême droite.
Face à la montée des populismes identitaires, la gauche, en perte de vitesse, s’interroge sur la manière de parler au cœur des gens.
© Roman Samborskyi/Shutterstock
Les gens vont prendre conscience qu’en fin de compte, la solidarité, il n’y a que ça de vrai ?
Là où je suis optimiste, c’est que même ceux qui ont voté pour des populismes de droite ont des besoins de connexion à l’autre, une envie d’avoir confiance en sa voisine, son voisin. Cela fait du bien à tous de se serrer les coudes, de se rencontrer, de discuter, d’être ensemble pour sortir de ses problèmes, faire face aux mêmes adversaires. Sur ces points, je garde espoir.
C’est un peu ce que l’on a vu lors de catastrophes naturelles comme les inondations en région liégeoise en 2021 ?
Oui, mais – et c’est un bon exemple – qui était présent en masse lors des inondations ? La N-VA. Elle a envoyé beaucoup de militants sur place, et ça change évidemment l’image d’un parti. La gauche, en tant qu’élite culturelle progressiste, aime trop parler, mais pas assez mettre les mains dans le cambouis. Beaucoup de collectifs et d’organisations devront probablement sortir de leur zone de confort : se déplacer géographiquement, parler une autre langue, se confronter à d’autres modes de vie. Recréer du lien avec celles et ceux qu’on ne connaît plus demande un véritable intérêt pour les gens, et la capacité de se laisser toucher. Cet état d’esprit est essentiel pour construire de nouvelles pratiques et de nouveaux narratifs.
À écouter
Libres, ensemble · 10 mai 2025
Partager cette page sur :
