Libres, ensemble
Les nouvelles assignations qui tuent l’émancipation
Propos recueillis par Sandra Evrard · Rédactrice en chef
Mise en ligne le 21 mai 2025
L’émancipation filerait-elle du mauvais coton ? Alors que les libertés et droits fondamentaux furent acquis de dures luttes au XXe siècle en particulier, ceux-ci sont désormais attaqués de toute part et s’effilochent sous nos yeux. Sans libertés, pas d’émancipation, d’où la nécessité de réinterroger cette valeur face aux enjeux contemporains. L’historienne Michèle Riot-Sarcey s’est prêtée à l’exercice avec des étudiants de l’école Estienne.
Illustration © Igor Link/Shutterstock
Le titre de votre livre mérite déjà à lui seul une explication : pourquoi poser cette question ?
Cela fait suite à un constat : la question de l’émancipation n’est plus aussi évidente qu’elle le fut. D’ailleurs, lorsqu’on pose cette question à la jeune génération, il y a toujours un temps d’arrêt, ils imaginent par exemple que l’émancipation, c’est la protection de soi par rapport à la société, puisque généralement, les sociétés occidentales en particulier ont valorisé l’individualisme, au mépris du collectif. Et surtout, l’autre est très souvent ignoré. Pour écrire ce livre, j’ai eu recours aux élèves de l’école Estienne, qui forme aux métiers d’art. Trois groupes d’étudiants furent constitués sous la responsabilité d’un prof de philo, Jérôme Duwa, lequel m’avait invitée pour une conférence sur l’utopie, estimant que les étudiants avaient une forte tendance à mettre en avant la dystopie au détriment de l’utopie. Ces groupes travaillaient, pour leur diplôme de fin d’études, sur le vivre ensemble, à l’écart du devenir soi dans un lieu construit à cet effet, ou encore sur l’acte de faire la fête ou de se cultiver. Les réseaux sociaux ont été interrogés, bien sûr. J’ai été particulièrement étonnée par le groupe de travail qui s’est consacré au hashtag #thatgirl, une influenceuse qui bénéficie de millions de followers. De fait, le modèle valorise l’isolement de soi afin de parvenir au « Moi en majesté ». Dans son univers, l’atmosphère est ouatée, la vie se déroule dans un intérieur beige, au sein duquel, depuis le soin physique comme celui de l’entretien de son intellect jusqu’à la nourriture et la boisson – bio, cela s’entend –, qui sont conçus et présentés avec rigueur, rien ne doit brouiller le confort quotidien. L’autre n’existe pas. J’ai interviewé de nombreuses jeunes filles ressemblant à cette #thatgirl et je me suis rendu compte que dans ce monde où l’on tend à valoriser la liberté d’être soi-même, en réalité, c’est l’inverse qui est mis en œuvre ; ces jeunes filles n’étaient finalement qu’un miroir d’une représentation d’elles-mêmes que leur imposaient les publicitaires. Une forme indirecte et particulièrement pernicieuse d’aliénation, en quelque sorte.
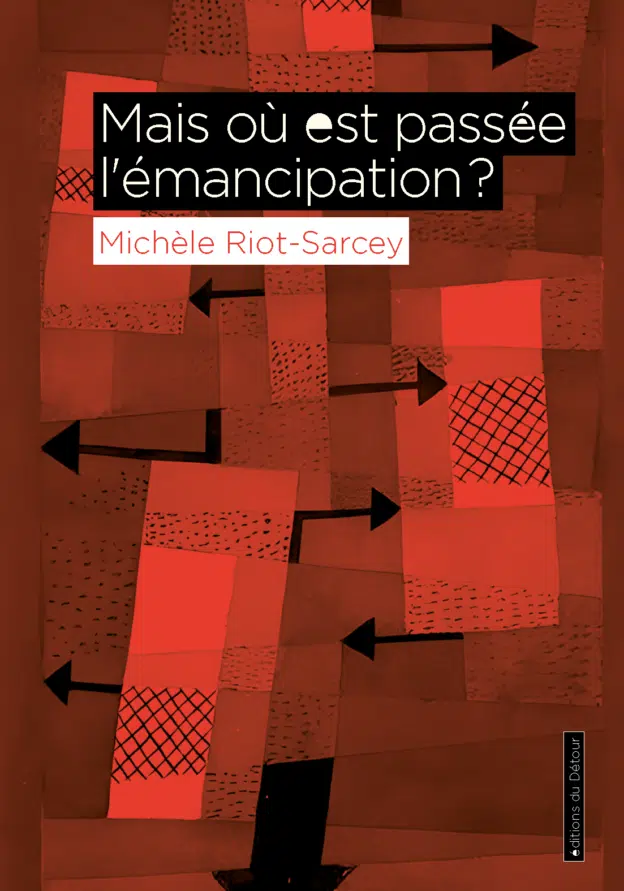
Michèle Riot-Sarcey, Mais où est passée l’émancipation ?, Bordeaux, Éditions du Détour, 2025, 144 pages.
Cela pose la question de ce qu’est l’émancipation. Comment la définissez-vous ?
S’émanciper signifie se libérer des tutelles qui nous enserrent : religieuses, familiales, politiques, sociales. Or, on ne se libère qu’avec autrui. Parallèlement à la démarche individuelle irremplaçable, un travail collectif est nécessaire, car nous vivons en société avec d’autres, cela est très important à noter. Or, l’individualisme aujourd’hui, ou le triomphe du moi, se généralise en particulier dans l’écriture romanesque. La grande majorité des romans en effet ne cesse de développer le souci de soi à partir de l’expérience personnelle. L’imagination, la créativité semblent avoir disparu. Se présenter soi-même dans tous nos états paraît être la condition de la réussite et de la reconnaissance sociale sans obligatoirement tenir compte de l’environnement, de la situation politique, de tout ce qui fait société, comme si les rapports humains se résumaient à l’interférence gênante de l’autre.
Vous dites que l’assignation, c’est en quelque sorte l’ennemi de l’émancipation, mais que cette première a changé. De quelle manière ?
On peut citer les images, même si celles-ci sont en mouvement, que dispensent les écrans. Elles s’impriment dans votre cerveau, ne permettant pas le déploiement de l’imagination. Le processus fige la pensée sur la représentation du monde ou de soi. D’où la multiplication des selfies. Heureusement, les résistances sont aussi de plus en plus nombreuses. Les élèves de l’école Estienne, avec qui j’ai travaillé, en sont notamment arrivés à contrôler leur temps d’écran. Ils se sont rendu compte qu’ils étaient assujettis à cette machine conçue comme la prolongation d’eux-mêmes. Au sein de la société, dans les lieux de travail qui permettent traditionnellement aux jeunes gens d’acquérir leur autonomie financière, on remarque le rôle grandissant des méthodes de management, modèle qui s’étend aujourd’hui partout, y compris dans les universités. C’est dire à quel point cette extension de l’injonction d’être au service de la marchandise se répand. Nous sommes face à une réalité que bon nombre de responsables politiques tentent de contourner par la dénégation du réel, contre toute évidence. Tandis que la nécessité de réduire la production devrait s’imposer tout en répartissant plus égalitairement les ressources disponibles, on assiste à la course aux terres rares, aux ressources énergétiques et aux fermetures des frontières. Heureusement, il y a une prise de conscience collective qui s’organise à la marge des institutions existantes pour essayer d’affronter la catastrophe annoncée. On constate l’extraordinaire expansion des associations, des ressourceries, par exemple, des coopératives, de l’habitat à la culture collective de terres arables : il y a donc une alternative à l’aliénation individuelle et individualiste.
Vous pointez aussi du doigt le fait que l’école ne serait plus un lieu d’apprentissage. Quels sont les nouveaux lieux d’apprentissage, et quels sont les résultats de cette migration de la transmission des savoirs ?
Le groupe travaillant sur la culture à l’école Estienne a constaté que l’école n’était plus la référence pour accéder à la connaissance. Aujourd’hui, la référence, c’est le copain, les proches, le réseau social et les influenceurs. Certains se rendent compte de la nécessité de prendre du recul et de la distance par rapport à ces injonctions et au poids des nouveaux médias. Pour redonner sens au savoir, à la connaissance, il serait bon de profondément réformer l’école et de cesser de privilégier l’éducation au détriment de l’instruction, comme le prévoyait Condorcet, c’est-à-dire de redonner le goût du savoir à une population en quête d’explications du monde et de références historiques. La valorisation de la marchandise, l’accent mis sur l’avoir aux dépens de l’être se réalise à travers la pollution des esprits. Le développement exponentiel de la publicité conduit, de fait, à la course aux besoins artificiels. L’utile s’est effacé au profit de la fabrique de l’objet, non nécessaire. Comme le disait déjà Günther Anders dans L’obsolescence de l’homme1, la production excessive fabrique d’abord et avant tout des déchets. L’usage actuel de l’intelligence artificielle – de façon à dévoyer l’esprit par la désappropriation de la connaissance – n’arrange rien. Pour cela, rien ne vaut la lecture. C’est absolument irremplaçable, car les mots peuvent être maniés, rassemblés, appropriés. J’aurais tendance, avec mon esprit utopique, à imaginer possible de substituer des poèmes affichés dans les rues à la publicité.
C’est intéressant ce que vous dites-là, parce que si on met ces propos en parallèle avec la force et la viralité des algorithmes, il faudrait finalement frapper assez fort pour contrebalancer la puissance des écrans ?
Il faut contrebalancer cette pollution des esprits, d’autant plus offensive que ceux qui nous dirigent, côté religieux, politique ou social, savent parfaitement que la catastrophe est imminente si des mesures drastiques ne sont pas prises. Les spécialistes sont unanimes : sécheresses, inondations, incendies, canicules, vont se succéder. Déjà, la famine dans le monde, au lieu de régresser, augmente… Walter Benjamin (qui s’est suicidé en 1940 en tentant d’échapper aux nazis), un grand philosophe critique, historien lucide face à la catastrophe annoncée de la Shoah, avait essayé de comprendre le « comment en est-on arrivé là » ? Autrement dit de saisir la destruction programmée d’une partie de l’humanité en cours de préparation dès les années 1930. Travaillant systématiquement sur les écrits de ses contemporains à la Bibliothèque nationale, à Paris, rue de Richelieu, il conclut dans son dernier écrit sur le concept d’histoire par ce verdict sans appel : « Nous donnons le nom de progrès à cette tempête, tel le vent de l’Histoire qui pousse irréversiblement vers la production de déchets. Continuer comme avant, c’est ça, la catastrophe », expliquait-il.
Mais n’est-ce pas davantage l’instrumentalisation à mauvais escient de ce progrès qui pose question plus que le progrès en soi qui permet aussi l’amélioration de la santé humaine, pour ne citer que cet exemple ?
Sans doute faut-il, sinon nuancer, expliciter le propos de Benjamin : ce n’est pas tant le progrès en soi qu’il convient de condamner, mais la pratique du progrès au service de la production marchande en vue du profit. Taper un grand coup comme transformer tous les tableaux publicitaires en présentation de textes poétiques, par exemple, serait un bon début. D’ailleurs, l’expression « intelligence artificielle » consiste à substituer la machine à l’esprit humain. Et ça, c’est une catastrophe ! Toutes les capacités humaines, inexploitées, nous disent que nombre de tâches dévolues à l’humain ne peuvent, en aucun cas, être remplacées par des algorithmes. Au vu de ce qui se passe aux États-Unis, nous pouvons nous inquiéter : la mise en cause des services publics, la dérégulation, le renvoi des migrants, l’arrêt de certaines recherches en lien avec une démarche humaniste, le frein à l’aide internationale, la fermeture des frontières, nous montrent que nous allons à contresens d’un progrès humain et que nous marchons tout droit vers la barbarie. N’est-ce pas l’expression d’une catastrophe annoncée ?
Quelle est votre vision de ce mouvement qui se déroule sous nos yeux actuellement aux États-Unis par rapport aux atteintes aux libertés fondamentales, donc par essence aussi par rapport à l’émancipation ?
La mise en œuvre, ici et là, de résistances collectives et individuelles permet de croire au changement possible des rapports sociaux et des orientations économiques jusqu’alors privilégiées par les dirigeants. Cela peut se réaliser de différentes façons : se prendre en charge, cesser d’accepter ponctuellement de déléguer son pouvoir de citoyen, discuter ensemble au plus près des réalités sociales et politiques, au niveau du quartier, du village, de l’immeuble. Mais aussi apprendre à se connaître, échanger des informations, des savoirs, décider de la gestion de la vie quotidienne, demander des comptes aux élus, bref, réapprendre la liberté responsable. La démocratie ne peut s’accomplir qu’avec des gens que l’on connaît, avec qui on peut débattre, avec qui on peut effectivement discuter de tout, du proche comme du lointain. C’est une nécessité à l’heure actuelle, que les partis politiques, un minimum conscients des dangers présents, essaient de mettre en place des structures collectives à l’échelle humaine, de façon à ce que les personnes puissent résister à cette aliénation des esprits. C’est la seule ouverture possible vers une alternative réellement démocratique.
- Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, (1956) (trad. Christophe David), Paris, Ivrea/L’Encyclopédie des nuisances, 2001, 360 p. et Tome II. Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle, (1980) (trad. David Christophe), Paris, Fario, 2011, 428 p.
Partager cette page sur :
