Libres, ensemble
Le foot : parfait miroir
de nos sociétés imparfaites
Propos recueillis par Catherine Haxhe · Journaliste
Mise en ligne le 8 octobre 2025
Fan du ballon rond ou pas, tout le monde connaît Lilian Thuram1, ne serait-ce que de nom. Footballeur talentueux, il est un homme de combats, et sa sympathie n’a d’égal que sa simplicité. Connu pour sa solidité défensive, ses relances et sa capacité à participer aux offensives, il a brillé dans deux Coupes du monde avec l’équipe de France, en 1998 et en 2002. Lorsque le temps est venu pour lui de quitter les vestiaires et de ranger les crampons, plutôt que de couler des jours heureux bien mérités au soleil, il a décidé de créer, en 2008, la Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme. Rencontre avec un être humain hors normes.
Photo © Andrew Angelov/Shutterstock
Il a mis la barre haut, Lilian Thuram. Bien plus haut que la transversale. Son but à lui, depuis qu’il a arrêté sa carrière, c’est de lutter contre les inégalités aux quatre coins de la planète. Vous pourriez dire que c’est un vœux pieux. Autant que les miss aspirent à la paix dans le monde, tout un chacun rêve d’égalité ou fait semblant de le vouloir. Mais lui, il est vraiment passé à l’action. Il s’est lancé, sans ménagement, sur les chemins du dialogue auprès de toutes sortes de publics : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants du supérieur, enseignants en formation initiale et continue, futurs agents des instituts régionaux d’administration, militants associatifs, clubs et écoles de sport, étudiants en journalisme, migrants, personnes placées sous l’autorité de la justice… Sans oublier le grand public.
Qu’est-ce qui vous a poussé, en 2008, à créer votre association contre le racisme ?
Le désir de rendre à la société tout ce qu’elle lui m’avait apporté. Des trois piliers définissant la France : liberté, égalité, fraternité. C’est la fraternité que je chéris le plus.
Le sport permet-il d’atteindre ce que l’on appelait jadis l’« American Dream » : des destins fabuleux, presque à la portée de tous ?
Oui, le sport permet ça, surtout le foot. Des gamins, comme moi, sortent de leur milieu parfois moins favorisé et atteignent le sommet. Mais cela ne se fait pas sans une aide de la communauté, sans fraternité. Dans mon premier club, les Portugais de Fontainebleau, ceux qui n’avaient pas d’argent n’étaient pas obligés de payer la licence. Moi, j’ai pu jouer sans payer la licence parce que ma mère n’avait pas les moyens. C’est cette solidarité qui m’a permis d’être là où je suis aujourd’hui. Tous les sports ne permettent pas ça. Tentez de faire la même chose dans le golf, la F1 ou le tennis, c’est impossible. Raison pour laquelle je fais souvent un parallèle entre la société et le sport : oui, mais pas n’importe quel sport. Pour comprendre vraiment nos sociétés, le foot est un miroir parfait.
Le but de Lilian Thuram est de répondre au racisme par l’éducation et d’œuvrer en faveur de l’égalité. « On ne naît pas raciste, on le devient. » Cette paraphrase de Simone de Beauvoir est la pierre angulaire de la fondation qui porte son nom.
© Catherine Haxhe
À quel moment vous êtes-vous dit que ce sport qui vous avait fait vivre, qui vous a fait connaître, vous alliez vous en servir dans une seconde vie ?
Je dirais que ça s’est mis en place petit à petit. C’est un parcours de vie. Et je pense que si je fais ce que je fais aujourd’hui, c’est parce que j’ai été inspiré par des athlètes, notamment nord-américains. J’ai vu que ces athlètes-là, dont le plus connu était sans doute Mohamed Ali, pouvaient se servir de l’émotion entre athlètes et spectateurs pour questionner la société dans laquelle nous nous trouvons. J’ai alors pensé que ce serait intéressant de profiter de cette notoriété pour éduquer les plus jeunes et comprendre le pourquoi du racisme, pour éduquer grâce au sport. Dans le contexte de l’accélération de la montée des extrémismes, ces dernières années, le combat en faveur de l’inclusion et le combat contre le racisme ne sont plus les seuls à devoir être pris en compte : il y a carrément un besoin de sauvetage de la démocratie. Selon moi, nous avons tout de même accompli des progrès par rapport au passé. Quand j’analyse ma propre histoire, celle des Antilles, elle est terrible : elle raconte l’extermination des peuples premiers, remplacés par des populations venues d’Afrique pour être réduites en esclavage. À cette époque, l’exclusion, la hiérarchie et la violence basées sur la couleur de la peau étaient beaucoup plus marquées. On peut donc dire que nous avons avancé en matière d’égalité.
Mais ne pensez-vous pas que ces acquis sont très fragiles ?
Bien sûr, je pense que de plus en plus de personnes prennent conscience des inégalités. Mais il y en a aussi beaucoup qui souhaitent les maintenir pour continuer à hiérarchiser nos sociétés et préserver leurs intérêts. Nos sociétés sont extrêmement polarisées et divisées. C’est pourquoi, sur un terrain de foot qui réunit des enfants de tous les horizons, il est important de leur rappeler que ces luttes ont été gagnées à force de courage et qu’il faut absolument protéger ces acquis.
Selon vous, quelle place le genre occupe-t-il dans le sport ?
Lorsque je suis devant un match de football féminin, je ne le regarde pas en me demandant si les performances des filles sont comparables celles des garçons. Moi, je trouve que le foot, c’est avant tout des émotions. Et lorsque je regarde l’équipe de France jouer, je suis pris par l’émotion, je veux qu’elle se qualifie. Il y a des matchs à rebondissement incroyables, mais très souvent, on compare. On pourrait très bien avoir des équipes mixtes, le niveau et la pratique se transformeraient. La question de la performance uniquement basée sur des critères physiologiques se poserait autrement. Il y a déjà des équipes mixtes, c’est vrai, mais pas au niveau professionnel. Regardez, même à l’école à partir d’un certain âge, le sport devient non mixte. On sépare les garçons et les filles et on sait que ça produit toute une série de choses, pas forcément positives. Il faut que le sport soit ouvert à tous, y compris aux personnes moins valides. Lorsque pendant les Jeux paralympiques, j’ai supporté l’équipe de France de cécifoot, j’ai été rempli d’émotions. Les joueurs mal- et non-voyants sont extraordinaires ! Vous vous demandez : « Mais comment font-ils ? » Il faut se laisser prendre par les émotions et non pas comparer ce qui n’est pas comparable.
Mais je vous ai entendu dire que le rêve, l’émotion pouvaient aussi exclure, lorsque nos héros sont trop loin de nous, qu’ils nous tiennent à distance. Vous le pensez toujours ?
Oui, tout à fait. C’est ce que j’appelle la question de la représentation. Beaucoup d’observateurs l’ont d’ailleurs souligné pendant les Jeux paralympiques : seule une infime partie des personnes en situation de handicap est représentée dans ces compétitions. Le risque, c’est de véhiculer l’image du superhéros pratiquant un sport inaccessible, pour lequel il faudrait des compétences exceptionnelles. Et les médias ne font qu’amplifier ce mythe.
Grâce à l’éducation contre le racisme, on apprend à se voir d’abord comme des êtres humains, sur le terrain et au‑delà.
© People Images/Shutterstock
Lorsque l’on assiste aux violences dans les matchs de foot, relayées par les médias justement, les débordements et la haine de la part de certains supporters font froid dans le dos.
Encore une question d’éducation. Le foot génère parfois un trop plein d’émotions, et elles ne sont pas toujours positives. Lors des derniers débordements en Belgique, à Molenbeek (et à Jette en marge d’un match de la Coupe de Belgique au stade Roi Baudouin les 4 et 5 mai 2025, NDLR), la violence s’est propagée dans les rues. Certains tifosi en ont profité pour tout casser. Il y a tout un tissu social autour de la pratique elle-même. Parfois, cela profite à ceux qui veulent en découdre avec une autre communauté. L’extrême droite l’utilise pour aller en dehors des stades, dans des quartiers dont on sait qu’ils sont à forte majorité arabo-musulmane et y mener de véritables rixes. C’est aux clubs de foot de réguler les groupes de supporters d’extrême droite et de faire le ménage. Il faut évidemment condamner cela fermement. J’aimerais également ajouter une touche positive, car il y a ce qu’on appelle les ultras dans certains clubs de foot, des groupes de supporters qui, eux, par contre, sont très ancrés dans des valeurs de solidarité et de lutte contre le racisme et la discrimination et qui régulièrement affichent de grandes banderoles dans les tribunes, diffusant des messages politiques antifascistes. Le foot a toujours été un lieu de luttes populaires. Il y a ceux qui pratiquent le sport et ceux qui le regardent. C’est une microsociété dans toutes ses dimensions.
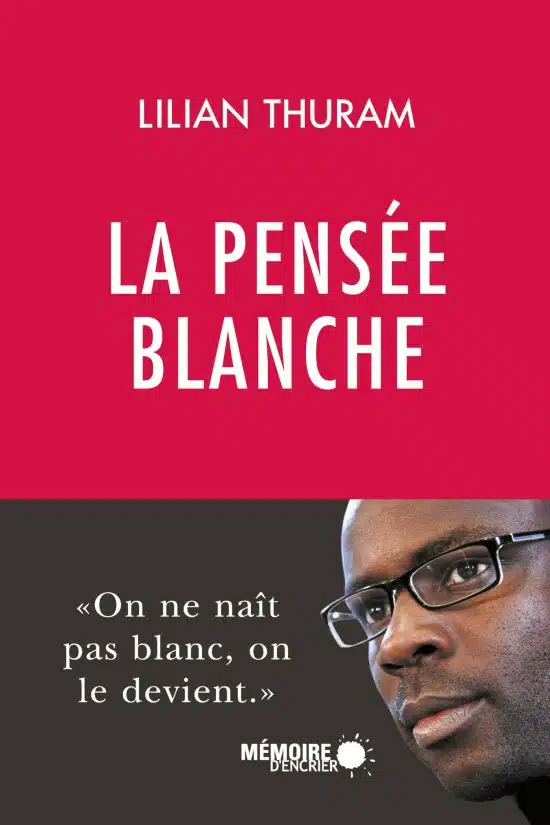
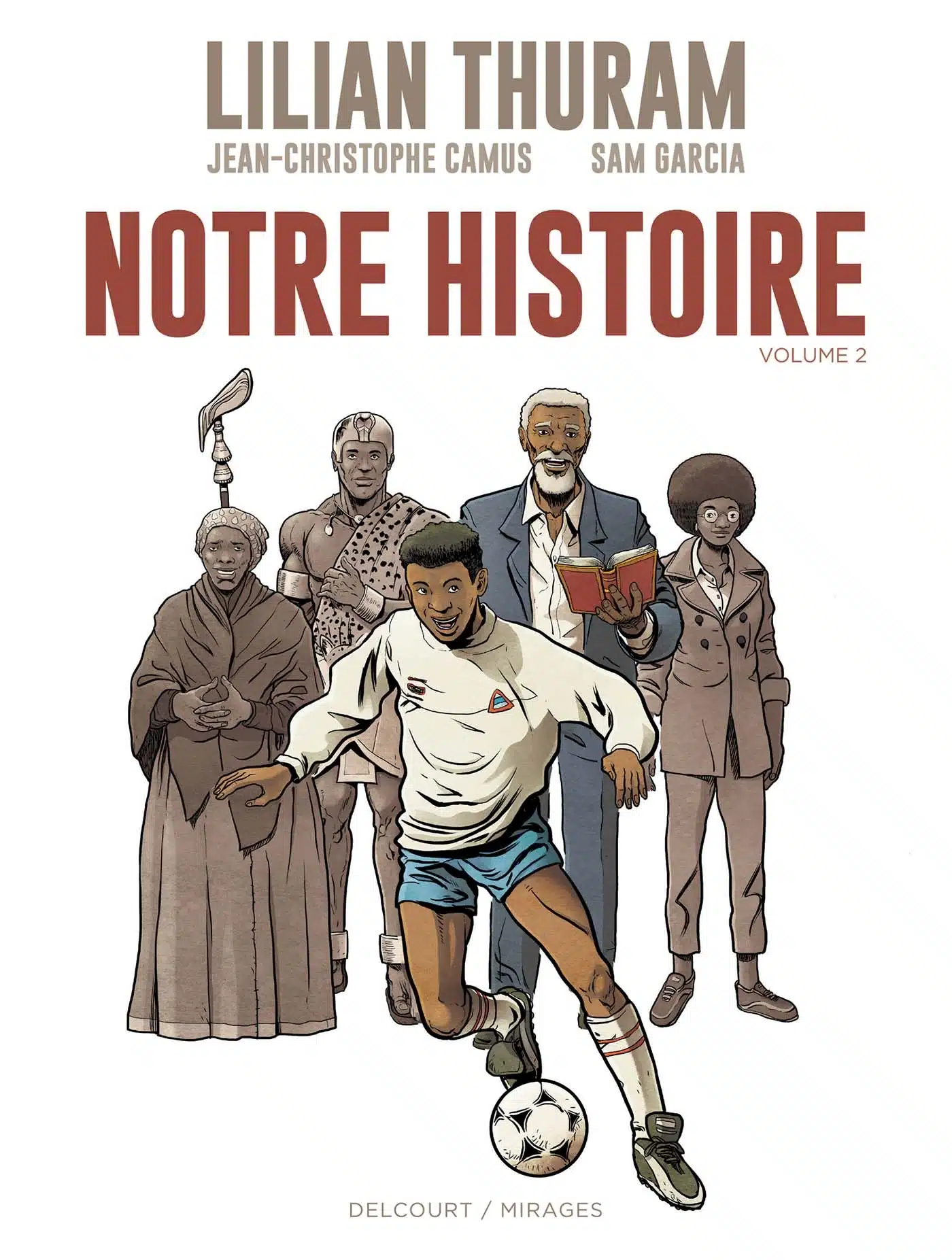
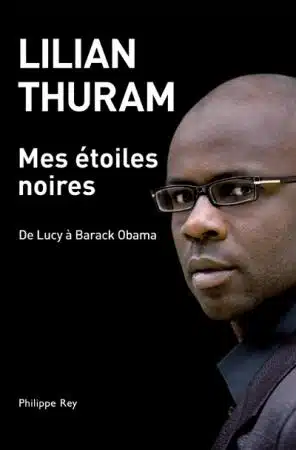
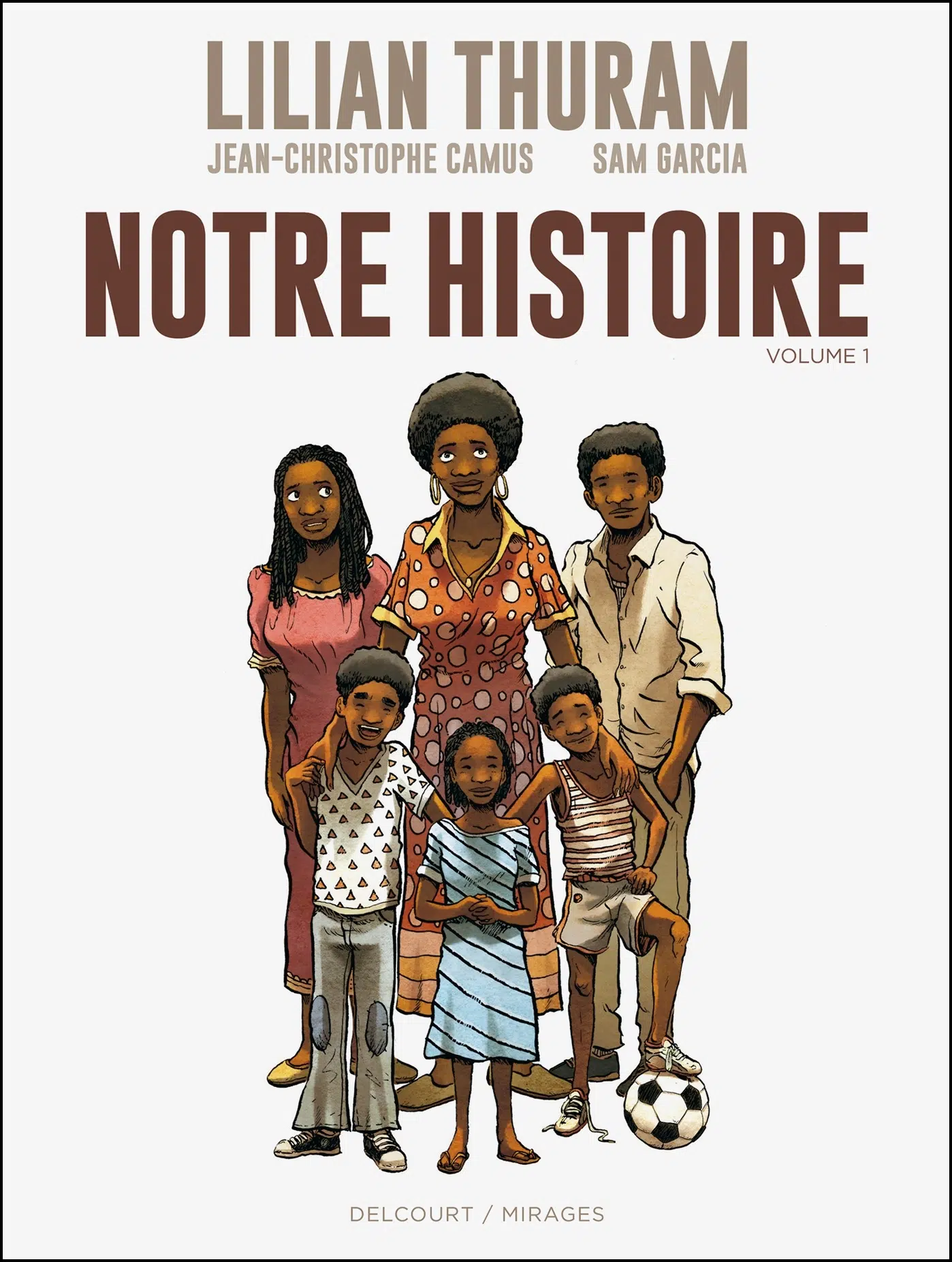
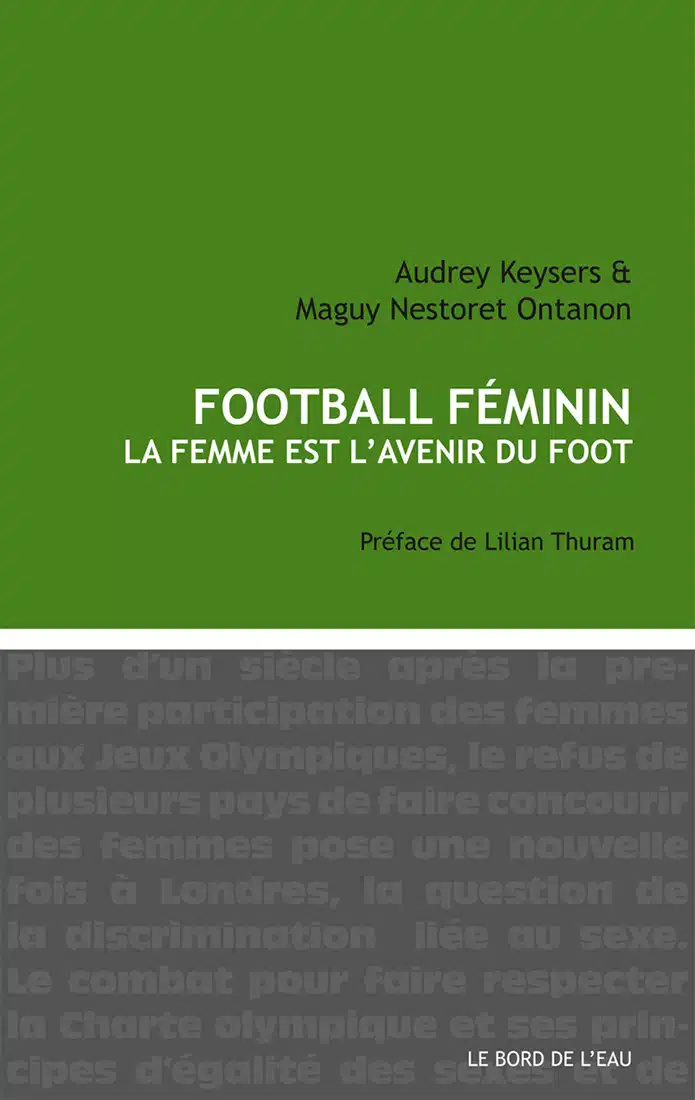
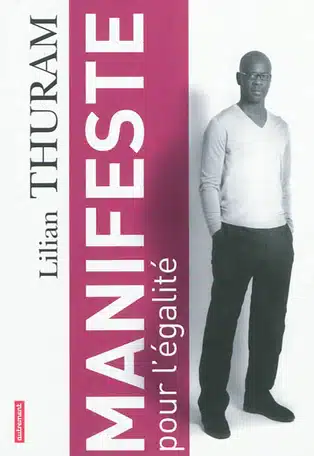
- Nous l’avions rencontré une première fois en 2016, lors de la tenue de son exposition à la Cité Miroir à Liège. Cf. Catherine Haxhe, « Zoos humains, l’invention du sauvage », dans Espace de Libertés, no 453, novembre 2016.
Partager cette page sur :
