Chronique du Nord
« La mort reste un tabou,
mais pas l’euthanasie »
Geert Dewaele · directeur de la communication
et Dimitri De Smet, délégué au service communication à deMens.nu1
Avec la rédaction
Mis en ligne le 13 octobre 2025
Peu d’auteurs peuvent dire que leur livre est prêt pour une dix-huitième édition. Il ne s’agit pas ici de Tom Lanoye ou de Stefan Hertmans, mais de Wim Distelmans. En 2005, l’oncologue a publié Een waardig levenseinde. Respect voor het zelfbeschikkingsrecht2, un guide sur les soins palliatifs, les droits des patients et l’euthanasie. En 2025, une édition entièrement retravaillée est sortie en librairie. Vingt ans après la parution de la première édition, le moment semble idéal pour parler de l’évolution de notre manière d’appréhender la fin de la vie avec le spécialiste du droit à l’autodétermination.
Photo © Shutterstock
Pourquoi avez-vous écrit ce livre sur la fin de vie à l’époque ?
Le livre a fait suite aux trois lois votées en 2002 : la loi sur les droits des patients, la loi sur les soins palliatifs et la loi sur l’euthanasie. Cette dernière est la plus connue, mais les deux autres sont tout aussi importantes. Les médecins et les prestataires de soins de santé ont soudain dû les appliquer, mais ils ne savaient souvent pas comment s’y prendre. Quant aux patients, ils ne savaient pas non plus quels étaient leurs droits. J’ai donc voulu écrire un livre qui rassemble tout : non seulement ce que les lois permettent, mais aussi comment elles ont vu le jour, quels ont été les obstacles et quel a été le contexte historique qui les a précédées. Il s’agissait essentiellement d’un aperçu des soins de fin de vie en Belgique, et plus particulièrement en Flandre.
Le contenu de votre livre a été mis à jour pendant plusieurs années. Pourquoi avoir opté pour une version entièrement revue ?
Avec le temps, le livre était devenu un patchwork de mises à jour. L’éditeur a suggéré de le remanier complètement. C’est ce que nous avons fait : nouveaux thèmes, nouvelle législation, nouvelles tendances sociales.
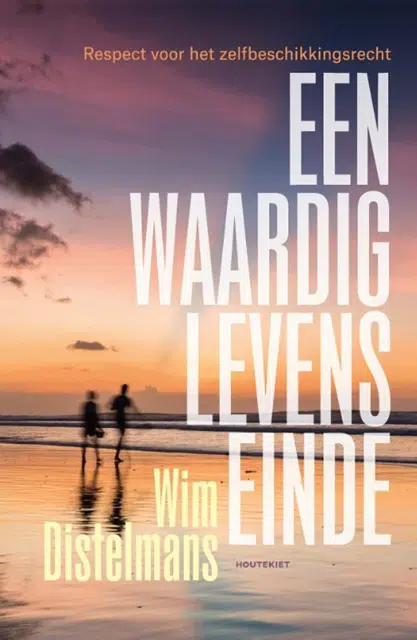
Wim Distelmans, Een waardig levenseinde. Respect voor het zelfbeschikkingsrecht, Anvers, Houtekiet, 2025, 328 pages.
Quel est, selon vous, le plus grand changement de ces vingt dernières années ?
L’impact de la loi sur l’euthanasie a été énorme. Les gens se sont rendu compte qu’ils peuvent décider eux-mêmes quand cela suffit. Cette prise de conscience a conduit à une plus grande émancipation. Les patients, la génération Internet en particulier, veulent désormais prendre part aux décisions dès le premier diagnostic. Ils ne se contentent pas d’accepter le verdict d’un médecin, mais posent des questions critiques du genre : « Pourquoi préconisez-vous ce traitement, docteur ? »
Notre système de soins de santé s’est-il suffisamment adapté à ce changement de mentalité ?
Pas du tout. De nombreux prestataires de soins de santé – médecins, infirmières, personnel paramédical – n’ont pas encore suffisamment pris conscience que tout ce qui est techniquement possible ne doit pas être fait. La consultation des patients est cruciale. Le médecin est l’expert médical, le patient est l’expert par expérience. Le dialogue entre les deux permet de prendre les meilleures décisions. Mais il y a encore trop peu de place pour cela. En outre, les soins de fin de vie ne sont pas encore une matière obligatoire dans toutes les universités. À la VUB, c’est le cas, mais ailleurs, c’est souvent facultatif. Cela en dit long : mourir reste apparemment facultatif.
Parler de la mort est-il devenu plus facile entre-temps ?
Pas vraiment. Le tabou qui entoure la mort est tenace. La plupart des gens ne veulent pas mourir, et particulièrement dans une société où tant de choses ont été mises en place pour vivre plus longtemps. Le mot « palliatif » fait encore peur. Les gens pensent immédiatement : « Je suis en phase terminale, je vais mourir, donc je ne veux pas de cela. » C’est regrettable, car les soins palliatifs sont précisément axés sur la qualité de vie.
L’euthanasie, en revanche, semble être devenue négociable.
C’est vrai. C’est parce que les gens gardent le contrôle. Cela fait appel à l’imagination. Ils ont le sentiment que c’est eux qui décident. Et c’est fondamentalement différent de la dépendance à un programme de soins.
Les soins palliatifs ne reçoivent-ils donc pas suffisamment d’attention ?
Certainement. Les médias ne veulent souvent parler que de l’euthanasie, et non des soins palliatifs ou de la gestion de la douleur. C’est pourquoi les gens pensent parfois que l’euthanasie est la seule façon de mourir dans la dignité. Ce n’est pas le cas : vous pouvez également choisir d’arrêter les traitements inutiles et d’investir dans des soins palliatifs de qualité.
Sur le plan politique, les soins palliatifs semblent également sous-exposés.
Ils ne sont généralement évoqués que lorsque la loi sur l’euthanasie est remise sur la table. En 2002, l’opposition a utilisé cet argument : « Améliorez d’abord les soins palliatifs. » Il s’agissait surtout d’une manœuvre politique, même si elle a permis de récolter un peu d’argent. Aujourd’hui, dix-huit millions d’euros sont prévus, mais c’est une bagatelle. Il ne faut donc pas prétendre ensuite que les soins palliatifs doivent être améliorés avant de changer la législation. Cela fait vingt ans qu’on l’attend.

La société flamande montre une forte volonté d’autodétermination dans la fin de vie.
© Toloblagueur.com/Shutterstock
Dans quels domaines pensez-vous que la loi sur l’euthanasie devrait être modifiée ?
Pour les personnes frappées d’incapacité testamentaire – pour cause de démence, par exemple –, la loi actuelle n’offre pas de solution, à moins qu’elles ne soient dans le coma et qu’elles aient laissé un testament. C’est trop limité. Il y a des gens qui déclarent explicitement qu’ils ne veulent pas continuer à vivre dans un état dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Nous devons les prendre au sérieux.
Voyez-vous une volonté politique allant dans ce sens ?
Cela figure dans l’accord de coalition fédérale de l’Arizona, mais à la condition que des « recherches scientifiques » soient menées. Je pense que c’est absurde. Si des personnes saines d’esprit disent « je ne veux pas continuer à vivre comme ça », c’est évident qu’il faut accéder à leur demande. Plus de 80 % des Flamands sont favorables à une modification de la loi, et ce souhait est également partagé par les médecins.
Quelles évolutions constatez-vous dans les demandes d’euthanasie ?
Il y a une nette augmentation des demandes basées sur la polypathologie : des personnes souffrant de maladies multiples et chroniques. Aucune de ces maladies n’est intolérable en soi, mais leur combinaison rend la vie des patients sans espoir. Ce groupe représente aujourd’hui plus d’un cinquième des demandes d’euthanasie. Après les patients cancéreux non traités, c’est le groupe le plus important.
La médiatisation de la souffrance mentale, comme dans le cas de l’acteur Aron Wade3, influe-t-elle sur les chiffres ?
Pas vraiment. L’année dernière, il y a eu 3 991 demandes d’euthanasie, dont une cinquantaine fondées sur la souffrance psychologique. Mais ce chiffre ne représente probablement que la partie émergée de l’iceberg. Il y a encore des gens qui ne trouvent pas la bonne voie, ou qui abandonnent à cause de la longueur des procédures.
La Belgique est un des rares pays, avec les Pays-Bas, à avoir voté une telle loi sur l’euthanasie. Voyez-vous beaucoup d’étrangers ?
Tout à fait. La ULTeam4 reçoit beaucoup de questions de la part d’étrangers. Les gens cherchent sur Google, nous trouvent et viennent ici. Un patient polonais atteint de sclérose latérale amyotrophique a été amené ici en ambulance – il était fort diminué mais déterminé. Ou encore ce professeur de Paris qui est venu chercher un traitement palliatif de la douleur parce que son médecin était en vacances et que personne ne voulait lui donner de la morphine… Ce genre d’histoires vous fait réaliser à quel point notre réglementation est exceptionnelle.
Quel rôle la religion joue-t-elle encore dans le débat aujourd’hui ?
Elle est toujours présente, surtout au sein de l’islam. La morphine y est parfois refusée parce qu’il faut se présenter devant Allah en pleine conscience. J’ai connu des patients qui imploraient silencieusement un soulagement de la douleur, mais qui n’osaient pas en parler à leur famille. Ou qui ont dû déchirer leur demande d’euthanasie sous la pression.
La sédation palliative est souvent mentionnée comme une alternative à l’euthanasie. Quelle est la différence ?
La sédation palliative consiste à endormir quelqu’un en cas de souffrance insupportable qui ne peut plus être traitée. L’intention n’est pas de mettre fin activement à la vie, mais avec l’accoutumance croissante aux somnifères, cela se produit parfois indirectement. C’est alors le médecin qui décide, et non le patient. C’est pourquoi je plaide depuis des années en faveur d’un cadre juridique, comme c’est le cas pour l’euthanasie. Chaque année, il y a au moins cinq fois plus de sédations palliatives que d’euthanasies, mais elles ne sont pas enregistrées. À l’UZ Jette, nous le faisons. Cela permet de clarifier les choses, y compris pour les membres de la famille, et d’éviter les problèmes juridiques. Je suis actuellement impliqué dans deux affaires judiciaires où les intentions du médecin n’étaient pas claires.
Nous en sommes à la dix-huitième édition de votre livre. Qu’attendez-vous encore ?
Premièrement : plus de ressources pour les soins palliatifs. Aujourd’hui, les gens se voient parfois refuser ces soins. C’est inacceptable. Deuxièmement : une modification de la loi sur l’euthanasie, afin que les personnes ayant acquis une incapacité juridique puissent également être aidées. Troisièmement : il faut également prévoir une réglementation pour les nouveau-nés et les jeunes enfants en souffrance insupportable et dont le cas est sans espoir. Aux Pays-Bas, il existe le protocole de Groningue, ici il n’y a rien de tel. Les parents sont désemparés. Ils méritent eux aussi d’être aidés.
- Cet article est une version traduite de « De dood blijft een taboe, maar euthanasie niet », mis en ligne sur demens.nu le 30 juin 2025. Il est publié ici avec l’autorisation de deMens.nu et de ses auteurs.
- « Une fin de vie digne. Respect du droit à l’autodétermination » en français, NDLR.
- Acteur flamand qui a lutté la majeure partie de sa vie contre l’anxiété et la dépression et dont la demande d’euthanasie introduite en avril 2023 a été finalement acceptée en septembre 2024, NDLR.
- « UL » est l’abréviation de « Uitklaring Levenseindevragen », qui signifie « clarification des questions de la fin de vie ». Ce centre d’expertise est une initiative de l’UZ Brussel et de l’UZ Gent, NDLR.
Partager cette page sur :
