Libres, ensemble
Le beauf
n’est pas toujours
celui qu’on croit
Propos recueillis par Catherine Haxhe · Journaliste
Mise en ligne le 14 novembre 2025
« On est tous le beauf de quelqu’un », disait le dessinateur Cabu. C’est à l’occasion d’une exposition proposée par le Centre d’Action Laïque de la province de Liège à la Cité Miroir, « Clichés de classe », que nous avons pu rencontrer Rose Lamy. Au milieu de photographies anciennes, témoignant et révélant les rapports de classe de la fin du XIXe siècle, l’occasion était trop belle d’aborder un stéréotype social qui ferait plutôt sourire. Et pourtant, n’est pas « beauf » qui veut !
Photo © Vector Happy People/Shutterstock
On connaît Rose Lamy pour son compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre ». Un compte qui a eu tant de succès qu’une maison d’édition lui a proposé d’en faire un livre, puis deux. Ainsi est né son premier ouvrage Défaire le discours sexiste dans les médias. Il y eut ensuite En bon père de famille. Et tout récemment, Ascendant beauf .
Après les violences patriarcales, sexuelles, vous étudiez les violences de classe et la nouvelle guerre culturelle qu’elles engendrent. Ce livre vous l’avez écrit non pas pour les intellectuels parisiens, mais plutôt pour la France moche, la France périphérique ?
Oui, pour cette France où j’ai grandi, en pleine diagonale du vide. Je suis berrichonne et comme je l’explique dans le livre, à certains moments de mon parcours, j’ai été assignée beauf. Parce que j’avais certains goûts musicaux, une culture populaire, que je participais à des soirées en salle des fêtes. Et j’ai beaucoup lutté contre l’idée de l’être. C’est une assignation et c’est une désignation qui vient des autres. J’ai beaucoup lutté contre l’idée de l’être.
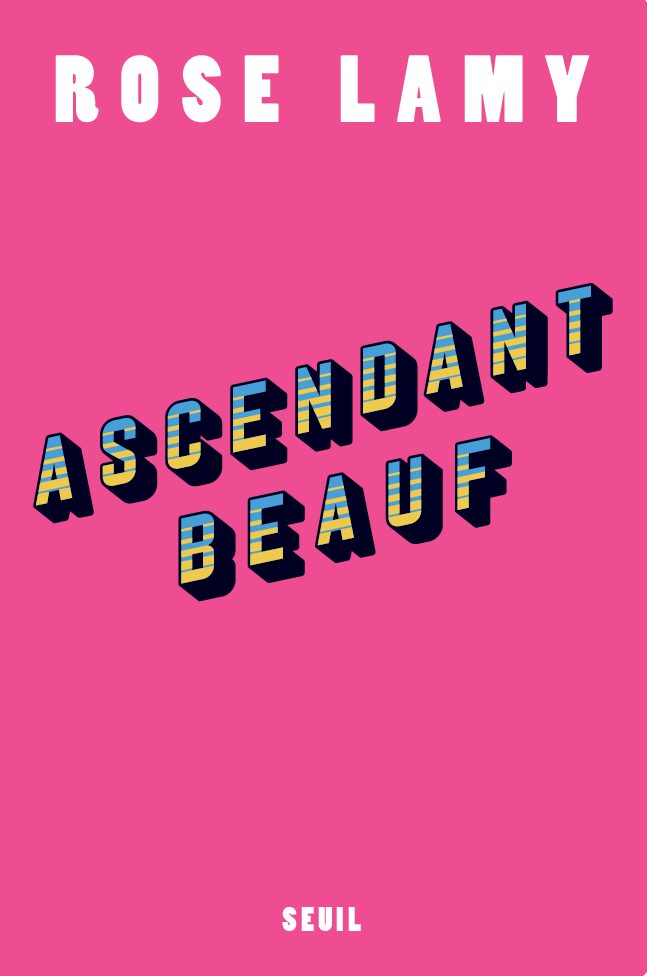
Rose Lamy, Ascendant beauf, Paris, Éditions du Seuil, 2025, 167 pages.
Vous expliquez dans le livre que vous quittez la maison familiale à 17 ans pour la fac d’histoire, où vous vous ennuyez très rapidement. Vous n’y restez pas longtemps. Vous préférez vous investir dans les syndicats de gauche. Et là, avec ces nouveaux amis « intellectuels de gauche », comme vous le dites, lors d’une soirée, vous vous mettez à danser sur une chanson de Joe Dassin. Que se passe-t-il ensuite ?
J’ai la révélation que ce chanteur que j’adorais depuis longtemps, Joe Dassin, était considéré comme « beauf ». Connaître par cœur au premier degré la chanson « Les yeux d’Émilie », très branchée de nos jours jusqu’à avoir été dans la playlist des Jeux olympiques à Paris, à l’époque, c’était moyen. Mais ce soir-là, mes amis eux se lèvent et caricaturent Joe Dassin, comme on tournerait les serviettes, pour se moquer. Je savais que mon déficit culturel existait parce que je n’avais pas lu la moitié des auteurs dont ils parlaient, mais imaginer que ce que j’aimais depuis toujours, en famille, ne pouvait se concevoir dans ce monde-là, c’était nouveau pour moi et ce fut un électrochoc. S’ajoute à cela la réflexion du propriétaire du disque qui s’excuse presque de le posséder et dit « je l’ai eu à une foire aux disques pour trois fois rien ». Il y a clairement une mise à distance, « c’est mon petit plaisir coupable ». Là, vraiment, je ne comprends pas ce qu’on me dit. Je joue un rôle, je réponds « moi aussi ». Sur le chemin du retour, je me demande : « De quoi suis-je coupable ? » Je dois déjà rattraper tout ce retard culturel en livres, en théâtre, en opéra. Il faudrait qu’en plus, je renonce à Joe Dassin ?
À ce moment-là, vous êtes choquée mais vous le cachez. Et ce n’est que plusieurs années plus tard que vous prenez conscience du caractère éminemment politique de la situation. La bataille culturelle était déjà entamée, selon vous ?
Oui, parce qu’il y a là une partie de la bataille qui se joue. Et le beauf, il est obligatoirement politique par son origine. En France particulièrement, on se traîne encore ce personnage et ses antagonistes, on est toujours en train de revivre un peu la même scène. Celle de Cabu qui proposait dans ses dessins ce personnage à la suite de Mai 68 : la soixantaine bedonnante à moustache, de droite, voire d’extrême droite, réactionnaire, conservateur. C’est d’ailleurs cette définition qui est rentrée dans le dictionnaire dans les années 1980.
Aujourd’hui plus que jamais, le beauf est stigmatisé : c’est le mal votant, c’est le mal sachant. Le raciste aussi ?
Le beauf a toujours mal voté. Il était l’antagoniste du gauchiste et c’est vrai que maintenant, la polarisation s’est un peu décalée, ce serait l’électeur du RN. On le verrait plus sous les traits du tonton raciste des fêtes de famille, qui a un petit peu trop bu.
Vous évoquez aussi les prénoms, une forme de stigmatisation du « beauf » qui mettrait à l’écart tout un pan de la société ?
En effet, les Jordan, les Kevin, tous ces prénoms anglo-saxons considérés comme des prénoms beaufs, parlent d’une classe sociale et d’un territoire qui peuvent se sentir insultés, rejetés, dénigrés. Cela peut les pousser vers des extrêmes qui leur disent « voyez comme la gauche intello vous traite ! ». Et imaginons qu’un homme brigue la plus haute fonction de l’État en s’appelant Jordan ou un Premier ministre Kevin, on comprendrait aisément que ce soit formidable pour eux. Et à juste titre, ils pourraient s’en réjouir. Dans le livre, j’évoque notamment un sketch diffusé sur France Inter qui m’avait un peu choquée : une humoriste ne dit pas autre chose en demandant « mais où va-t-on ? Un président Jordan, une ministre de la culture Kimberley ? ». Cela m’avait interpellée. En quoi serait-ce un problème, en fait ? Et bien sûr, le RN joue beaucoup sur ces symboles, il se vante d’être le premier parti à avoir fait rentrer des Kevin à l’Assemblée nationale, avoir fait élire un maire Steve, à proposer un candidat Jordan à la présidence.
Rose Lamy se plaît à paraphraser Cabu : « On est toujours le beauf de quelqu’un, à la fois victime et bourreau. »
© Marie Rouge
Ainsi les beaufs n’existent pas. Ou alors seulement dans le regard de ceux qui cherchent à mettre à distance une partie de la population qui les dégoûte […] D’autres, et c’est un risque que j’ai mesuré, voudront probablement gentrifier le beauf, s’accaparer sa force et sa richesse. Je prends de mon côté la décision de le redéfinir. Un prénom beauf portera en lui toute une culture familière. Une chanson beaufe sera sensible et entraînante. Un film beauf mettra en scène des personnages de classes populaires en dehors du regard bourgeois et dotés d’agentivité. Quand j’aurai besoin de désigner un homme méprisable, bête et de moralité douteuse, je dirai qu’il est un macroniste. Ma psy dirait sûrement que je suis réintégrée, que j’ai mis fin à ma dissociation. Je parlerai de mon côté d’une euphorie sociale. Je suis enfin fière de ce que je suis, autant que de ce que j’ai été. Libre. Autonome. Fière. Beaufe. »
On est toujours le beauf de quelqu’un, à la fois victime et bourreau en quelque sorte. On participerait à cette polarisation en pêchant par méconnaissance de l’autre ?
-C’est évident, il y a des mécanismes ou des dogmes qui viennent de la gauche dont je me revendique et dont je fais partie. Mais certains de ces mécanismes reflètent une distance avec des gens de classe populaire, or cette classe populaire ne contient pas que des beaufs. Il en va de même lorsque l’on dit qu’on ne doit plus discuter avec les gens d’extrême droite, c’est oublier que nous sommes nombreux à en compter dans nos familles. Cela pose la question des rapports intimes et de l’injonction à couper le lien. Elle ne peut vraiment venir que de gens qui n’ont plus d’affection ou d’amour ou de lien familial avec ces personnes-là. Je ne dis pas qu’il faut absolument garder le lien si c’est trop violent et si on se met en danger mais il s’avère que moi j’ai des exemples dans ma famille, on a réussi à discuter, à conserver le débat et c’est essentiel.-
Vous retournez souvent dans votre famille. Vous ne renieriez jamais votre ascendance beauf ?
Non jamais ! J’ai connu un « déplacement » social, même si c’est par les réseaux sociaux et non par une grande école, ce qui est peu commun. On parle souvent de trahison ou de liens coupés avec ses proches, ce qui n’est pas du tout mon cas. Je voulais aussi, par ce livre, prouver que l’on pouvait vivre en bonne harmonie dans divers mondes. Que la polarisation n’est pas une fatalité, même en pleine bataille culturelle ! Ce livre-ci a été plus lu par ma famille que les précédents. J’ai eu beaucoup de retours positifs. Un cousin m’a même dit : « Je ne savais pas que j’étais beauf mais je suis fier de l’être ! » Ça m’a fait plaisir, j’ai pu en discuter avec d’autres membres de ma famille. J’ai appris qu’après mon départ pour la fac lorsque je suis revenue la première fois auprès de mes proches pour une fête, je n’ai pas cessé de donner des leçons de morale, sur le véganisme notamment. Cela avait été brutal pour eux et je ne m’en étais même pas rendu compte. Aujourd’hui, on peut en parler.
En évoquant les populistes et l’extrême droite qui a bien compris que la guerre culturelle était engagée et qu’elle pouvait lui servir, vous écrivez qu’il ne serait pas étonnant que Jordan Bardella fasse sciemment des fautes d’orthographe dans l’introduction de ses livres.
C’est peut-être ma théorie du complot, mais ce qui est certain, c’est qu’il y a des fautes d’orthographe dans tous ses livres. Cela crée une polémique qui leur est utile, « regardez comme nous sommes humiliés parce qu’on fait des fautes d’orthographe », cela les rapproche des gens qui sont en insécurité orthographique. Et en France, cela concerne une majorité de la population. L’attaque sur l’orthographe est une mauvaise stratégie pour s’attirer la sympathie des gens. Il y a populaire et populisme.
