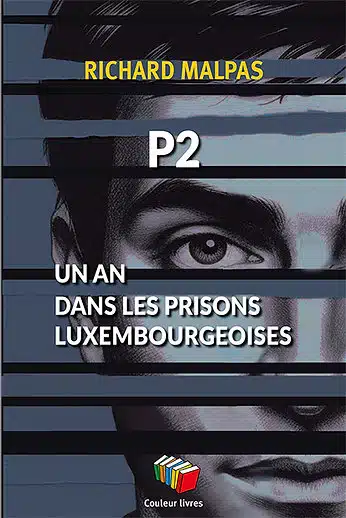Accueil - Exclus Web - À table -

365 jours privés de liberté
Lilas Rigaux · Déléguée « Étude & Stratégie » au CAL/COM
Mise en ligne le 17 novembre 2025
Les récits sur la vie en prison ne manquent pas. Tous insistent sur sa dureté, sa violence, son ambiance criminelle. Étonnamment, moi qui ai eu droit à ma propre expérience de la vie carcérale, outre ces aspects négatifs, j’en retiens aussi des choses positives… même si je me garde de conseiller à quiconque d’y passer ses vacances ! »
Un ancien détenu de la prison de de Schrassig livre un témoignage brut et saisissant de son année derrière les barreaux en 2005. À travers une écriture directe, celui que l’administration luxembourgeoise prénommait souvent Richard et qui a choisi de se faire appeler Malpas en raison du faux pas qui l’a mené en prison donne à voir la réalité quotidienne derrière les murs : la promiscuité, l’ennui, la violence sourde, mais aussi les fragilités humaines et les solidarités inattendues qui surgissent dans cet univers clos. Son récit n’a pas pour ambition d’ériger une thèse juridique ou sociologique, mais bien d’ouvrir une fenêtre sur l’expérience carcérale, souvent réduite à des abstractions dans le débat public.
Ce qui frappe dès les premières pages, c’est l’ambivalence du récit. Malpas ne cache rien des manquements graves de l’institution : gardiens incompétents ou violents, mesures absurdes en matière de prévention du suicide qui perturbent sévèrement le sommeil des détenus, droits de la défense bafoués, des avocats pro deo qui ne montrent pas le moindre intérêt pour leurs dossiers, etc.
Le système apparaît à la fois dur et défaillant, incapable d’offrir de véritables perspectives de réinsertion. Cependant, parallèlement, l’auteur décrit un quotidien marqué par des instants de complicité avec ses codétenus, des moments presque légers, qui prennent parfois l’allure de scènes de cour de récréation. L’humour et la solidarité permettent de tenir, et Malpas lui-même retrouve une forme d’insouciance enfantine dans ces instants en inventant mille manières pour se distraire.
Chaque chapitre retrace l’histoire d’un codétenu et révèle un constat frappant : la majorité d’entre eux sont incarcérés pour des affaires liées au trafic de stupéfiants, alors qu’il s’agit bien souvent de personnes souffrant d’addictions. Leur place serait dans un parcours de soins, non derrière les barreaux. D’autres ont grandi dans des environnements où la délinquance constituait le principal horizon possible, ou commettent des délits poussés par une précarité extrême. On croise aussi des profils plus fragiles, comme l’auteur lui-même, happé par un engrenage qu’ils ne maîtrisent plus. Ces récits interrogent profondément le sens de la peine : la prison sanctionne des existences vulnérables sans traiter les causes structurelles de la délinquance, pauvreté, exclusion, dépendance, absence de perspectives et échoue à offrir une réponse adaptée.
Quadrilingue et doté de notions de droit, Malpas explique comment il devient une sorte d’assistant social improvisé : il traduit des dossiers, rédige des courriers, explique des procédures à ses codétenus. Cette position valorisante lui donne une place particulière dans la communauté carcérale et l’aide à donner du sens à son séjour, mais elle souligne également un vide institutionnel inquiétant : ce travail élémentaire d’accompagnement devrait être assuré par des professionnels, et non reposer sur la débrouille et les compétences personnelles d’un détenu.
Alors que le récit de Malpas illustre l’inefficacité structurelle de l’institution carcérale, paradoxalement, pour l’auteur, l’incarcération se transforme en une étape décisive. Privé de tout soutien réel de l’institution, il réussit à s’en sortir par ses propres forces : il reprend des études, trouve un emploi et refait sa vie en Belgique. Cette réussite, que l’on pourrait qualifier d’exemplaire, est aussi une critique implicite : elle montre que la réinsertion n’a pas été rendue possible par le système, mais s’est réalisée en dépit de lui.
En ce sens, Un an dans les prisons luxembourgeoises agit comme un rappel nécessaire : la prison n’est pas un monde à part, mais un miroir de notre société et de nos choix collectifs. Elle concentre les inégalités sociales, les manquements du système judiciaire et le manque de moyens humains pour accompagner les parcours de vie fragiles. En le lisant, nous ne sommes pas invités à plaindre ou à absoudre, mais à réfléchir à ce que notre système pénal dit de nous, et à quelle vision de l’humanité nous voulons adhérer. Il met en lumière une évidence : sortir d’une logique purement punitive est indispensable si l’on veut construire une justice qui répare et une société qui n’abandonne personne, même entre quatre murs.
Partager cette page sur :