Accueil - Exclus Web - Intersection -
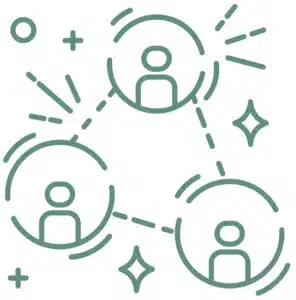
Intersection
Ce qui nous lie
Un cœur grand comme ça
Louise Canu · Journaliste multimédia
Mise en ligne le 14 février 2024
À la rédac’, on exècre la Saint-Valentin. Prétextant le refus ferme de participer au maintien d’une grosse machine capitaliste, nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas avoir consacré une seule seconde à la recherche du cadeau qui fera mouche. De toute façon, les roses, c’est hors-saison.
N’empêche qu’en ce 14 février, on a jugé bon d’écouter ce qu’ont à dire nos myocardes. Certes, on a probablement connu plus transgressif que de se targuer de zapper la Saint-Valentin – comme par exemple, donner la parole à celles et ceux qui aiment envers et contre tout. Sam, Yann, Julie et Laurie nous racontent leur amour pour la liberté intellectuelle, l’art, le vivant, l’altérité et l’émancipation personnelle. Cartographie sociale de qui et comment on aime, en ce 14 février 2024.

Sur scène, Sam Touzani chante, danse et saute jusqu’à perdre haleine. Loin de la représentation, le papa de 55 ans livre une vision tranchée de l’art et raconte sa volonté de s’émanciper intellectuellement.
© Jef Boes
Sam : la découverte de l’amour inconditionnel
Quelques instants après que Sam ait débuté son seul-en-scène Cerise sur le ghetto au Théâtre du Public, une sonnerie retentit dans le public. Au premier rang, une spectatrice bien embêtée éteint son téléphone. Sam ne se laisse pas démonter : « Alors Marie-Rose, vous vouliez me piquer la vedette ». Rires dans l’assemblée, « sacrée Marie-Rose ! » Quelques minutes plus tard, un nouveau téléphone sonne. Le visage de Sam s’assombrit, rappel à l’ordre, le public s’agace, « les gens ne sont plus capables de profiter du moment présent ». Il ne suffit que d’une minute avant que Touzani ne se transforme. Il redevient le petit Sam, à la recherche d’un exutoire dans les toilettes pour feuilleter Le Petit Prince. « À Molenbeek », dit-il, « les moutons, on ne les dessinait pas ». Sur scène, il endosse les traits de son père, l’ogre, marchant le dos tassé comme sa mère, invoquant le chant et la danse pour parachever sa métamorphose en un siècle d’histoire familiale.
« Mon père parlait tout le temps tout seul. J’avais honte quand j’étais enfant. Il priait seul, mangeait seul, peut-être même qu’il faisait l’amour tout seul, mais je ne sais pas, on n’a jamais parlé de sexualité à la maison. C’est en le voyant prier que j’ai eu envie de faire de la danse. C’était d’une beauté, d’une force. Je trouvais ça touchant de voir mon père, cet incroyable Hulk, cet ogre, se transformer en havre de douceur. Le seul moment où mon père cessait d’être en guerre contre lui et contre le reste du monde, c’est quand il entrait dans notre salon pour prier. En récitant ses prières coraniques, il n’était pas dans son incontinence verbale. Il devenait doux comme un agneau. Il avait cette capacité de se rassembler, de cultiver cette paix intérieure, cette intelligence sensible. Par la prière, il se délestait de la honte, de ses chaînes de culpabilité. Il acceptait quelque part sa condition humaine, même s’il était dans une relation verticale entre son Dieu et lui. Il acceptait la transformation.
Son crédo : l’universalisme
« Chez nous, ça se passait comme dans beaucoup de familles marocaines », ajoute Sam Touzani. « Parents analphabètes et croyants, un père isolé, une grande sœur qui se sacrifie pour les autres, un frère qui verse dans l’islam politique et l’intégrisme, un devenu toxico et l’autre complotiste. J’étais le plus petit des frères. J’avais le rôle de Causette, on ne me prenait pas au sérieux, j’étais à la fois omniprésent et dans un angle mort. Je suis le résultat de l’éducation de femmes, j’étais proche de ma mère, de mes sœurs et j’étais choyé par mes institutrices. Ma mère nous a transmis le pouvoir de dire non. En cela, on était différents des autres familles marocaines. Elle dirigeait les cordons de la bourse de la maison et disposait de son temps comme elle l’entendait. Mes frères ont pris des routes très différentes, je suis même en rupture avec certains d’entre eux, que j’estime phallocrates, racistes et antisémites. Je m’en fous, moi, du lien du sang. Je n’ai peur d’être en rupture. Ce qui m’importe, ce n’est pas forcément partager la même vision du monde, mais de partager des valeurs comme le progrès, l’universalisme, placer les femmes et les hommes au-dessus des idéologies. Chez moi, il ne reste que l’art pour rêver et la science pour évoluer. »
Le comédien comprend pourquoi les gens sont croyants, mais il ne trouve pas ça intéressant d’accepter les choses sans les remettre en question. Non, lui, préfère remettre en perspective, les transformer, les désacraliser. Il regarde droit dans les yeux et poursuit : « Le véritable enjeu du XXIe siècle siècle sera de rire de son propre sacré, mais aussi de rire du sacré de l’autre, sans pour autant sortir les kalachnikovs ». Sam est parfois taxé d’islamophobe, pas plus tard qu’au sortir de sa pièce Cerise sur le ghetto d’ailleurs, où un jeune de 16 ans l’interpelle : « Vous avez manqué de respect à vos parents ». « Et ma mère, il n’en parle pas, trop féministe, peut-être ! »
Rencontre intime
Et d’ajouter : « J’ai toujours été profondément hédoniste, j’ai trouvé un nouvel ancrage très tard. J’ai été papa pour la première fois à 50 ans, il y a cinq ans. On a eu d’abord une fille avec ma compagne, puis un garçon. Je vous assure que ça change tout. Mon projet de vie a moi, c’est les enfants. C’est un amour inconditionnel. Je découvre ça, je suis sur mon cul, quoi ! Vous grandissez vous-même bien plus que vous ne faites grandir vos enfants. Ils vous renvoient à quelque chose de très fort au fond de vous-même, d’intime, d’indicible, qui vous dit : attention, je vais te mettre devant tes propres contradictions, et grâce à l’amour, on va se comprendre.
Après ce petit moment de confessions intimes, il revient à son père, son nœud gordien oserait-on dire ? « Mon père n’a jamais vu un seul de mes spectacles. Plus je m’affirmais dans mon art, plus il se refermait sur lui-même. Ma mère est décédée il y a peu de temps. Avec ma compagne et mes enfants, je me suis autorisé à aimer, à être heureux, sans forcément faire des spectacles pour changer le monde. On ne change rien du tout en tant qu’artiste. La seule chose que l’on promet, c’est de partager une utopie. C’est très important, les utopies. Et peut-être que lorsque le rideau tombe, un terreau pour le début d’une réflexion peut naître. Je suis convaincu que lorsque les artistes ne sont pas dans le binaire, dans le noir ou dans le blanc, ils peuvent produire un peu de matière grise ».

Entourée de plantes et de manuels pour future maman, Julie avance pas à pas dans l’espoir d’offrir à sa fille le meilleur espace possible. Et surtout, elle refuse de se soumettre aux injonctions qui pèsent violemment sur les femmes.
© DR
Julie : l’amour de la bienveillance
Julie dort entourée de plantes. Certaines s’en sortent mieux que d’autres, elle ne comprend pas pourquoi ce ficus ne reprend pas. « Peut-être que je lui ai donné trop d’eau ? » Elle a récemment modifié l’emplacement de son lit, le rapprochant de la fenêtre de sorte à ce qu’il baigne dans la lumière du jour. Julie est enceinte depuis quatre mois, d’une petite fille. À la maison, elle bricole, répare, arrose, coud. Elle fait aussi du tricot depuis son passage en cure de désintox, il y a un an et demi. « Dans presque 100% des cas, les personnes qui ne font pas de suivi retombent directement », dit-elle. « D’ailleurs, le problème ne se résout jamais. »
Derrière cette addiction, une détresse. Et de sérieuses sorties de route. La vie n’a pas toujours été tendre. « Il y a deux ans, j’ai été agressée sexuellement. Et ça a vrillé très vite, parce que j’ai nié le problème. J’ai toujours vécu comme ça : il n’y avait pas d’espace chez moi pour exprimer les choses, on ne m’a pas appris à prendre soin de moi. J’ai fait face à ça, avec ce que je connaissais de mieux : l’alcool. D’ailleurs, je n’appellerais pas ça un foyer familial, dans le sens traditionnel. J’avais des crises de colère terribles, ma mère ne savait pas comment les gérer, elle m’enfermait dans une pièce, je fonçais sur la porte et je m’endormais d’épuisement. On n’en parlait jamais. Ma mère était dépressive. On n’arrivait plus à se parler. Je suis partie de chez moi, parce que je n’avais pas envie d’être responsable du pire. Elle me l’a reproché. Mon père était du genre absent.
La grossesse, le non-choix d’être une femme
À 19 ans, j’ai rencontré quelqu’un qui en avait 25. Il m’a complètement retourné le cerveau, et m’a liguée contre ma famille. J’ai fait mes affaires et je suis partie vivre chez lui, dans un 15 m2 du CPAS. Il m’a fait goûter presque toutes les drogues, a volé chez ma mère et a revendu ses affaires. Je n’avais plus le droit de voir mes copines, les seuls amis que je pouvais fréquenter étaient les siens. C’est déjà arrivé que je cours me réfugier chez eux. Une fois, il a menacé un ami de lui couper la main, et lui a fichu un coup de boule. J’avais honte. Des policiers en civil ont vu la scène. Une fois qu’il s’est retrouvé au commissariat, c’était complètement quelqu’un d’autre. Calme. Maîtrisé. Moi, j’hurlais. Et lui de dire : « Vous voyez bien, ce n’est pas moi, c’est elle. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse face à quelqu’un comme ça ? » On m’obligeait à me calmer, c’était très violent. Ma mère m’a retrouvé sept mois plus tard, la peau sur les os.
La majorité de mes relations se sont construites à travers la consommation. Ce n’est pas vraiment de l’amour, plutôt de la codépendance. Une des rares personnes que j’ai profondément aimées est un ami qui ne consommait pas du tout. Julien ne faisait pas partie du milieu. On se connaissait depuis l’adolescence, j’étais prête à construire quelque chose de sérieux. Sa mère s’est suicidée alors qu’on était ensemble, pendant la pandémie de Covid. Il n’arrivait plus à s’investir dans notre relation. Après notre rupture, je suis retournée chez ma mère, toujours pendant cette période. Je travaillais au Carrefour, j’achetais tous les jours deux bouteilles de vin, que je descendais le soir. »
Depuis qu’elle est enceinte, Julie ne boit plus du tout. Si elle se surprend à rêver de temps à autre d’un plateau de fromages accompagné d’un bon verre de vin rouge, elle ne touche même pas aux bières 0 % qui lui restent de sa période de cure. Arrêtée par son médecin pour grossesse à risque, elle consacre ses journées à écumer les annonces immobilières. « Cet appartement sera parfait, il faudra juste faire attention avec l’escalier en colimaçon, ça peut être dangereux. » À la maison, ses colocs regrettent qu’elle s’en aille, ne serait-ce que parce qu’elle est la seule à savoir réparer un robinet. Elle se fiche bien que ce soit considéré comme masculin, surtout par son grand-père maternel. « J’ai beaucoup réfléchi à ce qu’être une femme. C’est important de savoir se définir, et tout aussi important qu’on arrête de définir les autres à travers ça. Ma vision de la féminité m’appartient complètement. Avec la grossesse, on me fait bien comprendre que je n’ai pas le choix que d’être une femme. C’est moi qui ai mal aux pieds, moi qui meurs de faim, moi que le médecin a mise à l’arrêt. Mon compagnon ne connaît pas cette réalité-là. C’est moi qui dois le préparer à la sonde que je vais recevoir chez le gynéco. De son côté, il a davantage envie de s’impliquer dans le côté financier, parce que ce serait le rôle de l’homme. »
« Ma grand-mère est décédée le mois dernier », poursuit Julie. « D’une certaine façon, ça a libéré ma mère. C’est une femme forte. Elle est restée à son chevet à l’hôpital jusqu’à la fin, alors qu’elles n’ont jamais été proches. Elles ne se sont pas tenu la main, juste regardées. Et comme si ma grand-mère sentait la présence de ma mère, elle a attendu qu’elle se retourne pour rendre son dernier souffle. Je venais d’annoncer à ma famille que j’étais enceinte, comme si elle avait senti que c’était le moment de laisser sa place dans la lignée. Mon père ne boit plus depuis vingt ans. Il s’est engagé dans des projets qui ont du sens, il mène une vie plus résiliente. Depuis qu’il sait que je suis enceinte, c’est même devenu un super papy. C’est un autre cycle qui commence pour tout le monde. »
Comment envisage-t-elle sa propre famille en construction dans tout ça ? « Dans mon cas, l’amour a quelque chose de transgressif. Mon copain est afro-descendant. Au regard d’où je viens, c’est déjà problématique. Faire un enfant à deux, lui apporter une éducation, des valeurs, de la joie et du partage, m’émanciper des schémas qui m’ont été imposés, créer une bulle d’amour, s’entourer de personnes bienveillantes… C’est un beau pied de nez à ma propre enfance. »

Yann a un pied dans la politique, l’autre dans le social. Ce qui lui donne envie de continuer : offrir aux plus précaires les outils pour se faire entendre dans l’espace public.
© DR
Yann : l’amour de l’engagement radical
Yann Mai a une façon bien particulière de tenir sa cigarette entre ses doigts, comme si par la pression de son index et de son majeur, il cherchait à la dissimuler au creux de sa main. Comme si c’était possible, il fume encore un peu plus qu’avant… il est sûrement un peu stressé. Mis à part ça, il observe une routine olympique. Il pédale beaucoup, dort sept heures par nuit, refuse la proposition de bière, car autour de lui se multiplient les burn-out professionnels et militants. Il préfère se préserver. Seulement du café. « Le sucre est dans le placard ? » La journée, il bosse dans un parti politique et prolonge son temps par du militantisme, duquel il se garde bien de nous livrer trop de détails.
« À 14 ans, je n’étais pas intéressé par ce qu’on m’apprenait à l’école. Mes parents m’ont suggéré d’aller en enseignement technique de qualification. J’ai quitté le général secondaire et je me suis essayé à l’horticulture, puis aux techniques de l’environnement. J’ai découvert comment construire un potager, gérer un compost, j’ai étudié la structuration des sols, appris le nom des plantes. Je me levais à l’aube en plein hiver pour récolter des pommes de terre et des topinambours. Je l’ai vécu comme un déclassement, mais j’y ai mis toutes mes frustrations. Frustré de ne pas comprendre pourquoi on n’agissait pas plus pour l’environnement, pourquoi on produisait encore et toujours plus de bagnoles, pourquoi on consommait toujours plus de plastique. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai intégré Sciences po quelques années plus tard.
Entre-temps, j’ai commencé un tour d’Europe à vélo. Je plantais ma tente au milieu de nulle part dans les forêts ou dans le jardin des gens, j’avais seulement une carte et une boussole. Pas même de smartphone, c’était contre mes principes. Depuis, ma position a un peu évolué. Même s’il pollue moins, disons que le Nokia 3310 permet une communication limitée. J’avais un collègue à Lisbonne qui venait de Los-Angeles, il m’en parlait souvent. Pas du tout cliché, le gars avait 23 ans et était déjà très critique du système américain, de la guerre en Irak et en Afghanistan. Je l’ai rejoint pendant trois mois ».
Lorsque Yann atterrit aux Etats-Unis, il n’emporte avec lui qu’un sac à dos, une paire de bottes et trois t-shirts. Les gardes de la sécurité à la Douane sont suspicieux. Il reste enfermé six heures dans leur bureau, à répondre inlassablement aux mêmes questions : Que faites-vous aux Etats-Unis ? Pourquoi avez-vous si peu d’affaires ? Pourquoi n’avez-vous pas de smartphone ? Yann rallume une cigarette, le cendrier encore fumant. Le 3310 fait décidément son petit effet. Énorme machine institutionnelle qui n’imagine probablement pas qu’il puisse être là pour autre chose que s’installer, travailler, et voler l’argent des braves américains. Parce qu’il n’a ni la panoplie du parfait touriste ni de réservation dans cinq cents hôtels différents, Yann semble hors norme, devient une menace à l’ordre institué.
Ce que j’aime ? Allier le politique au militantisme
Mais ces sentiments d’incompréhension, le regard interrogateur des autres, ce décalage, le construisent et le conduisent vers la construction de sa personnalité. Cela l’aide à poser ses choix. « Cette frustration liée aux enjeux environnementaux, mon sentiment de ne pas entrer dans la norme, mon incompréhension face à une machine institutionnelle qui ne parvient plus à faire face aux enjeux actuels… Tout ça m’a conduit sur les bancs de Sciences po pour mieux comprendre quels étaient les freins à un changement structurel. Après mes études, j’ai postulé chez Écolo pour travailler sur les questions d’asile, de migration et d’interculturalité. Clairement, je me suis questionné sur ma légitimité. Tu postules alors que t’es un homme blanc cisgenre hétérosexuel. Qu’est-ce que tu vas parler de migration et d’interculturalité, t’es le stéréotype de la personne la plus problématique qui existe ?! Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, pour parler aux autres hommes blancs hétérosexuels cisgenres, rien de mieux qu’un autre homme blanc hétérosexuel cisgenre. Histoire d’apporter un contre-discours dans cette caste-là. En politique, le messager est symboliquement au moins aussi important que le message. »
Son point de vue est radical. Militant dans l’âme, il s’évertue à vouloir faire bouger les lignes. Yann connaît bien les coursiers à vélo de Bruxelles, ceux qui travaillent pour 4,42 euros net la livraison, se font exploiter toute la journée, travaillent 7/7 jours et peinent à boucler leurs fins de mois. Il intervient régulièrement comme militant à la Maison des livreurs. Pour le reste de ses activités militantes, il préfère se montrer discret. Il n’est pas du genre ostentatoire. Il refuse un verre d’eau et reprend. Il occupe une position discrète mais essentielle, comprenez qu’il aide les personnes précarisées à faire entendre leur voix dans l’espace public : « La politique, c’est du stratégique, sur du temps long, et ça manque parfois de concret. L’action militante, c’est du concret, mais ça manque de long terme. J’ai besoin des deux. C’est ça que j’aime, qui me donne envie de continuer. De pouvoir aider, accompagner, sans prendre la place de la personne, c’est incroyable. C’est ce qui me touche le plus, je pense. Je ne sais pas si je suis optimiste. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais je ne resterai pas les bras croisés comme un con à dire : Je vous l’avais bien dit. »

Laurie Pazienza est une activiste de 28 ans. Ne lui parlez pas d’éco-anxiété : le militantisme, c’est d’abord la joie de se mobiliser ensemble.
© DR
Laurie : l'amour du vivant
Laurie Pazienza a 28 ans. Son compte Instagram, @goodmorninglau, comptabilise plus de 8000 followers. Pour elle, l’activisme, c’est « beaucoup de joie militante ». « Qu’on cesse de parler d’éco-anxiété, la bonne excuse des États et des entreprises pour couper les ailes des militant.e.s : “Regardez ces pauvres activistes, il faudrait plutôt qu’on prenne soin d’eux”. Non, c’est non : tant aux entreprises, qu’aux États. Il faut arrêter de compromettre nos conditions de vie sur terre. » Alors oui, évidemment qu’elle a peur. « Ils sont en train de cramer nos conditions du futur, si on ne meurt pas avant à cause d’une guerre civile.» Mais qu’à cela ne tienne, Laurie ne parlera rien d’autre que d’éco-joie.
« Dans nos luttes, on met énormément l’accent sur le caractère social. Notre but n’est pas de sauver les arbres ou les abeilles, mais si on ne sauve pas les arbres ou les abeilles, on n’aura plus rien à manger. Et on sait très bien qui seront les premiers à ne plus pouvoir se nourrir. Avec trois autres activistes, Adélaïde Charlier, Lucie Morauw et Chloé Mikolajczak, on a créé l’ASBL Totalement Down, qui lutte activement contre les projets fossiles de Total Energies, le plus gros exploitant de pompes à essence en Belgique. On se bat contre un projet de pipelines en Ouganda, dont le but est d’aller siphonner du pétrole en Afrique pour le vendre très cher par ici. C’est clairement du néocolonialisme. 100 000 personnes sont déplacées, avec peu ou pas de compensation. Le social, c’est tangible, c’est tout de suite : les gens sont exploités à la minute où on parle. On ne peut pas dissocier l’environnement du social. »
Et Laurie de poursuivre : « C’est très rare que l’activisme ne rentre pas dans ma journée de travail, puisque j’ai la chance que mon poste d’ingénieure en énergie et changement climatique nourrisse aussi mon activisme. Je connais les mangroves et le Green Deal comme ma poche, donc ça fait gagner pas mal de temps. Et tout simplement, j’ai le privilège de pouvoir faire ça. J’ai le temps, l’énergie et l’argent. Je n’ai pas besoin d’accumuler plusieurs jobs, quand ça s’échauffe en action avec les forces de l’ordre, je crains moins qu’un un homme maghrébin, par exemple. En tant que petite nana blanche, on me laisse beaucoup plus tranquille. »
Engagée, bien informée, Laurie est rationnelle et réaliste, ce qui lui permet d’envisager ses modes d’action pour générer durablement le changement. « On ne va pas changer le monde avec le zéro déchet et le végétarisme, malheureusement. Donc, il va falloir passer la deuxième vitesse et avoir des modes d’action beaucoup plus collectifs. C’est l’objet de mon podcast, Épicea. Depuis un an et demi, j’interviewe les actrices et acteurs du changement pour discuter de leurs luttes pour le vivant, avec un grand V. On parle de féminisme, d’antiracisme, de transidentité, d’écologie, de lutte pour le vivant végétal… J’essaye d’être la plus inclusive possible et d’intégrer l’ensemble des luttes sociales et écologiques.
Pour un épisode, j’ai rencontré Paloma Moritz, la responsable du pôle Écologie chez Blast, un média indépendant français. Pour elle, les médias sont complices dans l’inaction climatique et ses conséquences délétères. On est clairement arrivés dans l’ère de post-vérité. Par exemple, je participais à une mobilisation en France ce matin contre la construction de l’A69 dans le Sud et l’installation de huit nouveaux puits de pétrole dans le bassin d’Arcachon. Une délégation européenne était présente, avec Greta Thunberg. La plupart des médias étaient à côté de la plaque. Plutôt que de parler de nos luttes, ils remplissaient des pages à propos du fait que Greta soit venue en avion de Washington. C’est faux, elle avait pris le train de Londres. C’est d’ailleurs très facile de trouver l’information, car la presse anglaise en a beaucoup parlé, quelques jours avant. Je suis vraiment tracassée par cette capacité qu’ont les médias à déblatérer des mensonges impunément. Contre un pipeline, contre une autoroute, on peut toujours bloquer avec nos corps ; mais contre la désinformation, c’est plus compliqué. »
2060, oser l’utopie
Dans le futur, disons en 2060, si tous nos plans d’action auxquels ont fonctionné et si on a tous fourni beaucoup d’efforts là-dedans, il n’y aura plus d’exploitation humaine, plus de combustion fossile. D’ailleurs les gens nés en 2060 ne sauront même pas ce que c’est la combustion fossile. La société du futur repose sur le partage et l’inclusion. Plus personne n’a de véhicule à soi, la notion même de propriété est révisée, les gens cohabitent dans des habitats partagés. Non, pas besoin d’être dans le même lit, comme je l’ai souvent entendu…
Je n’ai aucun intérêt ni même l’envie d’imaginer un monde où nous perdrions nous luttes. Je ne crois pas que ce soit binaire : on perdra des luttes, mais on en gagnera aussi. J’imagine qu’il fera encore plus chaud à Bruxelles l’été prochain, et nous nous mobiliserons encore plus. En 2024, on trouve des moyens de vivre ensemble, et au pire, on ne les attendra pas. On bloquera leurs projets de merde, et on fera société ensemble.
Partager cette page sur :
