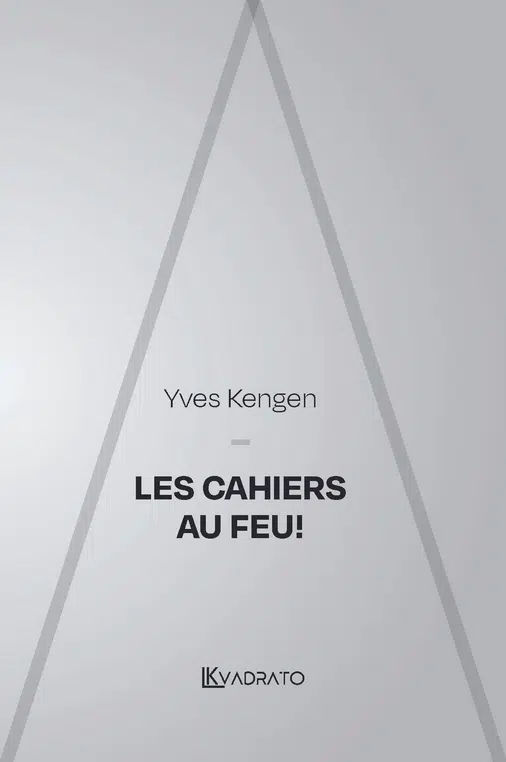Accueil - Exclus Web - À table -

L’idée pas si folle
de réinventer l’école
Vincent Dufoing · Directeur « Projets communautaires » du Centre d’Action Laïque
Mise en ligne le 4 juillet 2025
Adoptons l’idée qu’un jour les êtres humains sauront replacer la notion de progrès dans le sens d’une évolution des capacités intellectuelles, physiques et émotionnelles. »
Quel réel plaisir apporte la lecture du livre d’Yves Kengen Les cahiers au feu !. Au-delà du fait que j’ai fréquenté et apprécié l’auteur pour son franc-parler et sa capacité d’analyse dans le milieu professionnel laïque pendant plusieurs années, son ouvrage apporte, en un peu plus de 100 pages, un éclairage intéressant sur l’évolution de notre société à travers le prisme de l’enseignement qui détient la clé de la pérennisation ou de la destruction de la démocratie, voire de l’espèce humaine.
Yves Kengen rappelle pas mal de dérives de notre société actuelle : la plupart sont évidemment connues, mais l’intérêt de son livre est d’en interpénétrer les causes et de les relier à l’enseignement qui, actuellement, reste malheureusement un puissant outil de conformisme sociétal.
Il commence son analyse par l’évocation des nombreuses crises qui ont émaillé et handicapent encore notre société, dont évidemment celle de la pandémie de Covid-19. À partir de cette réalité, il se pose la question de la capacité de discernement dont les êtres humains disposent encore dans un monde tout entier dévolu à la compétition effrénée et à l’hyper-rentabilité économique et financière, qui favorisent l’instantané et le prêt-à-penser. Il n’invente rien en disant que l’être humain prépare la sixième extinction de l’histoire de la Terre par sa capacité d’autodestruction. Face à cela, il prône le retour de l’intelligence, de la sagesse, de l’inventivité et de l’imagination, désormais très absentes de nos vies soumises à un très grand conservatisme. Il énonce également la nécessité d’inscrire l’enseignement dans le cadre de la globalisation qui est désormais notre réalité à toutes et tous.
Il pose ensuite la question de savoir ce que le progrès apporte réellement aux hommes et aux femmes, si ce n’est une vacuité de sens alors qu’il serait censé nous fournir plus de bien-être. L’auteur rappelle de manière pertinente que le progrès n’affecte depuis des décennies, dans un monde aux ressources finies, que les techniques et non plus les idées, ni les arts, ni la culture populaire, ni le social, ni l’éducation, etc. Car, oui, le progrès technologique creuse un fossé entre les riches et les pauvres en matière d’accès au savoir, à la connaissance et à des soins de qualité. Ainsi, il représente en fait une régression inédite dans l’histoire humaine.
Yves Kengen rappelle tout au long de son ouvrage que, quels que soient les domaines, une éducation de qualité – donc qui ne pérennise pas les inégalités en tous genres – représente la clé pour un avenir démocratique heureux. Pour cela, il estime que l’éducation doit devenir active et ouverte, à l’instar des méthodes éducatives alternatives qui ont fait leurs preuves : Freinet, Decroly, Montessori, etc., qui permettent aux élèves d’apprendre à réfléchir par eux-mêmes pour devenir plus tard des adultes autonomes et responsables. Alors que, depuis de trop longues décennies, l’école se contente de préparer les jeunes à s’insérer dans la société de marché économique. En effet, l’école actuelle façonne de futurs consommateurs de plus en plus dépourvus de libre arbitre et qui seront, en tant qu’adultes, soumis au prêt-à-penser ambiant.
L’auteur rappelle de manière pertinente que l’enseignement ne représente plus qu’une part de l’apprentissage des élèves : il est entré dans une concurrence déloyale avec le monde virtuel qui, par son diktat permanent d’imitation du modèle dominant, nous emporte toutes et tous vers un avenir incertain : Internet, métavers, réseaux sociaux, etc. Comme Yves Kengen l’affirme, « l’école doit changer ou mourir » !
S’ensuit une analyse méthodique des domaines sociétaux qui posent problème et pour lesquels un enseignement de qualité représente la seule réponse crédible : la guerre et son opposé, la paix ; la lutte en faveur des femmes face au modèle patriarcal encore bien trop dominant ; la pauvreté, insulte à l’humanité, source de nombreuses violences ; l’alimentation qui s’assimile toujours plus à de la malbouffe ; la gestion des déchets qui transforme le monde, et particulièrement l’Afrique, en une poubelle à ciel ouvert ; la lutte contre les dérèglements climatiques qui doit nécessairement passer par l’instauration d’un modèle de production et de consommation durable et soutenable ; les médias, dont particulièrement la TV ainsi que les réseaux sociaux qui, sur le mode « d’infobésité », normalisent l’avilissement du public à l’argent et à la rentabilité et qui transmettent à l’envi quantité de stéréotypes ; le mythe mortifère de la croissance (« le nouveau messie d’un credo à l’agonie ») qui n’est qu’une illusion dans un monde aux ressources désormais finies ; le racisme – ce non-sens biologique – corollaire de l’immigration de « pauvres êtres humains au ton basané » ; les passions non maîtrisées, sources de destructions ; le consumérisme à tout crin qui peut être assimilé à du « soft fascisme » ; le travail, la plupart du temps aliénant ; les religions qui ont toutes pris une tournure politique bien éloignée de la spiritualité qu’on attend d’elles ; etc.
Cette longue analyse intitulée « Plaies et remèdes » est d’une grande pertinence, car elle balaie en une soixantaine de pages toute notre réalité sociétale actuelle tout en établissant des liens entre toutes les problématiques et en montrant, pour chacune d’entre elles, comment l’enseignement peut apporter une réponse positive, la plupart du temps dès le plus jeune âge : éduquer aux médias et à l’information, sensibiliser à la nécessaire égalité des genres, faire prendre conscience de l’importance de la paix, sensibiliser à une nourriture de qualité, enseigner les questions environnementales et sensibiliser à la nécessité de la durabilité et de la soutenabilité, éduquer à l’économie à travers son histoire et ses dérives, démontrer que le racisme est une ineptie, etc.
Yves Kengen consacre le quatrième chapitre de son livre à la question essentielle « Quelle société voulons-nous ? ». À raison, il plaide pour une société humaniste basée sur les principes du développement durable et soutenable qui privilégie des initiatives novatrices locales dans une vision sociétale globale. Pour ce faire, il réhabilite l’utopie qui, à tort, a pris un sens péjoratif par son prétendu côté « bisounours ». Il rappelle à notre mémoire les Fournier, Proudhon, Marx, Godin, etc., qui, selon lui, ont peut-être en leur temps eu le tort de vouloir faire le bonheur des gens malgré eux. Nonobstant, l’utopie réinventée devrait permettre à chacune et chacun d’entre nous d’évoluer selon sa propre personnalité dans une société égalitaire dont de nouveaux fondements pratiques permettraient de produire et de consommer raisonnablement et surtout de manière durable et soutenable.
Sans surprise, le dernier chapitre traite de la conséquence du précédent : « Quelle école voulons-nous ? ». Yves Kengen plaide pour une école qui permette de développer le projet de société humaniste qu’il a décrit auparavant et, évidemment, contre la perpétuation du modèle de conformisme social actuel. Pour ce faire, il estime nécessaires la mise sur pied d’un seul réseau d’enseignement – qui plus est officiel –, le rallongement du rythme d’apprentissage actuellement hebdomadaire, l’intégration de nouvelles matières liées à l’évolution de la société et, surtout, le décloisonnement des apprentissages sur le modèle finlandais « d’école phénomène » qui organise transversalement les cours en sessions thématiques à partir des objets et non plus des matières, comme la méthode Decroly l’envisage partiellement. Cette méthode, mise en place récemment en Finlande, fait ses preuves en permettant un « apprentissage joyeux » dénué d’esprit de compétition et valorisant la solidarité, la coopération et la fraternité sur la contrainte. Elle sollicite évidemment les élèves et les professeurs autrement, dans un esprit collaboratif et non frontal, en développant, entre autres, des classes multiniveaux tout au long du cursus scolaire obligatoire. Cette nouvelle méthode non doctrinale et en rupture avec le modèle d’enseignement ex cathedra permet d’aborder toutes les thématiques sociétales par groupes associés : éducation aux médias et à l’information, développement durable, analyse critique de l’économie, politique, ÉVRAS, alimentation et santé, arts et philosophie. D’où le titre provocateur du livre Les cahiers au feu !. Tout un programme qui fait rêver à un monde meilleur encore. Je ne peux que vous encourager à lire cet excellent ouvrage. Bien loin d’être à jeter au feu, il allume au contraire une flamme d’espoir pour repenser notre société.
Partager cette page sur :